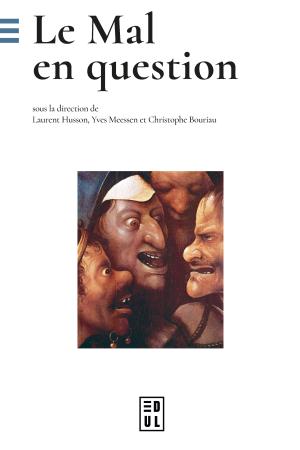
L’éthique telle qu’elle est pensée par l'écologue Aldo Leopold (1887-1948) implique une nécessaire limitation du pouvoir de l’homme. L’Almanach d’un comté des sables est publié à titre posthume en 1949. Toutefois, le pouvoir de l’homme qui est l’objet d’un encadrement éthique n’est ni celui qui a conduit au « mal radical » produit par les régimes totalitaires, ni celui qui implique la potentialité d’une autre forme d’holocauste dans la crainte de la puissance nucléaire. Il s’agit d’une forme plus ordinaire du pouvoir de faire le mal, dans le sens où elle implique les comportements souvent inconscients de centaines de millions de citoyens entrelacés dans des politiques et des conditions économiques singulières. Cependant, cette forme de pouvoir porte en elle les conséquences que les 70 dernières années ont permis d’identifier, de quantifier et de craindre. Le risque de « printemps silencieux »1, l’« aube d’une sixième extinction »2, les dangers estimés dans les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat (GIEC) et de l’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) sur les évolutions du climat et de la biodiversité sont autant d’effets de ce que l’on qualifie souvent d’« anthropocène ». Peut-on alors maintenir l’idée que le mal n’est relatif qu’à l’homme, que la sixième extinction qui se profile n’est un mal qu’en ce qu’elle risque de dégrader grandement les conditions de vie de l’humanité ? À l’inverse, le pouvoir de destruction de l’homme n’implique-t-il pas la nécessité d’une reconnaissance d’une valeur de la nature indépendante des intérêts humains ?
La philosophie environnementale s’est développée depuis une cinquantaine d’années sur la base du constat d’une crise écologique mondiale. Outre les problèmes de la pollution de l’environnement et de l’exploitation des ressources, la question de la valeur, intrinsèque ou instrumentale, des êtres vivants non-humains est particulièrement cruciale à partir de la reconnaissance de leur vulnérabilité et de la responsabilité humaine. John Baird Callicott (né en 1941) incarne alors un écocentrisme cherchant à fonder une valeur intrinsèque de la nature qui n’indexe pas le mal sur les conséquences néfastes que les actions humaines ont sur l’humanité. Loin de l’utilitarisme et d’une morale déontologique kantienne qui centrent la morale sur un calcul du bien-être de l’homme ou sur le respect de l’humanité, Callicott prend la suite de Leopold pour défendre un nouvel « impératif catégorique » commandant de « préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique »3. Le mal serait alors l’injustice consistant à perturber, voire à détruire, ces qualités de la communauté biotique. Alors que l’impératif catégorique kantien implique le respect envers les seuls êtres humains comme personnes rationnelles, Leopold et Callicott étendent la valeur morale sans se concentrer sur ce critère classique de la rationalité. Pourtant, il ne s’agit pas non plus d’étendre la signification du mal par la prise en compte de la souffrance subie par des individus humains ou non-humains, mais bien par les dommages causés à la communauté biotique. Dès lors, comment donnent-ils un sens et justifient-ils cette possibilité d’une extension inédite de la distinction morale entre bien et mal ?
À partir de Leopold, la première partie fournira une généalogie du mal touchant l’environnement en passant par la critique du progrès moderne. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les conséquences réellement néfastes de la technologie, de la consommation et des loisirs, l’originalité de Leopold est d’en identifier la source dans un oubli de la nature qui révèle une anthropologie écologique centrée sur le concept de relation. Dans cette généalogie leopoldienne du mal, la science est déjà présente comme nutriment culturel potentiel pour permettre un progrès véritable, c’est-à-dire moral. La seconde partie examinera alors la manière dont Callicott a systématisé l’éthique de la terre de Leopold en cherchant notamment à approfondir la possibilité d’un fondement scientifique. Cela conduira à montrer comment une éthique environnementale holistique se déploie contre l’anthropocentrisme moral pour donner une signification singulière au mal touchant l’environnement et dont les hommes sont moralement responsables. La dernière partie défendra l’idée que la signification de ce mal fait à l’environnement ne peut pas seulement être trouvée dans une tentative de fondation théorique et scientifique, mais qu’elle n’est entière que lorsque celle-ci est associée à une esthétique environnementale. Revenant à Leopold, il s’agit alors d’ouvrir la voie à une éthique de la nature ordinaire en première personne, seule capable de lutter contre l’oubli de la terre.
Pour Leopold, le progrès n’est pas d’abord un concept abstrait qu’il s’agit de discuter mais un processus de transformation de l’Amérique dont il a fait l’expérience de son vivant. De par son travail de forestier, Leopold s’est notamment intéressé à la raréfaction de certaines espèces (ou au contraire à leur accroissement anormal), à leurs modifications phénotypiques (par exemple leur poids, leur taille…), mais aussi au phénomène de lessivage et d’érosion des sols. À chaque fois, ce qu’il pointe du doigt est la place des activités humaines dans l’étiologie de ce qui est considéré comme une maladie liée aux changements brutaux dans les relations écologiques. Les maux des écosystèmes, maux très sensibles pour un forestier, ne sont alors pas indexés sur les conséquences relatives aux hommes, quoiqu’ils aient très souvent des origines anthropiques.
Dans l’Almanach, Leopold évoque de manière ambiguë les nombreux émissaires du progrès. Les plus visibles pour les habitants d’un coin reculé de l’Amérique sont les routes, l’automobiliste « pétulant et bravache » mais aussi « sa jolie femme » défendant justement le vote des femmes. Il évoque également l’ingénieur du téléphone, ainsi que le trappeur fonctionnaire qui s’occupe des nuisibles et qui abat le dernier grizzly. Viennent enfin ceux qui rédigent « les règles du progrès »4 c’est-à-dire les députés qui votent les financements de l’agriculture et de l’élimination de l’ours. Cette élimination est elle-même commanditée par un chef de service, biologiste, mais qui « ne savait pas que les flèches [de l’édifice écologique] étaient peut-être aussi importantes que les vaches »5. La responsabilité des « forestiers » (dont Leopold fait évidemment partie) est finalement mise sur le devant de la scène du progrès. Comme pour les Espagnols, qui avaient provoqué l’extinction des indigènes pour de l’or, « il ne nous traversait pas l’esprit que nous étions nous aussi les capitaines d’une invasion par trop certaine de sa propre justification »6. Leopold souligne alors l’ironie de toutes ces transformations produites au nom d’un progrès ambigu : le tourisme supplante finalement les besoins en agriculture et le dernier ours, s’il n’avait pas été tué, aurait été un atout remarquable pour cette perspective. Cependant, loin d’impliquer une véritable protection de la nature, le tourisme ne fait finalement qu’aggraver le mal.
Loin des discours politiques qui mélangent indistinctement et de manière irréfléchie tous les aspects du progrès – le but étant de s’affranchir par la rhétorique simpliste de l’idée d’une critique impliquant un encadrement –, Leopold reconnaît le confort apporté par les sciences et la technologie. Il questionne cependant le prix à payer relativement à l’exploitation des ressources et met au cœur du problème une réflexion éthique sur le sens, individuel et collectif, que nous souhaitons donner à nos vies. L’Almanach d’un comté des sables s’ouvre ainsi sur le thème de la critique du progrès pour le retrouver ensuite de manière récurrente tout au long de l’œuvre :
Comme les vents et les couchers de soleil, les choses de la nature étaient tenues pour aller de soi, cela jusqu’à ce que le progrès commence à les oblitérer. Nous nous trouvons aujourd’hui devant la question de savoir si un « niveau de vie » toujours plus élevé vaut son coût en éléments naturels, sauvages et gratuits. Pour nous, qui sommes la minorité, la possibilité de voir des oies est plus importante que la télévision, et celle de trouver une passe-fleur est un droit aussi inaliénable que la liberté de parole.
Ces choses de la nature étaient, je l’admets, de peu de valeur pour les hommes jusqu’à ce que la mécanisation nous assure un bon petit déjeuner et jusqu’à ce que la science dévoile l’histoire de leur origine et de la manière dont elles vivent. La totalité du conflit se ramène par conséquent à une question de degré. Nous autres minoritaires voyons dans le progrès une loi des bénéfices décroissants ; nos adversaires, non7.
En mettant de côté la date de publication de l’Almanach, le lecteur contemporain pourrait trouver assez convenue, quoique percutante dans son style, cette critique du progrès associée aux thèmes de l’exploitation et de la destruction de la nature, de la soumission à une orientation économique synonyme d’un confort discutable en lui-même et dans ses conséquences, ainsi qu’à la dénonciation de la collusion entre économie et tourisme qui conduit à une hypocrite défense de la nature. En réalité, l’originalité du diagnostic leopoldien sur la genèse du mal moderne dans nos rapports à l’environnement réside dans l’articulation de cette critique du progrès, au sein d’une anthropologie écologique, avec le thème de l’oubli de la terre.
L’oubli de la terre, c’est en fait l’inconscience de nos liens de dépendance aux êtres vivants ainsi qu’aux ressources abiotiques. Cette inconscience est un oubli, car les liens sont là mais inaperçus. C’est un oubli, car Leopold l’interprète comme un effet du temps et de la modification historique de nos modes de vie. C’est un oubli, car une réminiscence est possible.
La civilisation a tellement brouillé cette relation homme-terre élémentaire à coups d’accessoires et d’intermédiaires que la conscience que nous en avons s’estompe. Nous nous figurons que l’industrie nous fait vivre, oubliant ce qui la fait vivre. Il fut un temps où l’éducation rapprochait du sol au lieu d’en éloigner8.
Ici, l’aliénation ne vient pas tant du travail, de la dure vie de labeur, que de la consommation qui se réalise au quotidien, jusque dans la possibilité du loisir. Leopold a des mots ironiques aussi bien envers le joueur de golf que le randonneur. Si le premier risque de « mourir d’ennui » dans une nature où il ne peut utiliser ses clubs, le second ne marche qu’à coup d’espoirs d’un « panorama »9. « Il [l’homme moderne] n’a aucun rapport vital »10 avec la terre et Leopold s’afflige de la facticité des liens produits par le prétendu progrès. Le mal n’est donc pas seulement fait des conséquences du progrès en termes de destruction ou de pollution de la nature. Sa racine est à trouver dans la manière dont une prétendue civilisation falsifie l’homme en en faisant un individu. Le mal est ainsi le mot qu’on peut employer pour caractériser ce gauchissement de l’homme qui ne voit plus ses liens de dépendances qui le caractérisent, qui le tissent, qui impliquent de la gratitude autant que la conscience de sa vulnérabilité.
D’un point de vue culturel, le progrès authentique serait alors anamnèse des liens à la terre par la valorisation de toutes les expériences qui la permettent. Dans la perspective de Leopold, il s’agirait tout autant de la découverte de ce que nous sommes (anthropologie) que de ce à quoi nous devons accorder de la valeur (éthique). D’un point de vue individuel, il faut sortir de la cécité dans laquelle nous plongent la sécurité et le confort prodigués par la culture. D’une certaine manière, notre rapport au monde est devenu extrêmement pauvre, il est, si je puis dire, infra-technique. Là où le bûcheron voit un certain nombre de stères de bois quand il coupe un arbre, beaucoup d’hommes ne voient même pas l’arbre, ne font même pas la différence entre un chêne et un érable, encore moins entre un chêne rouvre et un chêne pédonculé. Qui sait alors quelles niches écologiques abritent les chênes pédonculés et de quels liens écologiques ils sont eux-mêmes les supports ? Si Leopold caractérise bien l’homme par la capacité réflexive liée à sa conscience, par sa capacité à connaître le monde dans lequel il agit, force est de constater que ce monde est celui de la technique où l’environnement biotique et abiotique risque d’être profondément altéré du fait qu’il soit toujours déjà transformé pour être prêt à être consommé, dans une pure jouissance. Ce monde quotidien de la consommation serait en fait pauvre en savoir-faire (du point de vue de l’usager) qui auraient au moins le mérite de mettre en contact avec autre chose que des objets techniques. En acceptant la leçon de Leopold, le progrès crée un monde d’où la conscience de nos liens aux êtres vivants non-humains et au milieu abiotique s’amenuisent. En d’autres termes, le progrès oblitère le monde naturel. S’acharnant sur la figure du touriste, Leopold affirme qu’« il [le chasseur de trophée] est la fourmi motorisée qui envahit les continents avant d’apprendre à voir son propre jardin, qui consomme les plaisirs de plein air sans jamais rien apporter en retour »11.
D’une certaine manière, l’homme est bien un homo faber mais, selon Leopold, cela ne nous distingue pas essentiellement du reste de la nature. Comme les autres espèces, « tous, nous nous évertuons à nous assurer prospérité, confort, longue vie et ennui »12. Il est clair que le moyen de l’homme pour y parvenir est la technique et que la modernité réside dans son extrême efficacité qui est notamment produite par la collusion avec la science. C’est alors que Leopold valorise la réussite à atteindre ces objectifs dans la mesure où cela est « peut-être même nécessaire à une réflexion objective »13. Faber ne doit donc pas passer pour la finalité essentielle de l’homme. On voit Leopold nous inviter à renouer avec la définition de l’homme comme homo sapiens, avec un idéal d’humanité impliquant une forme de connaissance et de sagesse. Certes, les liens modernes science-technologie-industrie-économie-politique sont structurants du prétendu progrès. Cependant, l’Almanach montre que la science ne doit pas être subordonnée aux finalités techniciennes et qu’on peut espérer délier les liens qui enserrent l’activité scientifique pour retrouver la valeur de ce qu’un progrès inauthentique risquerait d’oblitérer.
Faussement simpliste, la pensée de Leopold invite alors à distinguer cet espoir placé dans la science de son incarnation dans la figure de l’ingénieur ou du professeur d’université. Il ne s’agit nullement d’accabler de toutes les responsabilités l’ingénieur mais de remarquer qu’il symbolise l’exigence de transformation modernisatrice sous les ordres de l’économie et de la politique. Là où l’ingénieur se soucie peu « d’une espèce en plus ou en moins »14, le professeur se spécialise dans l’étude de tel ou tel domaine de la biologie, de telle ou telle espèce, ce qui l’empêche alors souvent de contempler l’ensemble des liens qui tissent les réseaux biotiques et abiotiques15. Pourtant, Leopold affirme :
[L]a science apporte au monde des bienfaits tant moraux que matériels. Sa grande contribution morale est l’objectivité, ou point de vue scientifique. Cela veut dire douter de tout hors les faits ; cela veut dire s’en tenir strictement aux faits et sans se soucier des conséquences16.
Leopold ne valorise pourtant pas l’objectivité pour elle-même mais demande implicitement à quels faits elle est associée. Les faits qui intéressent Leopold sont les relations constitutives de la terre (land). Ils sont d’ordre écologique et c’est dans ce cadre qu’on peut comprendre la valorisation de Darwin qui replace l’homme au cœur de l’évolution des réseaux vivants.
Dans le darwinisme se jouent à la fois la réalisation d’un idéal d’humanité dans l’acquisition d’une connaissance sur la nature et la possibilité pour la connaissance d’être synonyme d’une rénovation de la conscience de nos liens à la terre et de ce que nous sommes en tant qu’hommes. Pour reprendre une expression de Leopold, il s’agit ici d’un des « nutriments culturels disponibles pour notre enracinement dans la nature »17 :
Ce nouveau savoir aurait dû, depuis le temps, nous donner un sentiment de parenté avec les autres créatures, un désir de vivre et laisser vivre, un sentiment d’émerveillement devant la magnitude et la durée de l’entreprise biotique18.
Quand il s’agit de penser le progrès, il faut donc différencier les sciences, non par leurs différences éventuelles d’objectivité, mais par les conséquences éthiques et anthropologiques dont leur objectivité est porteuse. Ainsi, Leopold ne voit pas dans le darwinisme une relativisation absolue de la place de l’homme dans l’odyssée de l’évolution des espèces. Cette relativisation reviendrait à dire qu’il n’y a pas de mal dans ce que fait l’homme, car l’homme est une espèce parmi les autres et son attitude n’est que le résultat des lois de l’évolution. Au contraire, Leopold lit l’originalité du darwinisme comme la mise en valeur théorique du concept de relation et comme la possibilité pour l’homme de découvrir, avec gratitude et respect, la richesse des liens de dépendance qui rendent sa vie possible. De plus, sans ramener le problème éthique uniquement à la prise en compte du mal causé à l’homme dans nos actions contre l’environnement, Leopold invite à donner une valeur morale à la nature elle-même, faite de liens infiniment complexes qui sont le résultat de milliards d’années d’évolution, qui ne tournent pas uniquement autour de nous. La spécificité de l’homme est donc moins technicienne qu’éthique. Elle réside dans la capacité à « pleurer l’extinction d’une autre espèce »19. Il y aurait donc un mal non anthropocentré. Leopold fait comprendre que c’est un mal, car il implique une responsabilité liée à son origine anthropique et au fait que l’homme a la capacité d’en avoir conscience. Le progrès authentique serait donc moral et aurait pour point de départ la reconnaissance de l’existence du mal commis envers l’environnement ou, plus exactement, envers « la communauté biotique ».
Si l’Almanach d’un comté des sables est indiscutablement un classique de la littérature en éthique environnementale, il faut reconnaître que les travaux de Callicott visant à systématiser la pensée de Leopold ne sont pas étrangers à cette renommée. De manière tout à fait convenue, il faut rappeler que Callicott fait explicitement et massivement référence à Leopold. L’enjeu est de systématiser une éthique ancrée dans une réflexion partant de la gestion des ressources pour l’homme mais qui se déplace vers la prise en compte normative de l’environnement pour lui-même.
Callicott reproche à l’histoire occidentale de la philosophie morale de contribuer à une impossibilité théorique de rénover nos rapports à la nature et de comprendre la portée éthique du mal produit par l’homme20. La raison invoquée est celle de l’anthropocentrisme qui caractérise notamment la morale kantienne et les différentes formes d’utilitarisme21. Dans l’anthropocentrisme moral, l’environnement (constitué par tous les liens entre les animaux, les végétaux et les ressources abiotiques) n’a aucune valeur morale en soi, car il n’est considéré que comme un intermédiaire entre des hommes qui sont seuls porteurs d’une valeur intrinsèque (soit en tant que personne rationnelle, soit en prenant en compte l’utilité pour l’individu ou la société).
Chez Callicott, la référence à Leopold sert alors à trouver une alternative à cet anthropocentrisme en définissant la nature à partir du concept et de l’expérience de relation. De plus, la nature n’est pas alors opposée à la culture, à l’homme. Il s’agit bien de reconnaître la nécessaire intégration de l’homme à la nature, aussi bien comme résultat d’une évolution, que par ses dépendances et comme cause de nombreuses modifications. L’homme appartient bien au réseau de relations écologiques et c’est ce qui va permettre de fonder une éthique à condition que la science décrivant ces relations puisse avoir une portée axiologique.
Dans ce contexte, il faut revenir sur une distinction assez classique pour comprendre l’originalité du geste de Callicott consistant à fonder l’éthique par la science. Il est en effet commun d’affirmer que l’étiquette « écologie » est ambiguë. Elle est utilisée de manière problématique à la fois pour caractériser une science et des engagements individuels et/ou politiques visant une défense de la nature et impliquant par conséquent des jugements de valeur sur ce qui est à protéger et sur les moyens à employer. Conformément à une conception souvent admise et fondée sur la distinction entre l’être et le devoir être, l’écologie comme science devrait être pensée comme une entreprise de connaissance de la nature qui ne devrait pas déterminer les préoccupations éthiques et/ou politiques des hommes. Classer, décrire, expliquer, prédire, autant d’idées assez classiques qu’on prétend associer à la neutralité axiologique du savant. Dans ces conditions, le lien entre l’éthique et l’écologie comme science ne devraient être qu’un lien non essentiel, un lien d’information instrumentale. Il serait possible de s’adresser aux scientifiques pour leur demander quels moyens semblent les plus adaptés pour répondre à des fins déterminées par ailleurs. Par exemple, Möbius – qui est souvent cité pour son introduction du concept de biocénose (1877) – incarne l’étude d’un lien entre économie humaine et écologie. Dans ce cas, en affirmant la dépendance d’une économie de production ostréicole vis-à-vis de conditions écologiques, il y a une possibilité pour l’écologie scientifique de devenir un instrument puissant au service de finalités humaines pourtant extérieures à un système de connaissances objectives22.
Quoiqu'attrayante, cette séparation des rôles est notamment discutée par Callicott23. Il tente de justifier une fondation de l’éthique sur l’écologie scientifique en questionnant la portée axiologique qu’il est possible de donner, comme le fait Leopold, à des concepts comme ceux d’intégrité ou de stabilité de la communauté biotique. Leopold était indéniablement un scientifique. Il a été formé à la foresterie à Yale, a contribué au département de la recherche du US Forest Service, a publié de nombreux articles ayant une dimension écologique dans des revues scientifiques et a enseigné à l’Université sur une chaire de gestion du gibier au sein d’un département d’économie agricole. Pour Callicott, il s’agit alors d’approfondir le lien inauguré par Leopold entre la science et l’éthique en montrant comment l’écologie a une valeur normative qui permet de déterminer des fins souhaitables et des devoirs s’imposant aux hommes mais n’ayant pas nécessairement pour objet l’utilité pour l’homme.
Pour ce qui est de l’histoire de l’écologie, une des sources explicites de Callicott est l’ouvrage de Worster24. Il y trouve la tendance historique de l’écologie à défendre un holisme impliquant une « étude des relations des organismes entre eux et avec leur environnement naturel »25. Cela suppose une subordination des individus à un ensemble qui est caractérisé par des relations. La succession historique qui intéresse Callicott et dans laquelle s’intègrent les écrits de Leopold est la suivante :
le modèle organiciste de Clements et Forbes ;
le modèle communautaire d’Elton ;
la modification du modèle communautaire par Tansley : l’écosystème et sa caractérisation par la circulation énergétique.
Travaillant sur l’évolution des expressions des thèses de Leopold, Callicott remarque le passage de l’usage de la métaphore organiciste à celle de la communauté. Il fait l’hypothèse d’une attention par Leopold aux changements de « paradigmes théoriques »26 de l’écologie de l’époque. Cela serait aussi en lien avec une réflexion sur les potentialités éthiques offertes par les métaphores de l’organisme et de la communauté. La métaphore de l’organisme induit aisément l’usage des concepts descriptifs et normatifs de maladie et de santé. Leopold ne se prive pas d’exploiter cet aspect et il fait explicitement la comparaison avec la santé humaine et la médecine. On retrouve ici la critique du progrès, mais sur la base d’une production de maux dans les écosystèmes. En revanche, ces concepts ne sont plus des caractéristiques associées à la métaphore de la communauté (sauf à penser encore celle-ci comme un organisme). Callicott montre alors que ce modèle de la communauté « convenait mieux aux implications morales de l’histoire naturelle de l’éthique sociale de Darwin et de celle des sentiments de Hume »27. La référence à Darwin chez Leopold a déjà été mentionnée pour fournir le modèle d’une science ayant une portée éthique grâce au regard qu’elle nous permet de porter sur l’humanité et nos liens biotiques et abiotiques. Pour Callicott, la référence à Darwin (en particulier La Filiation de l’homme de 1871) se prolonge dans l’idée d’une fondation de l’éthique par la science. L’accent est ici mis sur la manière dont la théorie de l’évolution est censée expliquer la valeur adaptative d’une morale dépassant l’égoïsme pour mettre les comportements individuels au service du bien de la communauté (qui maximise la possibilité reproductive)28. L’enjeu éthique est alors de penser l’extension de la communauté à laquelle nous appartenons afin d’étendre (et non de remplacer) les devoirs qui nous incombent :
Une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste si ce n’est pas le cas29.
Le risque de l’usage des métaphores d’organisme et de communauté est de retrouver dans une éthique fondée à partir de la science ce qui avait été mis dans les théories scientifiques à partir du langage courant. Il faut clarifier le sens et la portée éventuellement heuristique de ces concepts dans l’histoire de l’écologie pour être certain qu’il n’y a pas une contrebande des valeurs. Callicott n’est pas dupe de cette difficulté. Il précise explicitement que l’intérêt du concept d’écosystème pensé par Tansley est justement d’être résolument non métaphorique. Leopold aurait alors saisi la caractéristique fondamentale d’un écosystème : être une circulation d’énergie.
Du point de vue de l’histoire de l’écologie, toute la difficulté est alors de déterminer les caractéristiques des circulations d’énergie pour savoir s’il y a un sens à parler d’intégrité et de stabilité. À nouveau, Callicott reconnaît dans l’écologie contemporaine les débats autour de l’existence d’états stables des écosystèmes. En prenant en compte différentes échelles de temps, les écosystèmes sont plus ou moins radicalement soumis aux changements. Dans ces conditions, quels devoirs pourrions-nous avoir envers un écosystème ? Contrairement à une logique de préservation de la nature qui considèrerait de manière mythique l’existence d’un état pré-humain stable à retrouver ou à maintenir, il s’agirait plutôt de déterminer, grâce à l’écologie, des critères qui seraient souhaitables pour un écosystème. C’est le sens de l’argumentation utilisant les concepts d’« intégrité » et de « stabilité ». On voit que l’enjeu est de leur donner un contenu scientifique concret et normatif précis sachant que l’intérêt spéculatif est de fonder une valeur qui ne soit pas dépendante des intérêts humains. Le même problème surgit quand Callicott utilise l’idée de « santé écologique » pour remplacer « l’idée conventionnelle de nature sauvage » (Éthique de la terre). Par exemple, Antoine Corriveau-Dussault consacre de précieuses analyses au rôle de l’hypothèse diversité-stabilité et les tentatives de définitions conceptuelles de la santé écosystémique30. Il serait ici trop long d’entrer dans le détail de toute l’entreprise de justification de l’éthique environnementale à partir de la science. Cependant, l’idée de santé écologique prolonge la possibilité de donner un sens à un mal écologique qui réside dans les actions humaines qui conduisent les écosystèmes à être « malades » et non d’un mal qui se concentrerait uniquement sur les effets subis par l’homme.
L’idée d’un mal moral touchant l’environnement peut se comprendre dans la conception éthique de Leopold systématisée par Callicott. Cependant, ce geste a régulièrement été critiqué. Outre la discussion théorique de la légitimité du passage de l’être au devoir être impliqué par le fondement scientifique31, ce qui précède a déjà montré les difficultés et les enjeux d’une éthique exploitant des concepts et métaphores scientifiques. Cela révèle le risque que l’éthique emporte avec elle tous les problèmes épistémologiques sur la vérité, l’ontologie et la méthodologie de la science. Par exemple, la difficulté est de montrer que ce que dit Leopold n’est pas historiquement et contextuellement limité32, mais qu’il y a bien une interprétation possible de la science écologique donnant une valeur universelle et nécessaire à l’éthique de la terre33. Sans cela, la prise au sérieux d’une histoire de l’écologie conduirait au risque d’historicisation de l’éthique et donc à une forme de relativisme. La position de Callicott est de courir le risque de cette fondation à partir de la science, car ce serait la seule fondation rationnelle possible, mais en assumant que le travail des philosophes est de rester en contact avec les développements de la science pour vérifier que « les piliers fondamentaux d’une vision du monde évolutionniste (et écologique) restent intacts »34.
De surcroît, le postmodernisme de Callicott, justifié par l’affirmation d’une responsabilité de la philosophie et d’une vision du monde occidentales modernes dans la cécité face à la valeur intrinsèque de la nature, a été attaqué soit comme étant hypocrite, soit comme étant synonyme d’un « fascisme environnemental ».
Callicott s’est efforcé de répondre précisément à l’accusation de « fascisme » pour montrer qu’elle est malhonnête, au sens où son holisme n’exclut pas la prise en compte des droits de l’homme et ne les subordonne pas à la sauvegarde des écosystèmes35. Au contraire, toute la richesse théorique de l’œuvre de Callicott réside dans la détermination, l’extension et l’articulation de nos différents devoirs36.
L’accusation d’hypocrisie postmoderne est plus sérieuse, car cela touche le sens du geste opéré par Callicott afin de pouvoir penser l’existence d’un mal non anthropocentré. En effet, la fondation scientifique de l’éthique peut paraître comme le symptôme d’une incapacité à sortir d’un modernisme qui place une foi démesurée et parfois aveugle dans l’objectivité scientifique. L’histoire de l’écologie, sa tendance à la mathématisation de la nature, ses liens avec certains modèles de scientificité issus de la physique, ses connexions avec la technique et l’économie peuvent être lus comme la continuation d’une modernité ayant contribué à l’exploitation de la nature. Toutefois, Callicott assume un projet moral universaliste qui ne peut être tel qu’en tant qu’il est rationnel. Or, c’est dans la science qu’il voit le développement de la raison humaine et la capacité à dépasser, sans les nier, la diversité culturelle37. Ainsi, son postmodernisme qualifie plutôt la rupture avec l’anthropocentrisme métaphysique et moral qui nous empêche de ressentir la valeur intrinsèque de la nature38. Toutefois, ce postmodernisme n’implique pas nécessairement une remise en question du ratiocentrisme lié à la fondation de l’éthique et il n’exclut pas non plus une certaine forme d’anthropocentrisme dans « une perspective désintéressée, analytique et scientifique » qui réduit les systèmes de moral à un ensemble d’avantages évolutionnistes liés à « la survie, à l’épanouissement et à la reproduction des individus et des communautés »39.
En ce sens, la philosophie environnementale de Callicott a indéniablement ouvert des discussions et un champ de recherche extrêmement féconds. La tentative de fondation scientifique permet d’envisager un sens rationnel à l’idée d’un mal moral et écologique produit par l’homme. Toutefois, en se concentrant sur le fondement scientifique, le risque est de minorer le concept de beauté dans l’impératif catégorique leopoldien affirmant qu’« une chose est juste lorsqu’elle tend à préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste si ce n’est pas le cas ». Cependant, il ne faudrait pas croire que Callicott néglige l’expérience de la beauté. Ainsi, une compréhension de l’idée de mal à l’encontre de la nature suppose d’explorer cette dimension esthétique pour comprendre comment elle permet un décentrement vis-à-vis d’un mal qui ne serait compréhensible que dans son lien à l’homme.
Parmi les trois critères liés à la justice dans nos comportements au sein de la communauté biotique, la beauté semble d’emblée le plus problématique dans le cadre d’une fondation scientifique de l’éthique et de la compréhension de ce que pourrait être un mal touchant l’environnement. En effet, ce critère paraît plutôt impliquer une fondation extra scientifique de l’impératif éthique. En réalité, Callicott affirme qu’il y a une « axiologie environnementale » dans laquelle l’éthique et l’esthétique sont « complémentaires »40. Toutefois, il semble qu’il ne s’agisse pas d’une complémentarité « égalitaire » mais d’une forme au moins partielle de subordination.
Un problème traditionnel dans le fondement de l’éthique est celui de l’opposition entre raison et sentiment. Un argument central convoqué par Hume est la faiblesse de la raison pour provoquer l’action conforme au devoir. Il s’agit d’une forme particulière du constat de l’akrasia, de la faiblesse de la volonté dans laquelle je vois le bien, je le veux, mais ne le fais pas. Ainsi, une volonté éclairée de manière rationnelle ne suffirait pas à mouvoir l’homme41. Il faut remarquer qu’avec la beauté, la stratégie de Callicott implique la prise en compte d’une expérience sensible puissante pour fonder l’éthique, mais qui est finalement encore rattachée à l’écologie comme science.
L’argument central est qu’il est impossible de regarder l’expérience esthétique comme une spontanéité absolue de la part du sujet qui fait l’expérience. Autrement dit, l’expérience esthétique est culturellement orientée, elle est construite même si cette construction n’est pas nécessairement consciente et réfléchie. C’est ainsi que Callicott propose une critique du concept de paysage, car ce dernier contribue à déterminer traditionnellement le regard du spectateur à partir d’une pratique picturale jugée culturellement problématique pour ses conséquences éthiques. Rappelons que Leopold ironise au sujet du randonneur qui ne prend du plaisir dans la nature qu’au moment de la contemplation du « panorama ». Callicott approfondit cette critique en remarquant que le beau paysage, celui qui mérite d’être peint ou celui qu’on est habitué à voir en peinture, serait synonyme d’un privilège indu à un des sens, à une vue ouverte, au grandiose de ce qui est rare et souvent lointain. Il y aurait là une conception de la nature oublieuse de ce qui est ordinaire, des relations qui constituent la trame du vivant et qui impliquent une expérience esthétique, parfois pénible et dévalorisée, supposant une immersion par tous les sens. Callicott écrit alors quelques pages poétiques sur la solidarité entre la grue et les marais pour montrer qu’on ne peut pas, de manière cohérente, aimer l’une sans l’autre. Callicott attire alors l’attention sur une référence assez libre à Kant chez Leopold, qui est connectée à la possibilité de ressentir le mal produit par la perte d’une espèce :
Il est facile de dire que la perte n’est qu’une vue de l’esprit, mais y a-t-il un écologiste sérieux pour acquiescer ? Celui-ci sait parfaitement bien que s’est produite une mort écologique dont la portée est inexprimable dans les termes de la science contemporaine. Un philosophe a nommé cette impondérable essence le noumène des choses matérielles. Cela s’oppose au phénomène, qui lui est pondérable et prévisible, cela jusqu’aux mouvements de la plus lointaine étoile.
La grouse est le noumène des forêts septentrionales, le geai bleu est celui des bosquets de pacaniers, le mésangeai celui des fondrières de mousses, le geai des pinèdes, celui des genévriers poussant sur les contreforts. Les ouvrages d’ornithologie ne rendent pas compte de ces réalités. Il faut croire qu’elles sont nouvelles pour la science, quoique évidentes pour le scientifique doué de discernement42.
Cet usage du kantisme pourrait paraître assez curieux et très hétérodoxe à un historien de la philosophie. L’analytique des principes de Kant est sur ce point remarquable43. Kant refuse explicitement l’usage, qui est fait par les « Modernes », de la distinction entre mundus sensibilis et mundus intelligibilis, car elle implique, selon lui, une incompréhension de la portée de la science. C’est l’exemple de l’astronomie qui permet à Kant d’expliciter le mauvais usage de cette distinction. Selon eux, l’astronomie théorique serait « la simple observation du ciel étoilé » (et correspondrait au mundus sensibilis), alors que l’astronomie contemplative serait la détermination, par l’entendement, des lois de ce qui était, avant elle, simplement observé. L’observation sensible serait donc ici opposée, par les « Modernes », à la compréhension des lois. Selon eux, cette ultime étape permettrait de définir le mundus intelligibilis, c’est-à-dire le monde tel qu’il est appréhendé par l’esprit à travers la connaissance des lois qui gouvernent la nature. Pour le philosophe de Kœnigsberg, l’erreur est ici de croire que le savant obtient une connaissance de la chose en soi lorsqu’il possède la connaissance des lois de la nature. L’astronome, fût-il Copernic ou Newton, ne s’émancipe pourtant pas de la sensibilité (et notamment des formes que sont l’espace et le temps), pas plus que sa connaissance des lois ne s’émancipe de la détermination catégoriale de l’entendement. Ainsi, toute connaissance de la chose en soi est exclue et c’est ce qui en fait un authentique « noumène ».
Leopold voit que « le phénomène, qui lui est pondérable et prévisible, [s’étend] jusqu’aux mouvements de la plus lointaine étoile ». Le décalage avec le kantisme apparaît en identifiant le noumène à l’ « impondérable » et non à l’inconnaissable. Toutefois, ce décalage est lourd de conséquences et il est souhaitable de ne pas évaluer le texte de Leopold à partir de sa fidélité à la distinction kantienne, mais plutôt de comprendre la fécondité de son déplacement. Si l’originalité de Kant est de permettre de penser un authentique noumène duquel on ne peut rien connaître, il faut remarquer qu’il y a toute une tendance dans la réception de Kant à mettre de côté cet authentique noumène qui est alors considéré comme un concept vain. Si on ne peut pas le connaître, pourquoi maintenir cet horizon inatteignable qu’est le noumène ? Pour Leopold, le noumène est réinterprété comme impondérable, il n’est donc pas mesurable, mais il n’est plus inconnaissable. Implicitement, Leopold refuse l’identification stricte entre l’acte de connaître et une science elle-même réduite à une activité de mesure et à la possibilité d’une mathématisation des lois. Certes, il reconnaît que l’ornithologie telle qu’elle se fait à l’époque empêche une connaissance nouménale, mais l’expression connaissance nouménale n’est plus paradoxale. Tant que l’ornithologie permet l’identification d’un oiseau et de ses caractéristiques spécifiques, elle est, pour Leopold, largement insuffisante. Ce qui lui manque est la connaissance détaillée des comportements et des relations écologiques. Le concept de noumène est ainsi solidaire de l’ontologie écologique de Leopold qui est centrée sur les relations constitutives de la terre (land) et sur les transmissions d’énergie en son sein. L’usage que Leopold fait du noumène répond donc à une logique du dévoilement dont certaines sciences sont une des modalités. Sur ce point, il a été remarqué que la référence à Kant chez Leopold trouverait sa racine chez Henry David Thoreau et chez le philosophe russe Piotr Ouspenski44. Or, c’est probablement chez Ouspenski que Leopold trouve cette idée que le vivant peut être interprété comme noumène.
Ce qui est dès lors original est la nécessité pour nous de changer de regard sur l’homme et sur toutes les espèces pour privilégier le concept de relation écosystémique et de toutes ses modalités. Il y va de la redéfinition de tout individu par la prise en compte des relations qui constituent son identité, font ses dépendances, ses opportunités et ses périls. En affirmant que la « grouse est le noumène des forêts septentrionales », Leopold donne l’exemple d’une compréhension de la nature qui passe non par la mesure en poids ou en nombre du gibier, mais par la connaissance des relations qui font la vie d’un milieu. Ainsi, la disparition de la grouse est un mal dont l’homme est moralement responsable.
Le sentiment de beauté de la nature est ainsi à comprendre à travers ce décillement, ce dévoilement des relations écologiques. Ainsi, je peux voir la beauté de la nature à travers mes préjugés, hérités notamment de la dimension picturale du paysage. Cependant, si l'on pousse la logique de l’argumentation à bout, il n’est peut-être pas absurde de dire que cette expérience de la beauté est fausse au sens où elle serait inadéquate à la réalité naturelle qui est constituée des relations écologiques. Pour Callicott, qui systématise la perspective de Leopold, l’écologie comme science joue un rôle « transcendantal » en informant mon expérience sensible et en m’apprenant à voir, ou mieux, à sentir complètement la beauté naturelle là où je l’ignorais jusqu’à présent. Produisant une expérience sensible puissante et porteuse d’un sentiment de respect désintéressé, il y a alors une dimension morale non utilitariste et non-anthropocentrée dans ce rapport écologique à la nature. C’est en ce sens que la disparition d’une espèce pourrait être l’objet non seulement d’une compréhension du mal subi par l’environnement, mais aussi d’un sentiment profond de révolte ayant sa source dans une expérience esthétique mutilée de la nature dont la souffrance humaine n’est pas l’origine.
Callicott voit que la fondation de l’éthique par la science risque de mener à une morale élitiste réservée à ceux qui ont des connaissances scientifiques. Cette critique semble également toucher l’esthétique environnementale qui vient d’être esquissée au sens où elle implique une dimension cognitive forte en faisant reposer l’expérience sensible du beau sur des connaissances écologiques. Ainsi, faut-il être savant et philosophe pour comprendre et sentir où se situent le bien et le mal ? Utilisant une fois de plus Leopold, Callicott dément cet élitisme en affirmant qu’avoir un doctorat en écologie ne signifie pas nécessairement être sensible à la beauté de la nature ordinaire45. Il faut rappeler ici les remarques critiques que Leopold fait à l’encontre du professeur d’université spécialisé dans l’étude d’un seul « instrument » de la biologie et de la zoologie au mépris de l’étude de l’harmonie d’ensemble fournie par le vivant. Leopold remarque encore ironiquement qu’un scientifique peut être complètement aveugle à la valeur de ce qui lui est proche pour aller explorer et disséquer un élément lointain valorisé par la science.
Bien sûr, la science peut produire des sentiments. Le thème de la beauté de la nature dont prend conscience le savant est récurrent et correspond à un fait indéniable qui n’est pas simplement rhétorique. Cette beauté est à la frontière entre un sentiment de type « platonicien », c’est-à-dire la satisfaction éprouvée dans une mathématisation et/ou une connaissance théorique de l’ordre naturel, et l’admiration provoquée par l’expérience de la diversité, du foisonnement des formes et des qualités, de l’apparence d’irréductibilité à nos entreprises théoriques, c’est-à-dire la conscience d’une transcendance, d’un toujours déjà plus que ce que nous mettons en ordre. Ce qu’ajoute la référence à Leopold est alors la conscience éthique fondamentale des relations complexes et souvent insoupçonnées qui structurent la nature. Ce concept de relation serait alors fondé par l’écologie comme science qui en étudierait les modalités réelles et en attesterait la pertinence. Toutefois, il serait possible d’accéder à une perception des relations naturelles suffisante d’un point de vue de la pratique éthique sans avoir des connaissances écologiques spécialisées.
La place du sentiment en éthique est évidente chez Leopold et apparaît notamment dans son style. Le style de l’Almanach est poignant et il fait écho à d’autres auteurs américains comme Henry David Thoreau ou John Muir. L’idée même d’une écriture de la nature va dans le sens d’une dynamisation du sentiment de respect envers la nature qui associe l’expérience du beau au bien et celle de la laideur au mal. En cela, l’œuvre littéraire, autant que la science, a pour but de transformer nos rapports esthétiques à la nature. Toutefois, une esthétique environnementale authentique peut difficilement se faire sans une immersion réelle dans la nature. Pour Leopold, ce qui donne sens à l’éthique est son vécu, son expérience, notamment de la wilderness et de sa disparition sous les coups d’un prétendu progrès. Ainsi, la rénovation de la conscience morale donnant du sens à l’idée du mal touchant l’environnement ne peut se produire que dans une activité qui met en contact l’homme avec la diversité des formes naturelles. Est-ce possible dans un monde qui oublie la terre ?
Certes, sous certaines conditions, les sciences peuvent être des « nutriments culturels » pour une telle rénovation. Cependant, l'Almanach de Leopold permet de recentrer l’éthique de la terre sur un ensemble d’expériences vécues par un sujet et qui peuvent impliquer une réflexion sur les relations qui tissent le monde vivant, le land, et qui nous tissent en contribuant à notre identité.
J’ai lu de nombreuses définitions de ce qu’est un écologiste, et j’en ai moi-même écrit quelques-unes, mais je soupçonne que la meilleure d’entre elles ne s’écrit pas au stylo, mais à la cognée. La question est : à quoi pense un homme au moment où il coupe un arbre, ou au moment où il décide de ce qu’il doit couper ? Un écologiste est quelqu’un qui a conscience, humblement, qu’à chaque coup de cognée il inscrit sa signature sur la face de sa terre. Les signatures diffèrent entre elles, qu’elles soient tracées avec une plume ou avec une cognée, et c’est dans l’ordre des choses46.
S’ensuit un très beau texte dans lequel Leopold relate son expérience de l’abattage d’un arbre pour en faire du bois de chauffage. Cet arbre était déjà mort, ce qui n’est pas anodin relativement à ce qu’on décide de prélever de la terre pour son besoin en chauffage. Au moment de le couper, chaque coup de scie et de hache à travers les stries du chêne est l’occasion pour Leopold de penser à leur signification historique. Cet arbre était là et adulte alors que les premiers colons sont passés à côté de lui et se sont établis dans la région. Cette méditation est un hommage respectueux en même temps qu’une reconnaissance des relations que cet arbre a eues avec les événements climatiques et avec les autres espèces vivantes.
Remarquons combien cette expérience de Leopold l’éloigne, dans le fait identique d’être chauffé, de l’expérience quotidienne consistant à allumer le radiateur. Leopold exploite cette opposition pour thématiser l’idée d’oubli de la terre dont il a été précédemment question. Moins concentré sur le problème du fondement scientifique de l’éthique environnementale, cet exemple fait naître le souci de savoir quelles expériences esthétiques fondamentales nous vivons ou pourrions vivre, qui constitueraient une sorte de dévoilement de la nature pour endiguer les maux très concrets que nous éprouvons. En effet, les expériences esthétiques et éthiques en première personne ont le mérite de ne plus être des préceptes abstraits et permettent de rompre avec des pratiques qui invisibilisent le mal touchant l’environnement quand il est indépendant des conséquences sensibles sur l’homme.
L’expérience du mal liée à la disparition de la wilderness est une source de l’éthique de Leopold, mais il faut reconnaître qu’elle est culturellement déterminée47 et qu’elle risque même d’être vue comme un mythe. Il ne s’agit pas de nier la nécessité d’espaces protégés. Cependant, ce qui permet de donner du sens à l’expérience d’un mal moral touchant l’environnement consiste à rechercher des expériences quotidiennes dans lesquelles l’éthique peut retrouver le sens d’une transformation de soi dans la réflexion sur les relations éprouvées qui constituent la nature à laquelle nous appartenons48.
L’attention à la nature ordinaire n’est pas exclue, loin de là, de l’Almanach. Pour revenir à l’exemple de l’abattage de l’arbre, c’est l’exemple même d’une pratique qui pourrait être réduite à un geste technique simplement reproduit de manière mécanique. Pourtant, Leopold médite sur cet acte dans une attitude éthique qu’il cultive et qui suppose une transformation de soi, une collaboration de notre sensibilité et de notre raison, la conscience de la vulnérabilité, du doute, de la responsabilité. Abattre un arbre dans l’attitude éthique dont Leopold fournit l’exemple pousse à questionner nos droits envers ce sur quoi on agit, à se mettre en péril en doutant de nos représentations morales les mieux établies, comme la distinction entre chose et personne qui, d’habitude, sert à attribuer une valeur morale.
L’écriture de Leopold flirte souvent avec l’anthropomorphisme. Toutefois, il ne s’agit pas ici d’une critique, mais plutôt de reconnaître que son style vise à questionner, brouiller, voire modifier, les représentations du lecteur. Il ne s’agit pas d’une absurdité conceptuelle, à condition de rompre avec l’association personne/raison. La première partie a montré que Leopold ne cherche pourtant pas à gommer toute différence entre l’homme et l’animal, entre l’homme et les végétaux. Cependant, étendre la valeur morale au-delà de l’humanité suppose de se concentrer sur ce concept de personnalité que Leopold centre plutôt sur la singularité. Il utilise plusieurs fois le concept de personne ou de personnalité pour parler de certaines plantes et animaux49. À chaque fois, l’enjeu est de signifier une modification dans la prise en compte d’une espèce ou d’un individu. Il s’agit d’une transformation de la conscience humaine due au passage de l’ignorance à une forme de connaissance, voire de reconnaissance. Attribuer ainsi la personnalité à une plante, à un animal, ou même à une espèce, ce n’est pas lui conférer une volonté libre, rationnelle et moralement autonome. À nouveau, il ne s’agit pas d’aligner le pissenlit sur l’être humain ou de revendiquer la possibilité de parler de meurtre lorsqu’un arbre est abattu. Loin d’impliquer une réflexion caricaturale, Leopold utilise le concept de personne pour certains êtres vivants afin de montrer qu’il s’y joue une attitude visant à commencer à s’intéresser à eux, pour eux-mêmes (c’est-à-dire sans prise en compte de nos intérêts), à reconnaître leurs singularités (leurs histoires, leurs comportements, leurs liens) et finalement à leur attribuer une valeur intrinsèque qui fonde la nécessité d’assumer la responsabilité de tout acte à leur encontre. Concernant l’exemple du chêne coupé par Leopold, il reconnaît à ce chêne une sorte de personnalité qui le conduit à de la gratitude quand le chêne mort, coupé et débité, rencontre finalement le besoin de chauffage de Leopold. Ce n’est peut-être pas un remerciement adressé au chêne, mais au moins un état d’esprit, car, pour Leopold, ce n’est pas rien de se chauffer avec les bûches de ce chêne. En permettant de comprendre et en rendant sensible au mal touchant l’environnement, l’éthique de la terre de Leopold n’est pourtant pas culpabilisatrice et mortifère. En même temps qu’elle développe une conscience aigüe de la responsabilité, elle sollicite en nous l’attention, la reconnaissance et la gratitude.
C’est souvent le concept de wilderness qui est retenu de l’éthique de la terre de Leopold. Pourtant, ce qui précède ouvre la voie à la nécessité d’une éthique en première personne centrée sur la nature ordinaire et dont Leopold fournit l’exemple. Dans cette perspective, le mal touchant l’environnement n’est plus la conscience abstraite de la pollution industrielle ou de la disparition de milliers d’espèces à cause de la pression anthropique – toutes les deux pourtant bien réelles. La conscience d’une possible responsabilité dans le mal touchant l’environnement est maintenant rivée à la nature que nous avons sous les yeux. Au sein de l’éthique de la terre, une manière d’accentuer ce souci pour la nature ordinaire est peut-être d’interpréter la terre (land) comme un jardin. Certes, il faut reconnaître que Leopold utilise peu l’exemple du jardin, même s’il affirme que le touriste ferait mieux « d’apprendre à voir son propre jardin »50. Toutefois, les termes Umwelt et Land peuvent être rapprochés de « jardin ». Jacob von Uexküll fait explicitement le lien entre Umwelten (les environnements de chaque être vivant) et Garten et il est possible d’étendre ce lien entre les termes anglais land et garden51. Le paysage étant landscape, land a cette signification du pays où l’on vit, duquel on tire sa subsistance (comme le paysan). Le morceau de pays, de land qui est enclos est comme le jardin. Leopold lui-même fait souvent référence au propriétaire d’une terre, d’un land, qui n’est alors pas très éloigné du jardinier. L’expérience éthique du jardinage peut ainsi conduire à accorder du crédit à la thèse de Leopold relative à l’oubli de la terre, c’est-à-dire à nos liens de dépendance aux êtres vivants et aux ressources abiotiques. Combien d’espèces de plantes ou d’animaux sommes-nous capables d’identifier avec certitude dans quelques mètres carrés de jardin ? Et encore, connaissons-nous vraiment leurs qualités, leurs comportements et leurs relations ? Le jardin est d’abord le lieu de l’expérience libératrice de l’ignorance. Au jardin, on peut s’ouvrir à un monde et apprendre la modestie :
Il apparaît que l’œil du fermier isolé est près de deux fois mieux nourri que celui de l’étudiant ou de l’homme d’affaires. Certes, ni l’un ni l’autre n’ont présentement d’yeux pour leur flore et l’on se trouve donc face à l’alternative déjà évoquée : soit veiller à la cécité prolongée de la population, soit se pencher sur la question de savoir si on ne peut pas avoir et le progrès et les plantes52.
En ce sens, le jardin et le jardinage peuvent favoriser une éthique en première personne dans laquelle s’ouvre l’opportunité de comprendre et ressentir le risque de faire le mal et pas simplement de mal faire. Dans cette perspective, le mal peut être compris, non comme l’infraction d’un commandement parmi d’autres sur une liste précise, mais comme le risque réellement encouru par le réseau d’interactions naturelles dans lequel nos actions sont prises et se répercutent. Le jardinage empêche de tomber dans l’angélisme, car tout jardinier sait qu’il faut arracher et tuer des êtres vivants pour favoriser les êtres qu’il a élus. Cependant, à son échelle, le jardinier peut prendre conscience des conséquences potentielles des actes tyranniques dans lesquelles sa volonté cherche à transformer la nature selon ses désirs et grâce à la technologie (appauvrissement et pollution du sol, perturbation rapide des réseaux trophiques, destructions de niches écologiques…). Ne sachant pas toujours exactement qu’il fait le mal, le jardinier écocentrique soupçonne toutefois qu’il risque de le faire et d’en être responsable. Il ne renoncera pas à jardiner, mais peut-être retiendra-t-il souvent son bras pour laisser être ce qu’il aurait pu tuer, peut-être comme un « diplomate » qui cherche à éviter la multiplication des guerres53. En faisant un pas de côté par rapport à la systématisation de l’éthique environnementale par Callicott, l’écologie sert ici, comme d’autres sciences, moins de fondement que d’information pour une expérience enrichie du land, dont le jardin et le jardinage peuvent être une incarnation à l’intérieur de ce qui est aussi une esthétique qui produit des passions positives et puissantes.