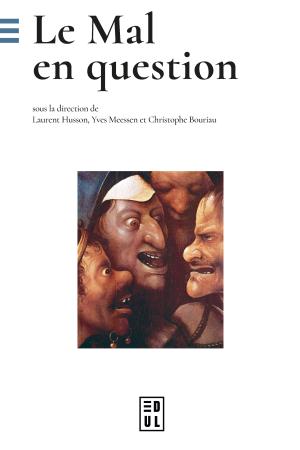
Petite enquête littéraire sur l’insaisissable mal
L’écrivain Mathias Énard déclarait dans un entretien paru dans le journal Le Monde : « Au fond, le seul endroit où elle vit encore, cette question du mal, c’est le roman »1. Quelle que soit la validité de ce jugement, force est de constater qu’une enquête littéraire sur le mal ne manquera pas de portes d’entrée, d’où la nécessité préalable d’en circonscrire le périmètre. À cet effet, nous ferons un retour sur le testament littéraire de Goethe, son FaustII2, à l’orée de la modernité, afin de nous interroger ensuite, moins sur toutes les atrocités que l’homme commet sciemment à l’égard de son semblable et dont l’histoire regorge, que sur des formes moins manifestes mais non moins efficaces de « faire souffrir autrui ». Mais tel n’est pas forcément le but, explicite, conscient ou assumé, de bien des actes qui pourtant y mènent, ou en passent par là. Nous tenterons donc de saisir des formes de mal procédant, du moins en apparence, non pas d’une volonté ou d’une pulsion de nuire bien orientées, mais de contextes structurels – sociaux, économiques, idéologiques – un mal sinon plus énigmatique, du moins plus difficile à identifier ou à circonscrire, qui passe du sujet au collectif, de l’individu à la multiplicité, surgissant d’enchaînements, de causalités apparentes ou diffuses, en les traquant en particulier dans des textes d’écrivains contemporains de langue allemande, Peter Stamm, Kathrin Röggla, Hans-Wilhelm Händler et Matthias Nawrat.
On a beaucoup souligné la transformation de la Genèse par Goethe, qui place au commencement (de quoi exactement, genèse ou progrès ?) l’action : Au commencement était l’action3. L’écriture du Faust, qui en sa deuxième partie surtout ressemble à un testament – achevé peu avant la mort de l’auteur et assorti de l’interdiction d’en prendre connaissance avant – présente deux grandes caractéristiques frappantes : elle s’appuie sur deux mythologies, la grecque et la chrétienne, pour développer la suivante, l’entrée dans la modernité, et ce faisant, elle recourt encore tout naturellement à l’allégorie. C’est ainsi que s’accompagnent, se complètent et s’affrontent Faust, le savant, homme d’action moderne (Goethe lui-même par bien des aspects) et Méphisto, le diable, c’est-à-dire le mal, qui s’autodéfinit d’emblée dans toute sa complexité : « Je suis l’esprit qui toujours nie ! / Et c’est avec justice ; car tout ce qui naît / Est digne de périr »4. Ce qui frappe, chez Méphisto – et ce n’est pas la moindre des raisons qui ont permis à Klaus Mann d’en faire aussi l’incarnation de Gustav Gründgens, le grand metteur en scène de Faust et nazi – c’est sa capacité à se métamorphoser sans cesse, en d’autres termes, à ne pas s’identifier de manière immédiatement transparente au mal, ou plutôt l’inverse5. Quant à Goethe, poète et écrivain, mais aussi savant, et également homme d’État, ministre, parmi les multiples façons dont les questions qui le hantent ont pu être synthétisées, il y aurait celle-ci : l’homme peut-il légitimement agir sur ses semblables ? La question de l’action nous semble en effet prise le plus fréquemment sous l’angle de l’action sur la nature dont l’homme, aveuglé par sa perspective, qu’il ressent comme surplombante, sans doute en raison du champ réduit de son expérience et faute d’avoir été confronté à un animal qui lui aurait donné les preuves de sa propre maîtrise linguistique du monde, s’exclut obstinément, même si de temps à autre cette dimension s’impose, pour être refoulée aussitôt. Un problème que le ministre Goethe, amené par exemple à signer la condamnation à mort d’une malheureuse infanticide séduite, expose tout en le transformant en problème théoriquement intéressant6. Et dans Faust, les deux perspectives fusionnent et culminent lorsque Faust, avant de perdre lui-même la vue et la vie, cause la perte de Philémon et Baucis, dans son inextinguible et irrépressible besoin de s’approprier le monde dans sa totalité.
L’intérêt du Faust réside entre autres dans les pistes indiquées : où se pose le problème du mal ? En nous ? En-dehors de nous ? En l’externalisant dans le personnage de Mephisto, toujours prêt à seconder Faust dans ses différentes entreprises dans l’espoir de le voir trébucher, Goethe nous indique où le rencontrer : la soif de connaissance, la soif de beauté, le désir de richesse et de puissance, la recherche du pouvoir sur la nature et sur l’homme. Ces objectifs passent par la séduction et la perversion de l’innocence (Marguerite), la rencontre funeste avec la beauté (Hélène), la guerre, la mort de Philémon et Baucis, révélant ainsi leur ambivalence. Mais si toutes ces voies impliquent souffrances et destructions, à la fin, Faust est bel et bien « sauvé du mal » (v. 11935), car « [c]elui qui, dans son constant effort, n’épargne pas sa peine / Celui-là, nous pouvons le sauver » (v. 11936-11937), proclament les anges du Ciel.
L’incarnation d’un homme élu, que le « Souverain Bien » croit capable d’errer mais non de trahir, sinon la juste voie du moins l’objectif juste, nous montre où se trouvent pour Goethe, en ce début de 19e siècle, les pièges et surtout la tension constitutive de l’homme moderne, entre énergie créatrice et respect des limites. Le mal n’est pas en Faust, tel un vice de forme, que l’éducation s’efforcera en vain d’extirper, tout au contraire de ce que suggère ce quatrain accompagnant une eau-forte de Claude Gillot aux environs de 1700 :
À nous porter au Bien, c’est en vain qu’on s’obstineLorsqu’au fond de nos cœurs, le Mal a pris racine. Êtes-vous né méchant ? Vous serez toujours telRien ne peut corriger un mauvais naturel.=7.
Dans Les Affinités électives, Édouard trahit son amour pour Charlotte, poussé par sa passion pour la protégée de celle-ci, en sorte que l’idylle initiale se transforme en drame. Mais le texte n’accuse aucun des protagonistes : ni tragique classique ni morale chrétienne n’expliquent le glissement inéluctable vers le malheur et la mort. C’est un mécanisme qui les dépasse, qui dépossède les personnages de leur libre arbitre, les rend aveugles au mal découlant de leurs actes et les affectant aussi bien eux-mêmes que les autres, de l’ordre de la loi naturelle telle qu’a cru pouvoir la détecter le chimiste suédois Torbern Bergman8. Les hommes sont soumis, eux aussi, aux lois qui régissent l’attraction des molécules chimiques. Désormais, et ce d’autant plus à mesure que la loi apparaît comme le dernier mot de la connaissance scientifique, la conscience morale qui a partie liée avec la volonté individuelle semble devoir être reléguée dans le cabinet de curiosités des superstitions d’antan, et l’homme se retrouve aux prises avec la complexité d’interactions causales dont les tenants et les aboutissants lui échappent. Ce que la littérature romanesque met en scène, ce sont des antagonismes, des crimes, des catastrophes, où la responsabilité individuelle se trouve diluée voire anéantie par des phénomènes qu’un point de vue surplombant peut bien, dans le meilleur des cas, dénouer mais que les protagonistes ne peuvent que subir à des degrés divers, tous victimes, mais rarement véritablement agents, du moins quant aux objectifs fixés.
Ainsi, le mal est-il dans les relations, les circonstances, les enchaînements événementiels, ou alors dans les mécanismes économiques ou politiques, c’est-à-dire dans le fonctionnement des sociétés, comme dans deux nouvelles de Peter Stamm.
La première nouvelle publiée par l’écrivain suisse Peter Stamm9 trouve son aboutissement lors d’une fête, la fête de la société de tir du village. Une poignée de gamins est postée au comptage des points, et le narrateur homodiégétique lance un défi à son camarade, par plaisanterie dit-il : saura-t-il identifier le tireur, visiblement très maladroit, dont il compte les points ? Le camarade se redresse et s’affaisse, touché en pleine tête. Lors de l’enterrement, une réflexion faite comme en passant apprend au lecteur en même temps qu’au narrateur l’identité du tireur : c’est le père qui a tué son propre fils. Visiblement, c’était un accident, causé, si l’on en croit la phrase jetée négligemment, par la maladresse du tireur. Néanmoins, il y a un mort, et une tragédie. À première vue, la question du mal ne s’y pose guère, ou de manière si ténue qu’elle disparaît derrière le hasard malencontreux. Mais une foule de détails en apparence insignifiants poussent le lecteur à reprendre l’histoire : le père, architecte, nouvellement installé dans le village avec sa famille, se heurte à une défiance difficile à cerner de la part des autochtones, nourrie par la différence religieuse (des catholiques en milieu protestant), le clivage social, une arrogance de l’architecte, réelle ou fantasmée, à moins qu’il ne s’agisse simplement d’un réflexe d’exclusion à l’égard de nouveaux venus, d’un milieu jugé supérieur. La gentillesse de la mère à l’égard des nouveaux camarades de son fils est perçue comme une manipulation intéressée en vue de faciliter son intégration. Dès lors, le lecteur n’est-il pas poussé à interroger la nature de la pulsion cachée derrière l’injonction du narrateur qui coûte la vie à son « ami » ? Et cette pulsion, d’apparence anodine – apparence que nous ne percevons qu’au travers de la narration de l’acteur principal qui semble s’effacer lui-même – ne doit-elle pas paraître de plus en plus trouble, à mesure qu’on l’interroge ? Bref : ce récit ne met-il pas en scène précisément ce qu’on ne perçoit qu’entre les lignes, à savoir quelque chose qui relève bien de l’ordre du mal et non du simple concours de circonstances, un mal insidieux, imprégnant l’ensemble de la communauté villageoise, un rejet qui aboutit à un crime, en même temps que toute la responsabilité morale est refoulée vers le tireur et sa victime. Le lecteur dès lors ne peut éviter de questionner, non seulement le lieu d’où il surgit, mais aussi sa nature. L’écriture apparemment sobre et factuelle semble faite de touches de récit mêlant et mettant sur le même pied, remarques banales et événements funestes. Ainsi, dans Feu, le moment de l’accident est-il narré de la manière suivante :
Herbert avait apporté une gourde de thé chaud, et je lui dis : « Tu serais cap de regarder qui est-ce qui tire si mal sur ta cible ? »
C’était bien sûr une plaisanterie, il aurait dû s’en douter, on était beaucoup trop loin. On était tout à fait au fond du stand et Herbert escalada la paroi latérale et s’écria en riant : « Je vois les armes fumer ».
Puis il tomba, un trou dans la tête. […]
Le lendemain soir, ce fut la remise des prix puis la fête. C’est là que j’ai fumé ma première cigarette. Le président de la société de tir me donna du feu et me dit : « Si l’architecte était meilleur tireur, il aurait touché la cible dans le mille et pas tiré sur la tête de son fils »10.
Et c’est ainsi que s’achève cette nouvelle, longue d’à peine plus de deux pages.
Alors que ce récit renverse le mythe suisse le plus célèbre, l’épisode Guillaume Tell, la nouvelle Ce qui manque mène à la résilience de l’entrepreneur qui, durant un court moment, s’est laissé submerger par des émotions incongrues11. Un narrateur hétérodiégétique suit David, fraîchement arrivé à Londres, où son entreprise l’envoie pour un an. Les premiers jours de son installation dans son nouvel appartement, un week-end, sont difficiles : tout semble imprégné du peu d’enthousiasme qu’il ressent visiblement dans cet exil sans doute profitable à sa carrière, mais le vouant à une phase initiale douloureuse de dépaysement et de solitude qu’il n’a pas vraiment choisis. Son malaise atteint un point culminant lorsqu’il lit dans le journal la découverte dans la Tamise d’un cadavre d’enfant, un fait divers non élucidé qui s’empare de lui, provoquant une crise d’une intensité inattendue : « Une rage inouïe s’empara de lui, une profonde haine envers ces gens qui avaient assassiné et mutilé cet enfant innocent »12. Il est pris d’une sorte de folie furieuse, passant de l’autodestruction à la destruction, racontée en mode réel : on le découvre assassiné sauvagement et, lui aussi, démembré ; il saccage son appartement, s’en prend à la robinetterie Hansgrohe de la salle de bains, jette le téléviseur par la fenêtre ; l’eau gicle de la conduite ; deux lignes plus tard, c’est du sang qui gicle de la moquette (sans que l’on sache ni d’où ni de qui il provient). Puis David se jette par terre et, en position fœtale, rejoue avec le garçon mutilé une scène de son enfance, une initiation au cerf-volant. Réel et fantasme, passé et présent se mêlent jusqu’à l’épuisement du personnage. Puis, reprenant ses esprits, il sort sur le balcon, a un bref échange avec sa voisine, et la nouvelle s’achève sur cette phrase : « J’ai le temps, pensa-t-il, ça va aller »13.
Ce retour à une confiance en l’avenir que rien ne permettait de prévoir, questionne, comme beaucoup de nouvelles de Stamm, qui s’achèvent volontiers sur des énigmes.
Que s’est-il donc passé ici ? Le choc traumatique d’un crime ignoble et inexpliqué, à un moment de fragilité du protagoniste, interroge le lecteur : l’empathie destructrice est presque aussi surprenante que la consolation rapide. Lui succèdent d’un seul coup apaisement et indifférence, comme si le crime sordide ne servait que de catalyseur et d’exutoire à sa propre violence, à ses propres frustrations et révoltes latentes. Dans la crise se cristallisent en effet un certain nombre de micro-événements dont les traces sont disséminées dans le texte, formant un réseau de souvenirs et de blessures peut-être ravivées par l’insensibilité dont fait montre son père en lui parlant au téléphone du chat des voisins qui s’est fait écraser. Ce qui se joue pour David dans la confrontation à ce crime horrible échappe à toute interprétation univoque, mais là aussi, plus subtilement encore que dans Feu, le mal imprègne le personnage et son entourage, vétille insignifiante ou cruelle énigme, sans assignation de culpabilité, susceptible d’entrer en résonance avec tout et chacun.
Feu et Ce qui manque ont pour théâtre des univers que tout oppose : nous avons souligné le contexte villageois du premier récit, le deuxième se déroule à Londres, près de l’Île des Chiens, baptisée ainsi, affirme sous forme de boutade lourde de sous-entendus la secrétaire qui accueille David, à cause des institutions financières qui y ont leur siège.
Du protagoniste de cette nouvelle de Stamm, nous ne savons pas grand-chose, sinon qu’il a été envoyé à Londres par son entreprise, en tant que jeune cadre prometteur, célibataire et donc supposé libre, auquel ce sacrifice ouvre des perspectives favorables pour sa carrière. De quel genre d’entreprise s’agit-il ? On n’en saura rien.
En revanche, dans Wir schlafen nicht de Kathrin Röggla, les lecteurs et lectrices sont immergées dans l’agitation entrepreneuriale, le temps d’un salon. Le texte de Röggla est un montage, relève donc du documentaire et de la fiction, puisqu’elle le construit sur la base d’entretiens réalisés avec divers acteurs – chargée de compte client, stagiaire, rédactrice en ligne, informaticien, senior associate, associé14. L’auteure se tient en retrait, ne transcrit pas ses propres questions ou interventions, mais laisse la parole à ses interlocuteurs, dont elle fait dialoguer les réponses ou fragments de réponses. Tout au long du récit, l’emploi majoritaire du subjonctif, mode en allemand du discours rapporté, nous rappelle que nous avons sous les yeux une parole retranscrite et tenue à distance. Soulignons cependant que Röggla remercie les personnes interviewées dans une note liminaire, spécifiant que le texte, d’ailleurs qualifié de « roman », est « fondé » sur des entretiens, assumant ainsi pleinement l’activité créatrice de l’écrivaine. Les entretiens semblent avoir eu lieu tantôt en tête à tête, tantôt à plusieurs, sans doute au gré des déplacements des uns et des autres, ou des événements et protagonistes extérieurs au groupe : visiteurs, voisins de stand, mouvements de foule. La foire-exposition correspond visiblement à un moment particulièrement intense de la vie de l’entreprise, implique une forte proximité voire une promiscuité entre les salariés, mais dans le même temps ouvre sur un environnement inhabituel dont on perçoit l’influence sur la circulation et l’élargissement des sujets abordés. De leur activité, tous et toutes parlent en usant d’un jargon souvent aussi hermétique pour le profane que les éléments de langage rebattus, les anglicismes, les allusions pour initiés, autant de comportements langagiers propres à donner une impression de cohésion, voire de communauté. Cependant, il semble ne s’agir véritablement que d’une illusion produite par ce langage commun et par une conscience commune de ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire pour « en être », mais où ne percent ni sympathie ni solidarité. Les personnes passent au second plan, derrière leur fonction. Du reste, si le texte est précédé, comme dans une pièce de théâtre, par la liste des protagonistes, avec leur nom, leur fonction et leur âge, dans le corps du texte, ils sont désignés par leur fonction, et très rarement, l’un ou l’autre protagoniste mentionne le nom d’un collègue.
La première section de l’ouvrage (il en comporte 32) donne la parole au cadre le plus élevé dans la hiérarchie des présents. D’emblée, c’est la dualité, entre défensive et offensive, qui caractérise sa posture.
Il nous apprend que nous nous trouvons dans une société de conseil, qu’il présente brièvement, une fois le contact établi, sur le mode : venons-en au fait. Il y a, dit-il, l’image qu’on se fait en général de leur activité, celle du « conseiller qui dit les choses désagréables à entendre : “il vous faut moins de gens, vous êtes inefficaces” et tout cela est bien sûr vrai, et évidemment, on le fera ». Le conseiller « envoie ses troupes d’assaut »15 ; on étudiera les différents secteurs, on fermera ceux qui ne sont vraiment pas rentables, on en trouvera de nouveaux, on fera les calculs.
L’entrée en matière s’appuie sur la mauvaise image que le public est censé se faire de cette activité, une image partiellement fausse et injuste selon le locuteur, mais cette partialité contre laquelle il s’inscrit en faux, reste pour ainsi dire en suspens : nulle part, on n’y opposera une réalité clairement flatteuse, à moins que le sous-entendu positif ne corresponde à l’explicitation des contraintes imposées par la réalité. Ce sont en effet ces réalités, difficiles à entendre, mais incontournables qui justifient la fonction, apparemment désagréable pour tous, du consultant, qui au fil du texte ne cesse d’être associée au « cliché McKinsey », à une « fureur de rationalisation », à « une folie de licenciement »16, pour reprendre les caricatures qu’en fait, selon elle, le frère de la stagiaire. De fait, l’évocation de la calculette et du stylo rouge, celui avec lequel on fait des coupes dans les budgets, revient régulièrement, ainsi que la thématique du licenciement, associée à ce qui ressemble à un euphémisme, freisetzen (pour ne pas dire crument entlassen), littéralement libérer. Mais ce synonyme de licencier est moins calqué sur l’idée de libération que sur l’ancien sens de « libre » (frei) signifiant libre de tous liens, et donc sans protection, que l’on retrouve dans le terme vogelfrei : on est alors non pas libre comme l’oiseau, mais abandonné en pâture aux oiseaux, tel le supplicié sur son gibet. En d’autres termes, être libéré, dans ce sens, c’est être proscrit, mis au ban de la société, en l’occurrence rejeté par l’entreprise, remis sur le marché du travail.
Le conseiller consultant, lit-on, passe pour celui qui dit « les choses désagréables à entendre ». Plus précisément, ou de manière plus polysémique, ces choses sont qualifiées, en allemand, par l’adjectif böse (die bösen Sachen). Ici, l’emploi de böse discrédite insidieusement une approche naïve (il sert par exemple à dire d’un enfant qu’il est méchant) ou moralisatrice (licencier serait mal), dont l’impropriété ressort de la défense produite par le consultant, et qui se précisera au fil du texte, notamment par le malaise, évoqué à l’occasion, du consultant face à cette tâche ingrate, mais aussi par sa propre précarité ; car à tous les échelons de l’entreprise, quelle qu’elle soit, nul n’est à l’abri d’une exclusion.
Le titre du roman va du reste droit à l’essentiel. Du bas de l’échelle (une stagiaire) jusqu’aux cadres dirigeants (celui dont on vient de parler), tous disent donner le maximum d’eux-mêmes, travaillant nuit et jour. Si « faire le mal, c’est faire souffrir autrui17 », c’est aussi devenir insensible, c’est-à-dire aveugle et sourd à sa propre souffrance, et en faire, plus ou moins implicitement et par la pression du groupe, une norme collective et contraignante. L’extension du domaine du travail passe de la stricte séparation entre vie privée et vie professionnelle, posées comme exclusives l’une de l’autre (ainsi, l’associé affirme-t-il qu’il est radicalement impossible de ne pas s’investir à 100 % dans son travail), à la norme des 14 ou 16 heures de travail quotidien, et, en périodes de pointe, à la nécessité de ne dormir qu’à raison de quelques minutes volées à l’occasion. L’informaticien et la rédactrice en ligne rêvent de pouvoir faire des provisions de sommeil, imaginent l’invention de banques de sommeil, avec l’idée d’arriver à opérer des transferts de sommeil. De manière plus réaliste, ils évoquent leurs collègues annonçant qu’ils s’en vont prendre l’air pour ne pas avouer qu’ils vont prendre un peu de repos. Chacun a ses stratégies (amphétamines, alcool ou autres) mais affirme avoir dépassé le stade où il en aurait besoin. L’addiction au travail et la résistance à la souffrance sont des caractéristiques partagées par tous, voire leurs lettres de noblesse. De congé, il n’est jamais question. En revanche, la pause (Auszeit), terme emprunté au vocabulaire du sport, est présentée comme une expérience à éviter à tout prix, l’associé allant jusqu'à dire qu’un tel retrait, un jour, a failli le tuer.
Impitoyables avec eux-mêmes, les consultants savent que leur position professionnelle est précaire, plus ou moins selon leur position, tous ayant eu à vivre des « réorientations », à subir les techniques destinées à écarter un collaborateur devenu indésirable, ou à les imposer, pour les cadres les plus élevés, au sein de leur propre entreprise. Dans le chapitre intitulé « Life-style », le senior associate décrit ainsi le déroulement d’une carrière :
Les deux premières années, on est conseiller, c.-à-d. qu’on aura commencé en tant que summer associate, c’est-à-dire pratiquement en tant que stagiaire, on aura continué comme associate, c’est-à-dire comme consultant normal – « oui, c’est vraiment tout un cinéma, ces dénominations » – après ça en tout cas, lui était devenu chef d’équipe, puis à l’étape suivante, on est associé, comme M. Gehringer, et un jour, l’organisation étant structurée comme une association, tu te fais élire associé par les autres associés », là, c’est le grand obstacle, le saut décisif pour une carrière, mais la plupart des gens partent déjà au bout de deux à trois ans, parce qu’ils en ont assez, parce qu’on leur aura proposé un poste, dans l’une ou l’autre entreprise où ils ont été employés sur un projet, et qu’ils préfèrent se la couler douce18.
La résistance au sommeil, il la décrit comme « une sorte de compétition » ; lui-même s’est entraîné à se contenter en certaines circonstances de trois heures. Son activité l’amenant à licencier, il en relève la dimension absurde dans une perspective plus globale : « ces gens qu’il met dehors, ils finissent par se retrouver sur sa propre fiche de paie : “logique !” – par les impôts, et ça, ça n’a pas de sens non plus, du point de vue de l’économie politique ». Mettre cent ou trois cents personnes à la rue, ce n’est pas évident. Du coup, on se trouve des justifications, mais au bout du compte, cela revient tout de même à « armer le front des patrons, c’est-à-dire à sortir la calculette », la munition suprême mise à leur disposition « culminant dans cet argument “mort ou vivre” ». L’argument imparable sera par conséquent : « si l’on ne prend pas certaines mesures, tous vont être obligés de partir ».
On devine alors à sa réponse que l’auteure lui demande si ceux qui partent le font pour des motifs d’ordre moral. Non, dit-il. Ceux qui abandonnent ou renoncent le font, selon lui, parce qu’ils ne supportent plus ce mode de vie (« short-sleeping, quick-eating et tous ces trucs, dormir à l’hôtel » etc.). Suit une énumération de tout ce qui finit par trop peser, et ce sont des raisons apparemment futiles (on en a assez des minibars) et d’autres plus graves :
Et prendre l’avion comme on prend le bus, ça ne marche plus non plus.
Mais aussi toute cette sempiternelle logique de croissance, que l’on finit par retourner contre soi-même.
Le chapitre s’achève par ces trois lignes :
et cite-moi correctement !
quoi ? tu ne peux pas ?
Et à part ça, autre chose que tu ne peux pas faire ?
Ces phrases, d’une lucidité confinant au cynisme, confirment le rejet déterminé de toute approche morale, implicitement hors-sujet. Le mal que l’on subit comme celui que l’on inflige ne peut être qu’accepté, au même titre que le fonctionnement du système dont on fait partie, parfois avec amertume, mais sans rébellion et sans réflexion, sauf à l’étouffer très vite. Ici, l’agressivité de l’adresse à l’auteure, teintée de condescendance (elle semble moins bien maîtriser son affaire que lui-même), pourrait bien témoigner d’une obscure inquiétude suscitée par le sentiment d’en avoir un peu trop dit. De manière générale, chacun se vit – ou se présente – comme un élément d’un dispositif, dispositif dont il s’accommode, comme tout le monde. La chargée de compte client, dont il est d’ailleurs évident qu’elle irrite l’associé, est la seule à formuler à l’occasion, prudemment, qu’elle tient à ne pas consacrer l’ensemble de sa vie professionnelle à « faire n’importe quoi »19.
Le roman de Röggla brosse un portrait d’acteurs de la « Nouvelle Économie » prêts à tous les sacrifices, vécus non pas comme tels, mais comme des performances, comme des dépassements de soi gratifiants, même là où ils frisent l’autodestruction. La lutte contre les limites du corps propre mise en évidence par Wir schlafen nicht, prend les allures d’une monnaie d’échange légitimant la destruction d’autrui, présente dans le texte essentiellement sous la forme du licenciement. Celui-ci ne suscite guère d’états d’âme puisque chacun a le sentiment d’être logé à la même enseigne, et est donc prêt à payer, le cas échéant, le prix à son tour. Cette égalité des conditions a beau être trompeuse, la souffrance que s’infligent les acteurs interrogés ne peut, ne doit ou ne veut être sous-estimée. Derrière les manifestations subjectives de l’emprise du système économique, se profilent l’inactualité, l’inadéquation de l’approche morale. Penser la dynamique mortifère « de la sempiternelle logique de croissance » en termes de « mal » serait incongru, tant sa logique paraît relever d’une rationalité supérieure, universelle et indiscutable. Mais ce n’est sans doute pas un hasard que se suivent pour finir, dans l’extrait mentionné ci-dessus, écologie et croissance. Prendre l’avion ne va plus de soi, la croissance se retourne même contre ses champions. Cependant, il ne s’agit que d’allusions ponctuelles ; un sentiment de malaise, de menace diffuse s’installe au fil du texte, culmine dans les dernières sections, où les performances se fissurent et les fragilités s’affichent, sous forme de panique lors d’un mouvement de foule, de souvenirs désagréables – mais on ne parle pas des échecs, cela ne se fait pas ! Puis le ton monte à l’occasion, l’excitation devient irritation, on parle de zombies, de morts-vivants, de spectres. Un récit émerge, quelqu’un est mort, s’est peut-être suicidé, mais est-ce bien réel, un souvenir ou une sorte de création collective, élaborée comme dans un état second (de fatigue ?) ? Ou n’avons-nous affaire, après tout, qu’à une sorte de catharsis, qui n’est pas sans évoquer la crise vécue par le personnage de Ce qui manque, mais suscitée cette fois-ci par l’écrivaine, contre laquelle semble se déchaîner pour finir une révolte faite de déception : on avait attendu d’elle, entre autres, un regard extérieur, fondé sur la distance, mais en vain. N’avait-on pas confondu distance et soutien, précisément contre les préjugés moralisateurs dont on se sentait la cible incomprise ?
C’est un reproche que l’on hésitera à adresser à Ernst-Wilhelm Händler, écrivain et lui-même entrepreneur, auteur d’un roman sans doute tout aussi soucieux de donner une image nuancée des acteurs économiques, en s’avançant, au contraire de Röggla, dans l’intimité et l’imaginaire de ses personnages. Le roman de Röggla n’est pas d’un accès facile, parce que l’auteure donne la parole à ses protagonistes en leur laissant une liberté qu’ils vivent aussi comme un piège, comme le montre bien leur méfiance larvée. De fait, en les laissant dire, elle les laisse se contredire, oublier leur prudence, leurs inimitiés, leur aveuglement, de bonne ou de mauvaise foi, non pas pour les livrer à une lecture malveillante et biaisée a priori, mais – posons qu’une étude détaillée en témoignerait – avec l’objectif de faire émerger une connaissance de son objet. Händler poursuit sans doute le même objectif, par des moyens très différents. Wenn wir sterben est une fiction20, d’une écriture dont la critique n’a pas manqué de souligner le caractère ambitieux21. Le premier exergue le souligne : « Chercher la poésie là où sinon, personne ne la trouverait ». La phrase ne se présentant pas comme une citation, on est en droit de la comprendre comme un viatique donné par l’auteur lui-même à son lecteur. Le troisième exergue est une citation de Joseph Schumpeter : « À la différence de tout autre type de société, le capitalisme, en raison de la logique même de sa civilisation, a pour effet inévitable d’éduquer et de subventionner les professionnels de l’agitation sociale »22. La référence à la fois explicite et ambiguë à l’économiste se double d’une autre filiation, plus ancienne mais pas forcément plus éclairante : du roman, extrêmement touffu, se dégage une protagoniste centrale, dont on apprend assez vite, à la faveur d’un bref échange avec le portier de son entreprise, qu’elle compte parmi ses ancêtres le philosophe Friedrich Adolf Trendelenburg (1802-1872), dont le portier, évoqué à nouveau à la fin du roman, restera un connaisseur énigmatique, comme devait l’être l’ex-mari de l’entrepreneuse, dont on apprend qu’il a fait des études de philosophie. Il est difficile d’imaginer que la familiarité avec l’œuvre de Trendelenburg puisse être considérée par Händler comme un prérequis pour la lecture de son roman, ce qui ne permet pas pour autant de tenir la mention de cet aristotélicien précurseur du néokantisme pour un hasard ou une facétie. À ces indices invitant la lectrice a minima à une certaine prudence interprétative s’ajoutent, parmi d’autres indications, quelques formulations qui peuvent et doivent s’appliquer à l’écriture du roman lui-même : une instance difficile à identifier se pose au sujet de Stine – Christine Trendelenburg – les questions suivantes : « Que voulait Stine ? continuer à rédiger sa carrière en la paraphrasant librement ? Ou se contentait-elle de mettre sa propre existence à distance, en l’allégorisant ? […] Au-dessus de sa tête, nulle confrérie céleste d’interprètes. Il n’y a pas de critères. Ni de facteur subjectif de critique »23. Stephan Maus, écrivain et journaliste soulignait, dans son compte rendu de l’ouvrage, la conception très « cérébrale » du texte, l’originalité de son écriture, et la précision de son analyse sociale24.
Quatre entrepreneuses de choc, aux profils très différents, sont « amies » et associées, jusqu’à ce que la deuxième arrivée, Stine, n’écarte successivement les deux autres, Charlotte et Bär, avant de proposer à Milla un projet de coentreprise à l’échelle internationale. Milla, à son tour, saura manœuvrer habilement pour ruiner Stine. Les protagonistes de cette compétition ne prétendent en rien être soumises à des processus qui les dépassent ; au contraire, elles sont calculatrices, avides de gains et de pouvoir : « Stine était la première femme à se poser là et à tout vouloir : glamour, sexe et son entreprise à elle »25. L’objet de leur affaire est un enjeu de leur réussite, et non l’inverse. Stine fantasme la chute de ses collègues :
[…] elle va faire en sorte que les possibilités de carrière qui s’offrent à Charlotte et à Bär tombent à l’eau. Elles s’écraseront dans l’abîme, les yeux et la bouche grands ouverts, les membres distordus. Ce qu’elles ont pris pour leur vie professionnelle n’était qu’un voyage d’entreprise, organisé par Stine. Parce qu’elles sont montées à l’avant du bus, elles vont être les premières à être projetées au fond de la vallée. Stine voit les parties du corps familières tacheter les versants, des torses cassés, les membres arrachés, de partout jaillissent des liquides organiques. […] Pas d’inquiétude ! Stine a pris le bus avec elles, mais elle n’a pas été entraînée dans leur chute, elle n’est ni écrasée, ni déchiquetée26.
Les scénarios qui occupent l’esprit de Charlotte et de sa fille d’un côté, de Stine de l’autre, prennent la forme d’accidents, ou de promenades en voiture le long d’allées de peupliers, ou encore de randonnées. Charlotte et sa fille ne sont pas naïves, elles cherchent leur chemin de leur côté. Un narrateur (?) cependant pose la question : « Stine est-elle méchante ? »27 et examine attentivement cette option. Lorsque Stine prépare l’éviction de ses associées, on lit ceci : « Stine sait ce qui est bien et ce qui est mal. Il n’est pas trop tard ; elle peut encore se décider à faire le bien »28. Et il semble que sa stratégie la déchire elle aussi, il est question d’une rambarde à laquelle elle s’appuie et qui la lacère comme des lames de rasoir, mais elle se reprend (et est recousue) en se rappelant les plans qu’elle a élaborés pour son entreprise ou, en d’autres termes, en retrouvant sa voie.
D’un point de vue qui a l’air d’être celui d’Egin, l’amant de Stine, il semblerait que Stine n’ait aucun scrupule. En pleine connaissance de cause, elle développe une stratégie faite d’hypocrisie, de duperie, de fraude et de manipulations, entre autres d’Egin, dont l’efficacité s’appuie sur les faiblesses de sa victime : l’impuissance, la détresse, la vulnérabilité de Charlotte ne l’émeuvent pas, au contraire, elle sait pouvoir s’en servir pour l’écarter, car « ce sentiment [d’insuffisance et de faute de Charlotte] était incorruptible »29.
Mais peut-être est-ce le lecteur ou la lectrice qui ne peut assumer cette trahison, qui souffre – avec ou à la place ? – de Stine de cette lutte entre le bien et le mal ? Sont-ce les lecteurs et lectrices qu’un narrateur encourage à « revenir de tout ce qui vous fut cher et précieux » ? « Vous avez décidé de faire le mal. Un instant, vous allez refouler le doute : était-ce vraiment votre décision, ou sont-ce les circonstances qui vous ont poussé à la prendre, ou encore une prophétie ? Vous êtes devenu d’une méchanceté que vous n’avez jamais pu vous figurer »30. Et voilà, l’expérience est en cours. Vous vous retrouvez dans un hôtel cinq étoiles, celui du confort de l’âme, où l’on peut demander au personnel qu’il vous serve des pensées. Vous vous poserez les questions, avec l’idée qu’elles vous apporteront un surcroît de connaissance, qu’elles vous apprendront quelque chose sur la place que vous occupez dans le monde. Et de fil en aiguille, imperceptiblement, la lectrice se retrouve dans l’univers de Stine, passe par des sentiments inattendus, contradictoires, la peur, voire un désir de faiblesse. Mais tout est possible, dans cet hôtel de luxe, donc aussi bien la commande de pensées réconfortantes, de courage, celui dont Stine aurait besoin pour ne pas précipiter Charlotte dans l’abîme. Ou alors : « Vous pouvez également vous faire servir, dans le salon de votre suite, cet autre courage, celui d’accomplir le mal avec détermination et méthode. » Dès lors, on pourra suivre Egin, ou Stine, et poser un regard différent sur Charlotte, voir en elle celle qui ne mérite pas mieux que ce qui va lui arriver. On pourra relativiser la malversation planifiée, qui ne sera pas la première ni la dernière après tout. Et viendra le moment où l’on passera à une sorte de rage à l’égard de Stine, un besoin de s’en prendre à elle physiquement, pour en tirer « sous sa nudité, ce qui se cache d’extrêmement intéressant : une main, d’où goutte le sang, une méchanceté criarde, impossible à duper, un animal qui ment ». Comme des parallèles, les corps de Charlotte et Stine se réfèrent l’un à l’autre. Et pour finir, « le mal fera preuve de courage, tous les mensonges seront couronnés de succès »31.
L’expérience à laquelle le lecteur est soumis sans transition le fait glisser d’une moralité commune vers un autre univers mental qui le happe inopinément, presque à son insu, à la faveur de distanciations déconcertantes au premier abord, d’un mélange de situations imaginaires et de métaphores inattendues (l’hôtel comme matérialisation métaphorique d’un rapport au monde). Ce glissement, ou plutôt ce dérapage, s’achèvera dans un retournement des valeurs troublant. Mais qui orchestre cette expérience ? Händler est-il un de ces agitateurs dont parle Schumpeter ? Fait-il cause commune avec ces intellectuels, tel le sociologue interviewant Milla, qualifié de « machine à produire de l’indignation » parce qu’il lui reproche de dissoudre les valeurs qui sont au cœur de la société du travail et de « briser l’alliance historique entre capitalisme, État social et démocratie »32 ? Ou est-il au contraire un de ces entrepreneurs déroulant devant nos yeux le fonctionnement au quotidien de la destruction créatrice ? La production, en tout cas, n’aurait rien à voir avec le mal, du moins pas selon Stine : « La production rêve d’une science exacte des systèmes complexes s’occupant de la dynamique et de l’émergence de l’ordre »33. Elle est à la recherche de nouveaux possibles. Elle semble donc bien se situer au-delà du bien et du mal ; d’ailleurs, ces réflexions mènent Stine à des rêves de bienveillance, d’harmonie, d’amitié retrouvée. La dynamique à laquelle nous avons assisté n’est pas l’effet de la malveillance de Stine. Celle-ci n’en est au fond qu’un instrument. C’est le mouvement même de l’économie qui s’impose dans les opportunités, associations, conjonctures, qui ne souffrent pas d’être entravées par des sensibleries. Lorsque Stine tombe à son tour dans le piège dont va bénéficier Milla, celle-ci prétend ne pas pouvoir l’aider à en sortir et défend la nécessité d’éviter les questions d’humanité, sous peine de se laisser enfermer dans des représentations anciennes ; or, si l’enjeu est de faire advenir l’homme nouveau, il faut en passer par la négation.
Mais Stine fait preuve de combativité. Elle ne sombre pas dans une torpeur pathologique comme Charlotte, ne se replie pas sur elle-même comme Bär, elle s’accroche à un pacte faustien. Faust acceptait en effet de reconnaître le triomphe de Méphisto, dès lors qu’il se laisserait aller à jouir de l’instant34 ; et s’il finit par être sauvé, c’est qu’il n’a jamais cessé de résister à l’instant présent, qu’il s’est investi au contraire dans l’action35. Stine fait partie de ceux qui ne se résignent pas ; elle veut lutter : « Et elle dit, maudit soit celui qui, le premier, s’écriera : arrêtez, assez ! »36. Moyennant quoi, vaincue par Milla, elle se propose de faire du conseil de gestion auprès d’hôtels de luxe dans des stations de ski qu’elle a fréquentées jadis.
Pour finir, Ethel, la fille de Charlotte, vidéaste, fait une vidéo avec et sur Stine, et rencontre à cette occasion le portier philosophe. Celui-ci lui livre sa vision du sujet, qui ne s’obtient plus, soutient-il, par la surveillance et la punition. Le sujet, dit-il, est désormais « le résultat d’un calcul d’optimisation »37. Cette définition fait écho à la dernière image produite par Ethel : Stine est représentée dans la tenue d’une Miss beauté, mais son écharpe ne porte pas le nom d’un pays ou d’une région, ni de son ancienne entreprise, mais celui d’une entreprise américaine de cryogénisation, Alcor. De cette entreprise, il fut question lorsque l’un des collaborateurs de Milla lui annonce son départ pour rejoindre Alcor, en lui transmettant une brochure présentant la firme. Les activités décrites, macabres à souhait, font état de réalisations en cours pour lesquelles Stine pourrait en effet s’avérer une ambassadrice toute trouvée38.
Le sujet « résultat d’un calcul d’optimisation » se caractérise dans les récits évoqués par son indifférence à ce fonctionnement global, dont il évite de considérer les limites, auxquelles il ne croit pas. Matthias Nawrat, dans son roman intitulé Unternehmer39, met en scène une famille, les parents et deux enfants, dans l’univers désolé d’une région sinistrée, la Forêt-Noire. On devine qu’il s’y est produit une catastrophe majeure dont on ignore l’ampleur et dont les protagonistes ne parlent jamais explicitement. Au contraire, ils pratiquent la politique de l’autruche avec une détermination sans faille. Décidés à accumuler un petit pécule grâce auquel ils ont prévu de se refaire une existence en Australie, ils forment, sous la houlette du père, une entreprise au sein de laquelle chacun assume son rôle : le père est l’entrepreneur en chef, Lipa, l’aînée, son assistante, Berti, le fils chargé de missions spéciales. Le père parvient à inculquer à ses enfants un esprit d’équipe à toute épreuve, un sentiment de cohésion qui a raison des tensions, grâce à leur fierté de former une entreprise performante, fondée sur les difficultés et les dangers de leur activité, les sacrifices consentis et leur ténacité.
Tous trois sillonnent la région à la recherche de composants précieux (les plus précieux, est-il dit d’emblée, sont le tantale et le tungstène), récupérés clandestinement et au péril de leur santé sinon de leur vie dans les usines sinistrées et qu’ils décomposent ensuite chez eux pour les vendre. Le père programme les opérations, assisté de Lipa qui en tient l’inventaire, et Berti plonge au cœur des réacteurs et en ramène les pièces convoitées. Un accident lui a d’ores et déjà coûté un bras. Quant à Lipa, âgée de treize ans, son entrée dans l’adolescence menace de la mettre en porte-à-faux. Elle s’engage en effet dans une relation qui entre en concurrence avec l’entreprise familiale, à laquelle on ne saurait soustraire son temps de présence sur la base de caprices individuels. Mais le conflit entre intérêt familial et entrepreneurial s’intensifie lorsqu’il apparaît que son nouvel ami habite chez une parente qui le maltraite cruellement. Le projet de s’enfuir ensemble se trouve gravement compromis lorsque Berti subit un deuxième accident qui lui coûte cette fois-ci une jambe. Suite à ce drame, le père tombe dans une apathie qui laisse la famille démunie. Lipa finit par renoncer à sa fuite et choisit d’assumer le rôle du père défaillant : le roman se clôt sur son acharnement à entraîner son frère, grâce à un dispositif ingénieux, à conduire leur voiture, afin de pouvoir reprendre à deux leurs tournées dans les usines délaissées des environs.
À l’esprit d’entreprise et aux valeurs d’endurance et de loyauté, tels que le père les transmet à ses enfants, s’ajoute une détermination, voire une obstination féroce qui achève de les enfermer tous dans une forme d’autarcie et les rend insensibles aux autres survivants et à eux-mêmes, aveugles au mal infligé et subi. Cet aveuglement s’étend à l’effondrement du système économique lui-même, qui ne survit plus qu’à la marge, par l’exploitation des derniers restes dont on refuse de voir la dangerosité, même une fois qu’elle s’est inexorablement imposée. Le déni du mal radicalise celui que nous avons observé chez Röggla : après la suppression du sommeil vient l’amputation d’un bras, d’une jambe. Tout aussi choquante est la réaction de Lipa face à la souffrance de son ami. D’abord secouée par la vue de l’horrible « carte de géographie »40 qu’elle découvre sur son dos, elle finit par étouffer son empathie et par se rendre ainsi complice de son martyre, incapable de s’échapper de la prison mentale dans laquelle l’a enfermée la résistance de son père au renoncement à sa vision du monde. C’est ainsi qu’elle devient elle aussi complice, voire actrice du mal, lorsqu’elle force Berti, malgré la douleur, à se préparer à reprendre leur activité d’entrepreneurs, et ses risques.
Un accident mortel au goût d’obscur sentiment de culpabilité, un meurtre d’enfant faisant resurgir des blessures intimes, des licenciements rationnels, nécessaires, peut-être productifs mais communément réprouvés, des réussites entrepreneuriales lourdes en coûts humains, des efforts inlassables au prix d’automutilations : ainsi peuvent se récapituler les situations que les textes abordés ci-dessus explorent sans imposer de lecture univoque du mal qu’on y rencontre. Mais toujours, la société y est impliquée autant ou davantage que les individus. La lecture nous fait découvrir la complexité et l’opacité des événements et des interactions menant aux drames ; plus déconcertant encore : ces mêmes événements et interactions peuvent être des plus inextricables, voire procéder des motifs les plus estimables, tels ceux qui sont au cœur de la phrase qui absout Faust, semblant inévitablement mêler pulsion de vie et destructivité. Dans Wenn wir sterben, la narration concentre sur Stine la question du mal. Or, si elle est prédatrice, elle ne l’est ni seule, ni seulement, si bien que la réponse à la question initiale – est-elle fondamentalement malfaisante ? – semble pencher vers la négative. Tout comme les consultants endurcis de Röggla, elle ne fait qu’exceller dans la tâche qu’elle assume au sein de structures dont elle n’est qu’un rouage particulièrement (admirablement ?) efficace. Mais en rester à cette perspective, n’est-ce pas faire le choix du cynisme, se consoler de la mort de Philémon et Baucis avec la légèreté de Méphisto ? Quant à Lipa abandonnant son ami, écartant ainsi l’opportunité d’un nouveau départ pour au contraire s’enferrer avec son frère dans la catastrophe, elle est résolument sourde et aveugle au mal qu’elle se fait à elle-même et aux autres.
C’est dans Ce qui manque que le mal apparaît sous sa forme la plus choquante, celle d’un crime crapuleux qui garde tout son mystère, déclenchant chez le personnage principal une pulsion de violence plus intense encore, suite à laquelle il reprend espoir. Ce crime signale-t-il la place désormais vacante du diable ? Ernst Bloch, dans son Experimentum Mundi, rédigé entre 1972 et 1974, s’étonnait de ce que les Lumières qui avaient déployé tant d’efforts pour démontrer l’inexistence de Dieu, en aient consacré si peu à démontrer l’inexistence du diable41. Dans les récits évoqués ci-dessus, les souffrances humaines semblent devoir se concevoir rationnellement, comme effets produits par le fonctionnement des mécanismes sociaux, avant tout économiques. La science, clé de compréhension incontestée du monde, nous propose (nous impose ?) sa pensée de la loi, et son corollaire : la confiance dans la possible maîtrise des événements, menacée uniquement par la complexité et la diversité des phénomènes. Suffirait-il dès lors, comme le suggère Bloch, cherchant à prévenir « l’auto-extermination » imminente de l’homme, d’en appeler à une « technique d’alliance, réconciliée et concrète42 » pour nous soustraire à ce qui nous semble encore, parfois, de l’ordre du dysfonctionnement ? Comme on l’a vu chez Röggla, ceux qui assument d’être au service de la croissance se disent pourtant saturés de cette approche, dont ils perçoivent la menace y compris pour eux-mêmes. Nawrat, quant à lui, voit ses personnages persévérer dans la catastrophe, dans la voie mortifère tracée par une industrie toxique, soumise à la monnaie43.
La phrase qui accompagne le roman de Händler, complétant son titre et se dévoilant deux pages avant la fin, est une question : « Lorsque nous mourons, contre quoi échangeons-nous notre vie ? »44. Question troublante, absurde dans l’obsession qu’elle traduit d’une vision économiste de l’homme, à laquelle l’auteur du Principe Espérance aurait sans doute eu beau jeu d’opposer sa perspective marxienne : « À ce rapport abstrait avec les forces naturelles correspond […] un rapport tout aussi abstrait de l’homme avec l’homme, obéissant au devenir-marchandise des hommes et des choses dans leur ensemble45 ». Les récits commentés ci-dessus se caractérisent par leur résistance à ce « devenir-marchandise », à travers une écriture exigeante qui se soustrait à toute consommation facile, rapide ou lénifiante.