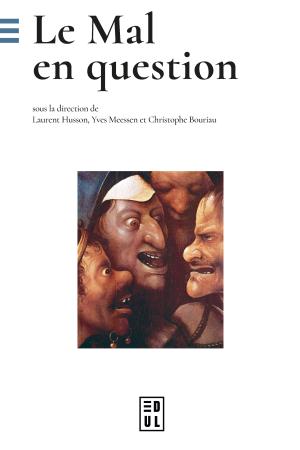
Les attentats commis par des terroristes djihadistes en France depuis 2015 ont relancé le débat inépuisable qui tourne autour de l’idée que la prison serait « l’école du crime ». À partir de petits délinquants ordinaires, elle aurait cette capacité particulière de fabriquer des criminels endurcis, aussi bien sous les formes traditionnelles du voleur ou du violeur, que sous des formes nouvelles, telles que le criminel djihadiste. De nombreux chercheurs, politologues, cliniciens et anthropologues ont avancé que les prisons allaient devenir des « écoles du djihad ». Ils ont affirmé que les prisons regorgeraient d’apprentis djihadistes, et que les mettre en contact avec des auteurs d’attentats tels que Salah Abdeslam, le seul survivant des attentats parisiens du 13 novembre 2015, fabriquerait des bataillons d’émules qui mèneraient une guerre contre la République à la première occasion.
Depuis, Salah Abdeslam a acquis un statut quasiment mythologique en prison et dans l’opinion publique. Il incarne une figure particulière, celle du mal absolu, symbole contemporain de violence, de terreur et d’inhumanité. Sa prise en charge en milieu carcéral témoigne de sa supposée dangerosité : surveillé 24 heures sur 24 grâce à des caméras de vidéo-surveillance, une cellule jumelle de la sienne est réservée pour pouvoir le déplacer à la moindre nécessité, des équipes de surveillants spécialisés sont dédiées à sa prise en charge. Même les terroristes corses, basques ou d’Action directe des années 1980 n’avaient pas connu de telles mesures sécuritaires. Pourtant, l’individu Abdeslam est une personne quelconque, sans grande personnalité ni aucune envergure maléfique, comme l’a laissé transparaitre son procès. Aucun attentat n’a été revendiqué en son nom, aucun groupuscule ne se réclame de lui, ni en France ni à l’étranger.
Pour comprendre le décalage complet entre le personnage et les représentations qu’il suscite, pour examiner le rôle de la prison dans la fabrication du mal et des individus qui le véhiculent, il est nécessaire de reconsidérer son fonctionnement, afin de comprendre la façon dont elle suscite tant de fantasmes sur le mal et les figures qui l’incarnent. Notre hypothèse est que dans une république démocratique, ce n’est pas le mal que la prison fabrique, mais les figures qui l’incarnent, car, en écho à l’expression de Claude Lefort, elle est un « lieu vide » du mal, qui nous renvoie encore et toujours à « la leçon de la terrible, de l’indicible, de l’impensable banalité du mal »1.
La prison est à la fois un bâtiment et un lieu. Un bâtiment qui a la fonction légale de contenir les prisonniers, de tracer la délimitation du dedans et du dehors vis-à-vis de la société, mais aussi un lieu de privation de liberté, où se déterminent certains rapports au mal. Elle est l’héritière de deux traditions : la prison royale et la prison monastique.
Sous l’ancien régime, la prison royale a un fonctionnement flou, ambigu, symbole de l’arbitraire et de l’injustice. Elle reflète la volonté du souverain de priver de liberté un certain nombre d’individus, sans qu’il soit nécessaire qu’ils aient été enfermés à la suite d’une sentence pénale2. Sous l’Ancien régime, à la veille de la Révolution, le roi peut décider d’envoyer un noble en prison en dehors de tout cadre judiciaire afin d’y être « oublié », et échapper ainsi à la honte d’un procès. Pour le peuple, l’enfermement n’est pas systématiquement une peine, il est généralement une rétention provisoire en attente de jugement ou de mise à exécution d’une condamnation, telle que les galères ou le bagne. Le rapport au mal est juridique et dans une moindre mesure politique. À la veille de la Révolution, la prison monarchique devient un symbole de la tyrannie à abattre. Comme l’écrit Jules Michelet : « Le monde entier connaissait, haïssait la Bastille. Bastille, tyrannie, étaient, dans toutes les langues, deux mots synonymes. Toutes les nations, à la nouvelle de sa ruine, se crurent délivrées »3.
Dans ses Réflexions sur les prisons des ordres religieux de 1724, Mabillon insiste sur la dimension miséricordieuse de l’emprisonnement, qui doit amener le pécheur au repentir en évitant de lui infliger des souffrances inutiles et dégradantes. La prison est confrontée au péché, et son principe de fonctionnement est celui de la confession et de la rédemption, qui présuppose la libre participation du détenu pour faire une telle démarche. Si elle accueille le mal, elle accueille également un être humain qui reste membre à part entière de la société qui gère la prison. Le rapport au mal est théologique, moral.
La Révolution va faire la fusion de ces deux institutions, monastique et monarchique, sous l’impulsion de réformateurs tels que Cesare Beccaria4 et Lepeletier de Saint-Fargeau5. Elle va incorporer, en la laïcisant, la dimension religieuse à la dimension politique, afin d’éliminer les caractéristiques humiliantes et infamantes, telles que la torture et la marque, et afin de supprimer les manifestations de l’absolutisme et la tyrannie royale, comme les détentions arbitraires ou sans jugement.
Conformément à la tradition monastique, l’incarcération devient la modalité de choix pour la pratique de l’examen de conscience et de l’aveu du délinquant et du criminel, qui sont la version laïcisée par la République du sacrement de pénitence et de réconciliation. Conformément à la tradition monarchique, la prison devient l’expression du pouvoir de l’état républicain issu de la Révolution, et détermine au passage une fonction fondamentale de la prison, qui est d’être la peine de référence du processus pénal. Cette référence cardinale est renforcée à l’époque contemporaine par l’abolition des galères, du bagne, de la relégation et de la peine de mort.
La Révolution formalise également les quatre fonctions de la prison moderne : protéger la société, dissuader la transgression, punir le coupable et le réhabiliter. Deux fonctions à destination de l’individu et deux à destination de la société ; elles vont déterminer le rapport au mal de la prison et conditionner les modalités par lesquelles la prison fabrique les figures qui l’incarnent.
Au sein de l’institution carcérale, en plus du rapport judiciaire, essentiel et fondateur, on peut distinguer quatre grands types de rapport au mal : le religieux, le médical, le politique et le fantasmatique.
Malgré le processus de laïcisation de l’État français initié par la Révolution, la prison a maintenu un rapport intime à la religion. Le règlement de 1841 inscrit dans la loi l’obligation faite au détenu de pratiquer sa religion et il donne une place centrale pour sa réhabilitation aux aumôniers, dont l’avis est sollicité pour les grâces et réductions de peine6. Malgré la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État, ce règlement restera valable jusqu’un milieu des années 1920. En témoignage et héritage de cette loi, les aumôniers sont aujourd’hui encore les seuls intervenants en prison, en plus des surveillants, qui ont le droit d’avoir la clé des cellules des détenus – bien que cet usage soit progressivement en train de disparaître.
La polémique de la présence du fait religieux en prison a été de nouveau soulevée avec les attentats djihadistes et le terrorisme islamiste, ce qui a conduit l’État à juger nécessaire la création d’un nouveau métier en prison, celui de médiateur du fait religieux. Cela est à mettre en rapport avec le fait qu’il n’y a jamais eu de création de postes de médiateurs du fait nationaliste ou politique pour les terroristes corses, basques ou d’Action directe, dont une caractéristique commune était d’être laïque.
Les politiciens ne sont pas les seuls révolutionnaires à s’être intéressés à la question de la prison et à la façon dont elle gérait le mal. Les médecins l’ont fait en y apportant leur regard scientifique. En s’appuyant sur les idées du siècle des Lumières, et plus particulièrement sur le concept de la perfectibilité de l’homme, Cabanis, médecin et philosophe idéologue, élève de Condorcet, a théorisé la nécessité de considérer le crime comme une maladie. Dans son Opinion sur la nécessité de réunir en un seul système commun la législation des prisons, celle des secours publics, il affirme que « ces prisons pourront devenir facilement, quand vous en aurez perfectionné l’organisation, de véritables infirmeries du crime7 : l’on y traitera cette espèce de maladie avec la même sûreté et le même espoir que les autres dérangements de l’esprit »8. Esquirol, Orfila et d’autres médecins inspirés par l’Idéologie fondent en 1829 les Annales d’hygiène publique et de médecine légale, qui se proposent « d’éclairer la moralité, de diminuer le nombre d’infirmités sociales », étant entendu que « les crimes sont des maladies de la société qu’il faut travailler à guérir ». Comme l’a montré Marc Renneville9, cet amalgame du crime et de la maladie mentale, initié par les psychiatres eux-mêmes, va perdurer au travers jusqu’à nos jours.
Le rapport politique au mal de la prison moderne est inspiré par les principes que Rousseau pose dans Le Contrat social :
Tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie, il cesse d’en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre. Alors la conservation de l’État est incompatible avec la sienne, il faut qu’un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c’est moins comme citoyen que comme ennemi10.
Ces principes sont inspirés de la philosophie politique de Hobbes qui oppose l’état de nature, où règne la guerre de « chacun contre chacun »11, à l’État de droit, qui est incarné par la société civile. Pour Rousseau, le délinquant est un ennemi et un traître à la patrie, un barbaros opposé au civis12. En intégrant ces principes politiques à la philosophie pénale, la Révolution la confronte à un problème nouveau, que n’avaient envisagé ni l’autorité monastique ni l’autorité royale, qui est la question non plus du mal moral porté par un individu pécheur isolé, mais du mal politique porté par une nation ennemie, au sein duquel l’individu n’est pas isolé, mais est une petite partie représentative d’un tout.
La formalisation rationnelle par les théologiens, médecins et politiciens des fonctions de la prison ne supprime pas pour autant le rapport passionnel que l’opinion publique entretient avec elle. Le pas à franchir entre bâtiment de présence du mal et lieu de sa fabrication est vite franchi. Le mythe de la Bastille de l’Ancien régime se métamorphose le 14 juillet 1789. De symbole de la tyrannie royale, elle devient le symbole du regroupement des ennemis de la nation, qui complotent pour sa destruction. Ce rapport fantasmatique au mal déclenche des phénomènes de peurs et de violences collectives irrationnelles, dont les massacres de septembre 1792 dans les prisons parisiennes sont l’un des épisodes les plus marquants. Frédéric Bluche rapporte que « Guiraut, commissaire de la Commune de Paris, déclare ‘‘le peuple, en exerçant sa vengeance, rendait aussi la justice’’ »13. Selon l’analyse de Claude Lefort, « l’épuration des prisons, à l’image des grandes épurations que demandera plus tard Saint-Just, s’avère guidée par la volonté de produire, grâce à la mort des ennemis, la preuve de la réalité de la Révolution »14. Les massacres de septembre sont l’illustration de l’amalgame du fantasme et du politique, et donnent lieu aux premiers accents populistes en politique. Saint-Just théorise le thème politique de l’ennemi infiltré dans les prisons dans son Rapport sur les personnes incarcérées :
Les détentions n’ont pas leur source dans les relations judiciaires, mais dans la sûreté du peuple et du gouvernement [...] Les détentions embrassent plusieurs questions politiques. [...] Aux détentions tient la perte ou le triomphe de nos ennemis [...] C’est l’étranger qui défend officieusement les criminels. Les agents naturels de cette perversité sont les hommes qui, par leur vengeance et leurs intérêts, font cause commune avec les ennemis de la République15.
Ce phénomène de l’identification des détenus incarcérés avec les ennemis à l’extérieur des frontières est très semblable aux discours politiques et aux campagnes médiatiques contemporaines suscitées par les événements en Syrie et en Irak au moment des attentats parisiens de 2015. Les débats entre les universitaires et les politiciens sont loin d’être apaisés, et la force des émotions et des fantasmes du grand public n’en est que plus grande.
La multiplicité des rapports au mal de la prison et les diverses fonctions qui y sont liées contribuent à faire de la prison une « institution totalitaire »16, telle que Erving Goffman l’a décrite, ce qui permet la fabrication de la « figure totale du mal » dont a besoin la société pour s’orienter dans la morale. Un facteur constitutif de cette dimension totalitaire est d’ordre administratif. La prison est sous l’autorité de quatre ministères différents : ceux de la Justice, de l’Intérieur (qui gère les cultes et aumôneries), de la Santé et de l’Éducation nationale. Tous les aspects de la vie sociale et intime du prisonnier sont sous le contrôle de l’État. Soulignons que la présence en prison du corps médical psychiatrique n’est pas uniquement dictée par des impératifs médicaux et de santé publique, elle est aussi dictée par l’hypothèse fondatrice que la prison doit être « l’infirmerie du crime ». L’intervention médicale, et plus particulièrement celle du psychiatre, contribue à la fabrication de la figure totale du mal, en y apportant une caution scientifique17.
La capacité de réhabilitation et de réinsertion de la prison signifie pour le contrat social que dans une société donnée, la figure du mal n’est ni immuable ni permanente, mais est en perpétuelle évolution. En fonction de ses normes morales du moment, chaque siècle, chaque génération, définit ses propres figures, qui ne sont pas nécessairement celles de la génération précédente ou de la suivante. Comme l’a observé Beccaria :
Quiconque lira les codes et les annales des nations avec un œil philosophique trouvera presque toujours que les noms de vice et de vertu, de bon citoyen ou de coupable [reo], changent avec les révolutions des siècles [...] en raison des passions et des erreurs qui ont successivement agité les différents législateurs. Il verra bien souvent que les passions d’un siècle sont la base de la morale des siècles futurs, que les passions fortes, filles du fanatisme et de l’enthousiasme, affaiblies et rongées, si je puis dire, par le temps, qui ramène à l’équilibre tous les phénomènes physiques et moraux, deviennent peu à peu la prudence du siècle18.
En corrélation avec les normes morales, les normes judiciaires et pénales changent selon les siècles et les pays. Kant critique « la sensiblerie sympathisante d’une humanité affectée (compassibilitas) » de Beccaria, et estime que sa volonté d’abolition de la peine de mort « n’est que sophisme et chicane ». Il pousse sa propre logique jusqu’à son terme et en déduit que l’infanticide maternel d’un enfant né hors mariage n’est pas punissable pénalement, car dans ce cas « l’enfant est né hors la loi [...] et par conséquent est en dehors de sa protection »19. Pour Kant, le sentiment de honte de la mère constitue la sanction pénale et morale de sa transgression de la loi. Aujourd’hui, la honte de la mère infanticide serait liée au meurtre commis, et non pas aux raisons du meurtre. Ce qui aurait été excusé à un moment donné devient deux siècles plus tard un crime monstrueux.
Les figures du mal sont des archétypes sociaux, dont la fonction est de refléter les angoisses de la société. Elles peuvent servir de boucs émissaires en réponse aux drames et tragédies qui jalonnent l’histoire. Citons quelques-unes apparues au fil de l’histoire de la société française : la sorcière, l’hérétique, le contre-révolutionnaire, le parricide, l’héroïnomane, le pédophile, qui, comme des personnages de théâtre, interviennent au bon moment dans l’espace public pour y tenir leur rôle. Pour toute société, quel que soit son bagage culturel et scientifique, construire de telles figures du mal est un processus systématique, car elles permettent de donner un visage et un nom aux angoisses collectives qui viennent l’assaillir, et par conséquent définir les normes morales et calibrer son indispensable boussole morale afin de déterminer les stratégies pour s’opposer à ces figures du mal.
La société évoluant au fil du temps, les angoisses d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. La sorcière devient une malade psychiatrique, l’hérétique un adepte d’une secte religieuse, l’insurgé un réactionnaire, le parricide un assassin de droit commun, l’héroïnomane un usager de produits stupéfiants. Chaque génération a besoin de reconstruire la figure du mal que lui réclame l’actualité, ce qui explique la place centrale qu’occupe le djihadiste dans le débat contemporain.
Le changement majeur du paradigme de l’emprisonnement au moment de la Révolution consiste à faire passer la prison d’un lieu de rapport au mal judiciaire à un lieu de rapport au mal politique. Ce mal politique se trouve aussi bien dans le rapport de l’État à ses citoyens que des États entre eux. La prison, d’outil de gestion légale de la criminalité, devient un outil de gestion politique de la sûreté de la nation. Cette menace existentielle va contribuer à alimenter les fantasmes sur les figures du mal, les personnes qui les incarnent, et va donner naissance à des peurs collectives irrationnelles. Elle va également favoriser l’utilisation de la contrainte sous toutes ses possibilités pour faire face à cette menace. Comme l’écrit Alexis de Tocqueville en 1831, infliger le mal sous forme d’une sévérité extrême est présumé être une garantie de l’efficacité de la prison :
[Il faut répudier] cette fausse philanthropie qui, si on l’écoutait, ferait des prisons des séjours agréables ; les hommes que la société repousse de son sein doivent trouver dans l’emprisonnement tous les châtiments rigoureux qui ne répugnent pas à l’humanité ; nous voulons un système pénitentiaire qui les rende meilleurs sans adoucir leur sort20.
Symbole de la lutte contre le mal par le mal, la prison devient le lieu privilégié de l’exercice par l’État de son « monopole de la violence physique légitime »21 et de la violence guerrière.
Les symptômes de l’amalgame du prisonnier et de l’ennemi, de la prison comme lieu de guerre contre les barbaros, se retrouvent dans la présence de signes militaires dans la prison moderne. Les surveillants ont des grades militaires, et s’il n’y a pas de seconde classe ou de caporal, il y a néanmoins des majors, lieutenants, capitaines, commandants ; les cérémonies officielles se font avec des équipes en rang et au garde-à-vous, devant le drapeau national, au son de la Marseillaise ; les surveillants pénitentiaires défilent parfois aux côtés des armées lors des cérémonies du 14 juillet ; en cas de tentative d’évasion, les surveillants peuvent faire usage de leur arme à feu, même si l’évadé a le statut de prévenu en attente de jugement, donc est présumé innocent.
Si de surcroît le détenu a fait part de ses convictions radicales islamistes, il devient un combattant armé au service d’une puissance étrangère. Cela a incité, dès le lendemain des attentats de 2015, de nombreux politiciens et personnalités publiques à réclamer la déchéance de la nationalité – l’exclusion du contrat social – pour tous ces individus. Plusieurs de ces mesures ont été effectivement prononcées, bien qu’aucun argument ne permette d’assurer qu’elles ont contribué à améliorer la sûreté des citoyens.
En dépit de cela, la prison réinsère et réhabilite une bonne partie des personnes qu’elle accueille. Même si la récidive reste un problème majeur du système pénal, une fois leur peine effectuée, la majorité des détenus ne reviennent plus jamais en prison. À leur sortie de détention, ils sont délivrés de leur statut d’ennemi, de barbaros, et retrouvent leur identité d’ami, de civis. Huit ans après les événements de 2015, environ la moitié des personnes incarcérées en lien avec les attentats djihadistes ont été libérés, seule une toute petite minorité a été déchue de sa nationalité.
Bien que supposée être une école du crime et du djihadisme, et bien que destinée à être un lieu de contrôle des ennemis, la prison les réhabilite et les réintègre régulièrement dans la société. Pour comprendre ce paradoxe, il faut partir de l’hypothèse que la prison, en démocratie, a vocation à être un « lieu vide » du mal, en écho aux termes de Claude Lefort :
La démocratie moderne témoigne d’une mise en forme très singulière de la société dont on chercherait en vain des modèles dans le passé, bien qu’elle ne soit pas sans héritage. [...] Nous nous sommes pour notre part, depuis longtemps attaché à cette singularité de la démocratie moderne : de tous les régimes que nous connaissons, elle est le seul dans lequel soit aménagé une représentation du pouvoir qui atteste qu’il est un lieu vide, qui maintienne ainsi l’écart du symbolique et du réel. Cela, par la vertu d’un discours d’où ressort qu’il n’appartient à personne ; que ceux qui l’exercent ne le détiennent pas, mieux, ne l’incarnent pas22.
Lefort précise encore que ce lieu est vide car « nul individu, nul groupe ne peut lui être consubstantiel »23. Cette notion de lieu vide du pouvoir en démocratie avait été pressentie par Michelet :
Le Champ de Mars, voilà le seul monument qu’a laissé la Révolution... L’empire a sa colonne, et il a pris encore presque à lui seul l’Arc de Triomphe ; la Royauté a son Louvre, ses Invalides ; la féodale église de 1200 trône encore à Notre-Dame ; il n’est pas jusqu’aux Romains, qui n’aient les Thermes de César. Et la Révolution a pour monument... le vide...24.
Il peut sembler paradoxal que la prison, définie comme une institution totalitaire d’enfermement du mal, en soit vidée. Ce serait faire l’erreur de confondre le contenant et le contenu. Une caractéristique spécifique de la figure du mal est qu’elle n’est ni absolue ni définitive. Hier, le djihadiste était un inconnu dans les prisons françaises ; aujourd’hui, il en est le point de repère, à partir duquel l’opinion publique estime la gravité des crimes et l’ampleur du mal ; demain, une autre figure prendra sa place et déterminera d’autres normes. La prison n’est vide que d’une figure qui serait présente de façon permanente et définitive. La prison se remplit et se vide dans un flux continu, qui n’est pas sans rappeler le fleuve d’Héraclite. Elle est un lieu de passage, de circulation, de ces figures successives, selon le rythme de leur fabrication, dicté par les fantasmes populaires et les choix politiques.
En réponse aux menaces à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières de l’État, la prison est un outil qui permet l’exclusion de ou l’inclusion dans le contrat social, elle favorise l’articulation entre la politique et le politique. Elle est un espace de transition, un schème du contrat social, qui relie l’ami et l’ennemi, le bien et le mal, car elle n’en fabrique pas les figures, mais elle détermine uniquement le lieu qui les construit et qui a également la possibilité de les réformer, les réhabiliter. Étant un lieu vide du mal, la prison peut être un schème entre l’état de guerre de Hobbes et la société contractuelle de Rousseau, entre le civis et le barbaros.
Le crime d’hier devient le banal d’aujourd’hui et le banal d’aujourd’hui sera le crime de demain. Il ne faut pas pour autant craindre de ce phénomène qu’il brouille les principes moraux et éthiques de la société, car ils ne sont pas dépendants de la figure du mal de référence. Si la prison est le lieu vide du mal, elle n’est pas pour autant le lieu vide de morale ou de justice.
Deux principes éthiques ont été posés au moment de la création de la prison moderne, l’utilitarisme et l’impératif catégorique. Le premier principe est exposé par Beccaria dans l’introduction des Délits et des peines. Il cite la maxime « le bonheur le plus grand partagé par le plus grand nombre »25 comme étant le « point de vue » que doit avoir le législateur pour promulguer les lois. Le second principe est exprimé par Kant dans la Doctrine du droit, au paragraphe Du droit de punir et de gracier : « L’homme ne peut jamais être traité comme un simple moyen pour les desseins d’autrui ni être confondu avec les objets du droit réel, ce contre quoi le protège sa personnalité innée, quoiqu’il soit bel et bien susceptible d’être condamné à perdre sa personnalité civile »26. L’objet de ce travail n’est pas de faire une étude critique comparative de ces deux principes. Mais il est nécessaire de rappeler que les principes juridiques ne doivent leur pérennité ou leur révocation qu’à des choix politiques, et non pas à la nature des figures totales du mal de référence.
La fabrication de la figure totale du mal conduit au danger de ne pas l’inscrire dans le réel, mais de le maintenir dans le fantasme de l’opinion publique. Le péril de ce processus est de créer une figure mythologique là où il n’existe qu’un individu. Dans une lettre à Hannah Arendt datée du 10 octobre 1946, Karl Jaspers met en garde contre les dangers des fantasmes de l’opinion publique, qui conduisent à la mythologisation du mal :
Ce que les nazis ont fait ne se laisserait pas, selon vous, comprendre comme un crime ; votre conception m’inquiète un peu du fait que la faute criminelle acquiert inévitablement une certaine « grandeur » – une grandeur satanique, qui, pour ce qui est des nazis, est aussi loin de moi que les discours sur le « démonisme » de Hitler et autres choses de cette sorte. À mon avis, c’est parce qu’il en a vraiment été ainsi qu’il faut voir les choses dans toute leur banalité, dans leur prosaïque nullité – les bactéries peuvent provoquer des épidémies anéantissant des populations entières et ne resteront pourtant que des bactéries. Je vois avec frayeur toute amorce de mythe et de légende, et tout ce qui est obscur constitue déjà une telle amorce27.
[...] Votre description a déjà presque le ton de la création littéraire. Et un Shakespeare ne saurait jamais traiter ce sujet de façon adéquate – son sens esthétique l’entraînerait à falsifier les choses28.
À l’image d’Eichmann ou du djihadiste Salah Abdeslam, la fabrication d’une figure du mal est possible parce que, si l’acte absolument mauvais peut exister, tel que le génocide, la personne absolument mauvaise, telle que le monstre ou le diable, n’existe pas.
La figure du djihadiste est construite sur un certain nombre d’idées reçues. Les plus courantes sont qu’il serait en échec scolaire, fou, criminel, en rupture de famille et sans avenir. Ses échecs répétés le conduiraient à vouloir prendre sa revanche sur la société, en s’y attaquant les armes à la main. À l’inverse de ces clichés, comme le montrent aussi bien les enquêtes policières que les recherches universitaires, ces individus sont nés et ont grandi dans nos villes, ont été éduqués par nos écoles républicaines. La moitié d’entre eux ont fait des études professionnelles et supérieures29 et la très grande majorité n’avait aucun antécédent judiciaire avant de s’engager dans le djihad30. L’immense majorité des djihadistes, tout comme l’immense majorité des criminels de droit commun, sont des gens ordinaires qui ont fait un choix extraordinaire. Ils ne sont pas des génies du crime, mais des apprentis sorciers de la transgression. Ils ont fait un choix réfléchi, à défaut d’être moralement ou légalement acceptable, en se laissant aveugler par le projet du djihad, qui est bien plus d’ordre mythologique que théologique ou politique31.
L’exemple des djihadistes montre que la figure du mal d’un moment donné n’est pas proportionnelle à la dangerosité criminologique. Les criminels considérés comme les plus dangereux, tels que les trafiquants de drogues ou les délinquants sexuels et proxénètes agissant au sein de réseaux internationaux – individus responsables d’autant si ce n’est plus de corruption, de crimes et de meurtres que les terroristes djihadistes –, les autorités publiques n’ont jamais estimé nécessaire d’en faire des figures du mal. Jamais la déchéance de leur nationalité n’a été requise par les politiciens ou la société civile. Pourtant, la menace à l’ordre public, le risque de corruption politique et de désagrégation de l’État que représentent ces filières sont largement documentés dans de nombreux pays, sur chaque continent, quel que soit leur niveau de développement économique ou culturel.
La prison est un lieu de passage des figures du mal, à l’image du pharmakon grec qui est à la fois remède et poison, inclusion et exclusion. Si elle peut attribuer un statut de figure total du mal à un individu, avec le risque qu’il acquière un statut mythologique, elle ne l’enferme pas pour autant définitivement dans un tel statut. Elle maintient son inscription dans le réel, et par là même met en évidence sa banalité et sa normalité. L’une des plus anciennes fonctions de la prison est sa capacité de prévention du crime, en exhibant les condamnés et les peines subies. Elle est un mécanisme régulateur des angoisses et passions, en montrant par l’exemple que les monstres n’existent nulle part ailleurs que dans l’imagination de quiconque veut bien y croire.
Si la question du mal reste « un défi à la philosophie et à la théologie »32, la question de la personne qui lui donne sa figure n’est pas sans résolution. Le djihadiste Abdeslam aurait pu être décrit par Hannah Arendt avec les mêmes termes que ceux dont elle s’est servie pour décrire Eichmann : « Il n’était pas stupide. C’est la pure absence de pensée – ce qui n’est pas du tout la même chose que la stupidité – qui lui a permis de devenir un des plus grands criminels de son époque »33, car « la triste vérité est que la plus grande part du mal est faite par des gens qui ne se sont jamais décidés à être bons ou mauvais »34.