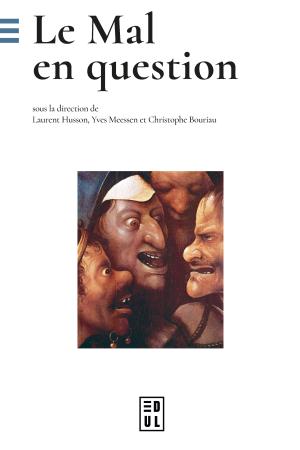
Figuration, présentation, représentation, le massacre apparaît comme une version du mal. S’il n’est pas question de l’aborder hors de toute contextualisation, on s’attachera cependant au mal dans des pensées particulières, puisqu’elles ne passent pas par le discours mais par les images. Ainsi les tableaux, films, photographies ne seront pas considérés comme des échantillons illustratifs mais bien comme des propositions pour « penser » le mal dans sa représentation au travers d’une scène particulière, celle du massacre1, qui connaît une dialectisation entre le visible et l’invisible, le montrable et l’immontrable.
Le massacre est une construction de l’intolérable. Sa définition, donc sa reconnaissance, est liée à un seuil moral qui est aussi un seuil de représentation. Le seuil de violence tolérable dépend des fondements anthropologiques, historiques et culturels d’une société. Ainsi le seuil, qui voit passer une pratique de guerre ordinaire à un scandale moral intolérable, relève d’une question morale qui est redoublée par la question de sa représentation. Qu’est-ce qui se joue, concernant le mal, entre le massacre et son régime de visibilité ?
Il ne s’agit pas de s’interroger sur la déontologie du reporter ou du photographe de guerre, tiraillé entre révélation de la preuve et risque de la fascination morbide. Il ne s’agit pas non plus de comprendre à nouveaux frais la proposition d’Adorno concernant la poésie et la musique après Auschwitz2, même si l’effroi sidéré et le risque de l’obscénité dessinent des limites à toute tentative de représentation. Mais la question morale après Auschwitz ainsi que les interrogations sur les formes des représentations mémorielles ne rendent pas compte du rapport singulier entre l’œuvre et le massacre ainsi représenté. Ont pu être soulignés « trois écueils majeurs » dans les sciences sociales concernant « l’écriture de la violence » : la spectacularisation, l’aseptisation et la moralisation3. Or, dès lors qu’il s’agit d’une représentation de la violence extrême qu’est la perpétration d’un massacre, la spectacularisation peut être au service de la condamnation comme de l’atténuation ; elle peut aussi jouer de ce qui est montré comme de ce qui ne l’est pas, possibilité refusée aux sciences sociales dans leur visée analytique. Pour autant le risque de l’obscène, comme mal qui redouble celui des faits, est bien présent.
Les œuvres, donc les propositions, que j’aborde, si elles passent par le spectaculaire, le font dans un cadre qui se veut moralisant, au sens où ce qui est montré est présenté comme une version du mal. Or il n’est pas seulement une question de culture et de seuil anthropologique de tolérance. Il y aurait des choses qu’on ne montre jamais. Sorj Chalandon, comparant l’image et l’écriture, affirme qu’un photographe ne peut pas montrer ce qu’il a vu en entrant en 1982 à Sabra et Chatila : une femme palestinienne massacrée, le ventre ouvert avec son bébé arraché mais encore relié à elle par le cordon ombilical. Il ne connaît pas de représentation de cette scène et pose comme un interdit de la montrer, en l’occurrence de la photographier. On ne peut pas la montrer mais il peut l’écrire4. Sorj Chalandon rejoint Samuel Fuller réfléchissant à son art en relation avec son expérience, lui qui est entré, également parmi les premiers, avec l’armée états-unienne, dans le camp de Falkenau à la fin de la Seconde Guerre mondiale5. Celui-ci distingue ainsi nettement la « réalité » et la « fiction » : on ne peut pas montrer tout de la guerre dans une fiction. La guerre est sale, horrible, avec des corps démembrés, etc., qui ne peuvent se retrouver imagés dans la fiction. D’une certaine manière, même s’il ne le dit pas ainsi, la fiction, pour le massacre, doit être abstraite.
On trouve pourtant des exemples de corps mutilés présentés où l’effroi est recherché, par exemple Saint Érasme éviscéré peint par Nicolas Poussin (1628-1629)6, ou le massacre de la Saint-Barthélemy présentant force détails atroces par François Dubois (c. 1572-1584) : on remarquera à droite une femme ventre ouvert et le bébé à ses côtés7. Si l’on accorde que N. Poussin n’est pas contemporain du massacre perpétré par Hérode, en revanche F. Dubois est le strict contemporain de la Saint-Barthélemy. Est-ce seulement que le seuil de tolérance est plus faible au 16e siècle qu’il ne l’est au 21e siècle ? Nous cacherons-nous derrière la distinction entre la photographie prétendument « vériste » et la peinture fictionnante donc « non réaliste » ? Nous ne pouvons nous en tenir à l’idée qu’il y a du montrable et de l’immontrable et que cela dépend des époques et de l’histoire des arts.
Le massacre, dans son excès, peut nous apporter des réponses. Il est par excellence la représentation de cette violence qui s’en prend aux corps de personnes désarmées, c’est-à-dire innocentes dit Emer de Vattel8. Le massacre, surtout, c’est un grand nombre de personnes vulnérables tuées indistinctement. David El Kenz parle de « meurtre en grand nombre de personnes sans défense. Il implique donc une dissymétrie entre des bourreaux et des victimes »9. Jacques Sémelin évoque « une forme d’action, le plus souvent collective, visant à détruire des non-combattants, hommes, femmes, enfants ou soldats désarmés »10. Et Wolfgang Sofsky considère qu’il y a « dans le combat une résistance à vaincre, et dans la chasse des fugitifs à rattraper. Le massacre, en revanche, est de la violence pure, rien d’autre… L’uniformité des massacres ne tient pas à l’identité des objectifs, mais à la dynamique universelle de la violence absolue »11. Le massacre visible consiste d’abord dans des victimes innocentes tuées de façon violente et collective, dont la vulnérabilité atteint le point de défaillance ; des corps nus, exposés, sans défense. Les morts comme les encore vivants amoncelés.
Le passage par la fiction, ou par la représentation, n’écarte pas absolument le risque de l’obscénité, mais la tient davantage à distance que lorsqu’il s’agit de personnes et non pas de personnages. Le pacte de fiction transforme la réalité et autorise les représentations. Aussi l’une des matrices de la représentation du massacre est-elle le tableau de l’épisode biblique du massacre des enfants juifs de Bethléem, dont la résonance est triple : les très jeunes enfants sont le symbole même de l’innocence et de la vulnérabilité ; l’épisode est reculé, voire fictif (même s’il a une probable origine historique) ; il a une dimension moralisante et religieuse. La victime est traitée comme un « grand sujet », elle est montrable alors même que la scène est une scène d’horreur. La victime s’appartient encore, alors que, montrée dans sa posture de mort, elle pourrait faire l’objet d’un traitement irrespectueux, par exemple si sa posture est étrange ou impudique, ou si la prise de vue, le cadre, sont intrusifs. Dans la représentation du massacre, qui par définition montre plusieurs victimes et des manières différentes de mourir, la victime est saisie par une apparence d’emblée dérangeante : morte ou sur le point de mourir.
L’obscénité est ce qui blesse la pudeur, du regardé, du regardeur. Il demeure, malgré les études, une ambiguïté étymologique concernant le préfixe « ob- » : l’obscène, est-ce ce qui doit rester hors scène ou ce qui est devant la scène ? Immontrable parce que terrifiant et indigne, ou montrable pour interdire toute répétition ? S’il n’est pas question d’ignorer la question morale, il faut aussi, d’abord, se poser la question « qu’est-ce que l’on montre ? » avant de se demander si l’on a le droit de le montrer.
Si la monstration du massacre a souvent des visées morales, édifiantes et terrifiantes, on ne peut s’en tenir à la préoccupation morale qui s’applique aussi à d’autres scènes. Le massacre est une violence à la fois extrême et pure, pour reprendre Wolfgang Sofsky. Et finalement il n’y a pas tant de représentations de massacre que cela dans l’histoire de l’art occidental. Existent des scènes terrifiantes, pathétiques et tragiques, mais pour le massacre tel que nous l’avons défini, il existe peu de représentations. Certes le massacre en temps de guerre a donné lieu à des constantes picturales : le champ de bataille abandonné jonché de cadavres, les vainqueurs qui célèbrent la bataille gagnée devant des morts en nombre dont ils sont le symbole, ou encore la dénonciation des désastres avec Jacques Callot ou Francisco Goya. Ces deux auteurs dénoncent les horreurs de la guerre, et pour ce faire convoquent la représentation nue et parfois difforme et monstrueuse de la mort. Ils pourraient selon certains critères tomber sous le qualificatif d’obscène, parce qu’ils dépassent la limite du tolérable pour faire apparaître une obscénité propre à la guerre. On prendra soin, par conséquent, de distinguer l’obscénité, qui peut valoir démonstration, et l’abjection, qui se signale par la volonté dégradante physiquement et moralement12. Le devant de la scène, ou le premier plan, constituent alors un espace de monstration, particulièrement adapté à la monstruosité que Callot et Goya veulent déceler de la guerre. L’étymologie commune à « montrer » et « monstre », à savoir monstrare en latin, n’a jamais eu plus de sens.
Pour frappantes que soient leurs représentations, elles ne sont pourtant pas vraiment des scènes de massacre. Car le massacre se montre par l’amoncellement des corps. Le nombre est un élément fondamental. Un massacre, c’est une foule, une masse de corps. Révélatrice à cet égard est la description par Thucydide du massacre des Athéniens dans les Latomies de Sicile pendant la guerre du Péloponnèse : accumulation dans un espace étroit, morts sur place qui gisent pêle-mêle, entassés les uns sur les autres13. Cette matrice de la description d’un massacre passe ici par les mots. Deux autres matrices sont à prendre en compte, cette fois dans nos représentations par images, le génocide des Juifs d’Europe14 et, en peinture, le massacre des Innocents, parfois convoqué pour les représentations de la Saint-Barthélemy. À cet égard la profondeur traitée en perspective exprime le massacre en nombre et sa violence extrême. Si l’on ne peut écarter la possibilité que le massacre des Innocents suive un canon artistique et des règles de représentation communes, il n’en demeure pas moins que les choix tendent à valoriser ce qui, à mes yeux, fait l’essence du massacre représenté : le nombre et les corps. Le massacre induit une récurrence dans la représentation et dans nos représentations mentales.
Le tableau de François Dubois opte pour plusieurs perspectives au sein du même tableau pour multiplier les étroites échappées latérales vers le fond (qui relatent par exemple différents moments d’un épisode, comme le meurtre de Coligny). L’étroite échappée vers le point de fuite contrebalance un premier plan frappant. La pratique est très évocatrice, elle est présente dans les massacres des Innocents : le premier plan frappe de sidération par la violence montrée et le nombre en masse est redoublé par l’échappée perspective étroite qui suggère que le massacre est infini. Ainsi le massacre est non seulement en nombre, mais il est aussi infini. On rencontre ce principe de distribution dans de nombreuses représentations d’Albrecht Altdorfer (Le Massacre des Innocents15), de Pierre Paul Rubens (Le Massacre des Innocents, 1636-163816), ou de Cornelisz Van Haarlem (Le Massacre des Innocents, c. 159017)…
La signification religieuse est explicite ; la référence politique aux guerres de Religion, dans les exemples évoqués, est transparente. Si les huit guerres de Religion en France se passent dans la deuxième moitié du 16e siècle, les conflits aux Pays-Bas espagnols sont antérieurs (guerre de Quatre-vingts ans) et de surcroît marqués par des épisodes iconoclastes18. L’épisode peut donc avoir un sens métaphorique. Le meurtre de masse est déplacé et démultiplié. L’échappée perspective m’apparaît comme une marque essentielle de la représentation du massacre, que ce soit dans la figuration matricielle des Innocents ou dans celle des massacres entre protestants et catholiques (ce qui ne veut évidemment pas dire que toute échappée perspective évoque le massacre). Il faut représenter la foule, la mort violente ; le choix consiste à représenter l’innombrable par le nombrable. L’innombrable est la trace du scandale moral, le nombrable la solution de représentation. Ce qu’expriment et pensent certains peintres de massacres dans la période des 16e et 17e siècles, c’est l’amoncellement des corps, dans une utilisation du thème des massacres d’Hérode et une idiosyncrasie par le désordre des corps humains accumulés et enchevêtrés, par exemple Franz Hogenberg (Le Massacre de la population de la ville néerlandaise d’Oudewater par les Espagnols pendant la guerre de Quatre-Vingts Ans, 1550)19.
Le tableau de Brueghel l’Ancien (Le Massacre des Innocents, c. 1565-156720) et les copies de Brueghel le Jeune, tout en inscrivant clairement la scène dans le contexte des guerres de Religion en Europe, choisissent le déplacement et l’exemplarité, tout en maintenant l’accumulation. Plutôt que sur l’horreur, le tableau insiste sur le nombre et le foisonnement, reprend la multiplicité des corps. On peut même parler de singularité multiple : les petits personnages répartis sur le tableau donnent une idée de nombre et en même temps sont autant de singularités participant de saynètes tragiques. L’accumulation est rendue par la démultiplication qui perd le regard. Si la multiplication des personnages est une manière qui est propre à Brueghel, présente dans d’autres sujets traités, il reste qu’il réutilise l’accumulation pour dire le massacre ainsi que l’échappée perspective, dessinée par la ruelle et les maisons dans un mouvement vers la gauche. La vision du mal s’impose au regard, de façon expressive et pathétique. Le massacre représenté propose ainsi un paradoxe, étalé en images et non pas résolu en discours. Dans une œuvre, habituellement, le singulier vaut pour l’universel, le petit nombre pour le grand nombre. Or le massacre représenté expose une singularité en nombre pour représenter un innombrable, c’est du moins la proposition de certains peintres attentifs aux caractéristiques essentielles du massacre. On peut en déduire, grâce à la représentation imagée, le sens de l’amoncellement comme version du mal : en nombre innombrable.
Une autre proposition de pensée par image existe cependant, dans la même période. C’est la proposition métonymique qui, précisément, choisit de présenter le singulier pour l’universel, le petit nombre pour le grand nombre, et qui privilégie la frontalité du mal imposé au regard plutôt que l’échappée perspective. Nicolas Poussin21 reprend sans doute des précédents lorsqu’il peint le massacre des Innocents (1624-1632)22 ; parmi ceux-ci sans doute Guido Reni (Le Massacre des Innocents, 1611)23 qui, tout en insistant sur la frontalité d’un premier plan envahissant, maintient une courte échappée. Le sujet, chez Reni et chez Poussin, se concentre sur quelques personnages : un soldat, une mère et un nourrisson qui occupent le premier plan d’une scène atroce puisque le soldat s’apprête à tuer l’enfant. Si Reni peint un enchevêtrement de corps, même en nombre limité, Poussin réduit le nombre à l’extrême et bouche complètement l’échappée possible. L’infini du massacre est occulté pour privilégier l’horreur du meurtre d’enfant, qui apparaît bien souvent comme le mal absolu. Le choix est évidemment concentré, encore plus frontal que d’habitude chez Poussin, et il est métonymique, comme souvent chez lui, qui lui fait négliger sciemment la lettre de la référence à l’évangile de Saint Matthieu. Le grand nombre est ainsi représenté métonymiquement par trois personnages principaux qui exemplifient la scène de meurtre de masse, dans des postures qui présentent le mal : les poses dans le tableau de Reni restent tragiques et s’insèrent dans un mouvement d’ensemble, là où Poussin insiste sur le pied du soldat qui écrase déjà l’enfant sur le point d’être tué. Chez Reni, le mouvement est général et l’enfant est déjà mort ; chez Poussin il est particulier et l’enfant est sur le point de mourir, comme si le spectateur devait assister en permanence à ce supplice aussi rapide qu’il est horrible. À l’évidence, le seuil de tolérance n’est pas un critère d’appréciation morale du tableau. Nous sommes devant le thème du massacre comme version du mal absolu.
Le particulier concentré et synthétique est censé avoir d’autant plus de force évocatrice. Cette force est due aussi à ce que j’ai appelé un rapport métonymique, qui serait plutôt ici à interpréter dans le sens de la contiguïté plutôt que de la partie pour le tout. Les personnages au second plan du tableau de Poussin sont comme des incarnations de la profondeur quasi inexistante dans les édifices et le paysage : ils remplacent la perspective et sont des versions d’un progressif éloignement. Le massacre se pense comme en contiguïté des personnages qui ne sont pas enchevêtrés, comme chez Guido Reni, mais qui s’éloignent progressivement, porteurs du massacre en train de se faire et seulement donné par suggestion.
On retrouve la métonymie pour exprimer le massacre dans certains choix de conservation mémorielle dans des lieux du génocide au Rwanda. Les mémoriaux de Nyamata et de Murambi par exemple exposent des amoncellements de vêtements qui gardent les traces fantomatiques des innombrables corps massacrés sur place. L’amoncellement, par les vêtements, est matériellement là, et il est mobilisé pour l’effet métonymique des corps qui les ont revêtus et dont ils gardent parfois la forme, tout au moins une trace. Les tissus miment l’amoncellement des corps tués en nombre et matérialisent le rapport métonymique puisqu’ils sont là en lieu et place des personnes qui n’auraient pas dû être tuées. C’est le même effet mémoriel recherché au musée d’Auschwitz qui présente des montagnes d’objets, de vêtements, de chaussures, ayant appartenu aux personnes déportées et exterminées. La métonymie est encore plus troublante lorsque la matérialité ne se situe pas clairement soit dans le littéral, soit dans le métaphorique ; je pense au choix de momifier les corps tués pour en conserver la forme à défaut de la chair au mémorial de Murambi. Sommes-nous devant une évocation ou sommes-nous devant les corps, donc les personnes elles-mêmes24 ?
Le massacre représenté comme version du mal, dans la frontalité du massacre des Innocents ou dans la métonymie des amoncellements de vêtements comme témoignage du génocide, est ainsi objet de monstration. Ces représentations sont autant de tentatives d’éviter l’abject sans renoncer au spectaculaire. Le spectaculaire est en l’occurrence un travail de l’obscène, qui le montre tout en en dénonçant le mal intrinsèque. L’enchevêtrement des corps, l’accumulation de vêtements, expriment le massacre comme mal, peut-être mal absolu de la violence pure – nos exemples sont des exemples de massacre d’enfants et de génocide, plus qu’exemplaires ils sont la quintessence du mal. Cependant, la comparaison – qui ne vaut ni en histoire ni en histoire de l’art, nous en sommes conscients – entre les tableaux du massacre des Innocents et les mémoriaux des génocides des Juifs et des Tutsi amène une autre question. La monstration frappante n’est pas la seule pensée possible du massacre, il y aurait même une pensée qui impose moralement de ne pas le montrer, de renoncer au spectaculaire et ainsi de se garantir contre l’abjection, comme si, au 20e siècle, il y avait un interdit moral de montrer le génocide.
Je laisse de côté le paradoxe qui consiste, si l’on prend un tout petit peu de distance, à accepter un génocide et à ne pas tolérer sa représentation, ou tout au moins sa figuration, comme si le seuil de tolérance dans la fiction s’était abaissé après que le seuil de tolérance au génocide s’était dramatiquement élevé. C’est peut-être ce paradoxe qui permettrait de voir clair dans les polémiques dont le point de départ a été le « travelling de Kapo » dénoncé par Jacques Rivette et qui se poursuivent avec celle initiée par des amis de Claude Lanzmann, notamment contre Georges Didi-Huberman, d’abord sur l’exposition des quatre photos prises depuis la chambre à gaz d’Auschwitz, puis sur toute représentation, documentaire ou fictionnée, du génocide des Juifs d’Europe25.
Je me permets de revenir à l’une des interrogations principales soulevées lors des travaux du programme Parabaïnô qui, entre autres, s’est attelé à constituer une banque de données presque exhaustive sur les textes relatant des massacres dans l’Antiquité. L’impression que la Grèce et Rome, dans leur période classique, ont connu de nombreux massacres, et le sentiment d’y voir une tolérance à la violence de masse comprise dans la conduite habituelle de la guerre, sont sans doute faux. Le scandale moral, ou simplement l’émotion, étaient bien présents, même s’ils ne sont pas construits dans le discours et obéissent à d’autres normes morales. Quant aux représentations, elles relèvent souvent de ce que j’ai appelé l’effet métonymique. Les batailles, sur les vases attiques, présentent quelques personnages, présentations qui sont en outre marquées par le modèle homérique du duel, abondamment représenté26.
Pourquoi certaines mutilations sont-elles représentées sans problème, tandis que d’autres sont occultées ? Est représentée la guerre de Troie (Ilioupersis) à travers les affrontements singuliers : meurtre de Priam par Néoptolème, Ajax agressant Cassandre, parfois entourés de quelques guerriers anonymes. Le meurtre des prétendants par Ulysse est sans doute le seul massacre représenté en nombre et avec des corps mutilés, mais l’épisode est plus un exemple de massacre nécessaire que de massacre intolérable, en tout cas, ce ne sont pas des innocents qui sont tués là27. Même si nous accordons qu’il s’agit de conventions et de références normatives différentes, celles-ci sont nécessairement ordonnées à un impératif sans doute moral et les études anthropologiques sont requises. Ce n’est pas notre propos. Prêtons attention à ceci : la monstration du massacre (un certain type de) est concomitante de l’occultation du massacre (un certain type de). Le régime de monstration ne va pas sans régime d’occultation. Et si l’amoncellement dit quelque chose du massacre comme version du mal, masquer tout ou partie de celui-ci en dit aussi quelque chose (avant de devenir un impératif moral de l’art pour certains). On passe donc du massacre représenté à la représentation du massacre, qui peut adopter des formes non littérales, peut-être métonymiques, sans doute métaphoriques. Et d’une certaine façon, à ce point du cheminement, la question de l’interdit moral est déjà dépassée. D’autres représentations sont alors mobilisées, dont la première préoccupation, liée au paradoxe de devoir représenter l’irreprésentable, est d’éviter l’abject. Le mal représenté, ce n’est pas directement le massacre, c’est la pulsion voyeuriste et macabre qui peut lui être afférente, pulsion qui nie de fait la dignité des personnes.
L’absence, le vide, le hors-champ fournissent des possibilités pour éviter l’abject tout en traitant du massacre. Le massacre des Innocents pouvait, dans le sujet, déjà être l’objet d’une mise à distance. Les génocides sont trop récents pour pouvoir être traités avec une distance naturelle. Le paradigme lanzmannien consiste à en appeler au témoignage, sur les lieux mêmes mais sans images (d’archive). La représentation, même dans Shoah, est pourtant persistante : la chambre à gaz est re-présentée par une maquette avec des figurines de personnages (je dis personnages puisque nous sommes déjà dans la fictionnalisation, nous ne pouvons parler de personnes), elle est filmée en travelling, reproduisant les différents moments de la dernière étape du massacre28. Elle vient en appui du témoignage de Filip Müller ; elle l’image. Pourquoi Lanzmann s’attarde-t-il sur cette maquette, dans une évidente volonté pédagogique (la caméra fait ensuite le même trajet en travelling sur les ruines réelles de la chambre à gaz), mais qui semble contredire le parti pris radical de filmer les lieux sans combler le vide ? En effet, Lanzmann montre les lieux de l’extermination, il montre donc des lieux où les personnes tuées ont totalement disparu, il montre la disparition29. La maquette repeuple momentanément, et de manière stylisée, l’endroit.
Cette pratique a ainsi une consubstantialité importante avec son sujet : elle matérialise la disparition, elle parvient à représenter tout en occultant. Non seulement la distance de la pudeur est respectée mais en outre la méthode est en adéquation avec le génocide représenté. Nouveau paradoxe résolu par l’art : la distance morale grâce à l’absence de médiation entre le sujet et son traitement. Rithy Panh l’a théorisé par sa pratique : l’image manquante est une absence d’image grâce à d’autres images. Est-ce un hasard si nous retrouvons dans ce film L’Image manquante30, des figurines comme trace fictionnée des personnages brisés par le génocide au Cambodge ? Les personnages de la maquette d’Auschwitz et les petits personnages en bois peint du Cambodge, effectuent le redressement des corps amoncelés. Depuis le film d’Alain Resnais Nuit et brouillard, et peut-être aussi depuis le film Les Camps de concentration nazis, qui servirent de témoignage au Tribunal militaire international de Nuremberg31, les corps amoncelés imagent pour nous le génocide, nous servent de représentation comme ils alimentent notre imagination. Les figurines – c’est Rithy Panh qui théorise véritablement ce qui n’était peut-être pas aussi conscient chez Lanzmann – redressent les morts, repeuplent l’espace d’où toute personne a disparu, fabriquant « l’image d’une quête de l’image »32.
Dès lors l’occultation comme principe, c’est délibérément montrer pour ne pas montrer, de même qu’un hors-champ (donc de l’invisible) suppose un champ (donc du visible). C’est dans ce sens que le massacre représenté – c’est-à-dire non-représenté mais ainsi représenté – est une version du mal que l’art se propose de traiter. L’activité fictionnante connaît donc ainsi plusieurs degrés, plusieurs incarnations pourrait-on presque écrire. Elle est présente dans un film dit documentaire, comme Shoah ou L’Image manquante, et dans les films dits de fiction : montrer ou occulter, le paradoxe est le même auquel l’auteur est confronté, qu’il doit traiter, à la racine même de l’art visuel concerné. L’occultation comme principe, c’est ne pas montrer pour montrer. La lisière du régime visuel est donc fine, qui correspond au paradoxe impliqué par le massacre représenté traité en représentation du massacre. Trois films récents évoluent sur cette crête très étroite de la représentation par l’occultation. Martin Scorsese, dans Shutter Island33, choisit de passer du fantasme (le déni et le refoulé, dans des images très transformées et dans une narration modifiée) à la réalité, dans des images qui rappellent celles de Ray Kellogg. László Nemes, dans Le Fils de Saül34, utilise le premier plan (nous suivons le personnage principal, un homme de Sonderkommando chargé de nettoyer la chambre à gaz) pour occulter ce qui se passe en fond. Le flou du fond créé par la grande focale reproduit littéralement la profondeur bouchée. L’amoncellement des corps est deviné, je devrais dire comblé par ce que nous avons déjà vu et que nous ne pouvons pas voir. Jonathan Glazer, dans La Zone d’intérêt35, fait le choix de ne montrer que l’extérieur du camp d’Auschwitz. L’amoncellement des corps ne peut pas figurer dans la narration. Mais Glazer reprend le procédé métonymique lors des scènes aussi froides que glaçantes où quelques vêtements sont distribués par la maîtresse de maison, où elle s’habille du manteau d’une autre, se maquille avec le rouge d’une autre. Les vêtements, qui ont enveloppé les corps vivants, sont bien à l’image, reliques fantomatiques vidées de la chair qu’ils ont abritée. En rappel, le court-circuit temporel de la fin du film, qui nous fait – enfin – traverser la frontière du mal par un œilleton, propulse le regard dans une sorte de tunnel qui ressemble à une étroite échappée perspective et nous amène dans le temps présent d’Auschwitz, dans le musée où se retrouvent les vêtements exposés.
Si le régime de visibilité des photographies et films présentés dans un procès est celui de la preuve, qui par conséquent veut montrer le plus possible, c’est-à-dire dans le détail et dans la globalité d’un processus, de sorte que les images y sont scrutées pour établir une vérité de fait, il n’en est pas de même des massacres représentés comme version du mal. Ces représentations doivent paradoxalement montrer l’amoncellement des corps comme métaphore, image et figure, de leur disparition violente. À l’infini représenté correspond le mouvement de la disparition dont me semble particulièrement représentatif un tableau de Rubens (Le Massacre des Innocents, 1611-161236) où une femme de dos se renverse vers le regardeur en prolongeant vers l’avant, c’est-à-dire vers le débord du tableau, l’échappée perspective du fond. Le renversement est littéralement à l’œuvre.