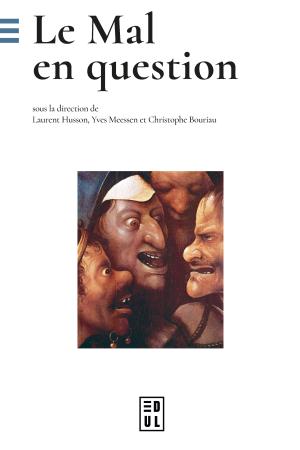
Nous comprenons le « problème du mal » comme la difficulté, voire l’impossibilité, de donner un sens ou une finalité au mal que l’être humain appréhende. Comme l’a écrit Simone Weil, c’est cette réponse qu’exige le « pourquoi ? » de celui ou celle qui souffre :
Il y a une question qui n’a absolument aucune signification, et bien entendu aucune réponse, que normalement nous ne posons jamais, mais que dans le malheur l’âme ne peut pas s’empêcher de crier sans cesse avec la monotone continuité d’un gémissement. Cette question c’est : pourquoi ? Pourquoi les choses sont-elles ainsi ? Le malheureux le demande naïvement aux hommes, aux choses, à Dieu, même s’il n’y croit pas, à n’importe quoi. […] Si on lui explique les causes de la situation où il se trouve […] ce ne sera pas pour lui une réponse. Car sa question, pourquoi, ne signifie pas : par quelle cause, mais : à quelle fin ? Et bien entendu on ne peut pas lui indiquer de fins. À moins d’en fabriquer de fictives, mais cette fabrication n’est pas une bonne chose1.
Cette compréhension large du problème du mal inclut son acceptation restrictive : la difficulté, voire l’impossibilité, de rendre compatible logiquement l’existence d’un Dieu bon, créateur et tout-puissant avec l’existence du mal2. Défendre, en effet, l’absence de contradiction entre les deux termes – Dieu et le mal – implique de montrer en quoi le mal, soit à titre de moyen soit à titre de condition sine qua non, comme le proposait Leibniz, peut avoir pour finalité l’advenue d’un bien plus grand3. Mais la réalité du problème du mal pour tout être humain confronté à la souffrance ou au crime ne dépend pas de l’inclusion de Dieu dans la réflexion comme on le prétend parfois4. Au contraire, il nous semble plus juste d’envisager avec Susan Neiman que « le problème du mal ne vient pas de la religion ; la religion est une tentative visant à résoudre le problème du mal » qui s’enracine, lui, dans la contradiction apportée à un besoin universel de l’être humain, qu’il soit athée, agnostique ou croyant : celui de trouver une raison ou un sens à tout ce que le monde offre5. En bref, douterait-on que Marx s’est confronté dans toute son œuvre au problème du sens et de la finalité du mal ? Et si l'on peut très certainement retracer l’origine religieuse du matérialisme historique pour la critiquer, comme Simone Weil le fait, on aurait tort de penser qu’il n’y a pas là une position assumée par Marx lui-même : plutôt que de défendre Dieu, comme les philosophes l’ont fait jusqu’ici, l’action humaine doit Le remplacer et mettre fin au mal de l’exploitation dans l’histoire en y lisant un moyen, au service du développement des forces productives, permettant de déclencher la crise révolutionnaire et de faire advenir la société communiste6.
Ce premier point n’est pas sans rapport avec notre étude sur le problème du mal dans la pensée de Simone Weil puisque dans l’itinéraire intellectuel si particulier de la philosophe, le passage de l’athéisme à la certitude de « la possibilité […] d’un contact réel, de personne à personne, ici-bas, entre un être humain et Dieu7 » ne signifie certainement pas que le mal ne devient un problème pour elle qu’à partir de 1938, année de sa première expérience mystique. Au contraire, une étude plus détaillée que celle-ci démontrerait que c’est l’analyse de la nécessité de l’oppression, et donc l’impossibilité de lui donner un sens, puis l’expérience de cette nécessité à la première personne en usine, en 1935, et la compassion déchirante qu’elle éprouve pour les ouvriers et les ouvrières qui la rapprochent du christianisme et la conduisent au mysticisme8. Autrement dit, c’est le problème théorique du mal et l’expérience de celui-ci qui mènent Simone Weil à Dieu et non l’inverse. Et Dieu, précisément parce que sa réalité est certaine pour la philosophe tout comme l’existence du mal l’est, vient aggraver le problème : si Dieu est, le mal doit avoir un sens, il n’est plus possible de simplement conclure à l’impossibilité de lui en donner un.
Dans cette perspective, si expérimenter le problème du mal veut dire faire l’épreuve à la première personne du mal en constatant la difficulté voire l’impossibilité de lui donner un sens, le franchissement d’un seuil mystique par la philosophe va l’amener à conceptualiser et à désirer pour elle-même une telle expérience poussée à son point de contradiction le plus extrême : faire l’épreuve à la première personne du mal ou de l’« anti-final » (zweckwidrig) dirait Kant qui rend vain toute tentative de théodicée9, tout en continuant à aimer Dieu, qui est le Bien, comme auteur de ce mal intolérable. Mais pourquoi vouloir faire l’épreuve concrète d’une telle contradiction ? Précisément pour tenter de la résoudre. C’est la compréhension d’une telle expérience, qui ne devait rien avoir d’une expérience de pensée pour Simone Weil, que nous visons ici, en remarquant qu’elle concilie à la fois le refus de concevoir une théodicée ou une réponse au problème du mal, et le désir in fine d’obtenir une réponse à celui-ci, sans qu’aucune de ces deux lignes de pensée ne l’emporte sur l’autre. Or, il nous semble que parmi les études consacrées au problème du mal chez Simone Weil, si certaines ont bien mis en avant ce paradoxe, elles finissent toutes par démontrer comment la philosophe répond au problème10. Notre question est, plutôt, en faisant un pas de plus : y répond-elle vraiment ? Ceci invite à s’interroger à la fois sur les limites des éléments constitutifs d’une potentielle réponse par Simone Weil, mais aussi sur le jugement de la philosophe sur sa propre pensée : pensait-elle pour sa part avoir répondu au problème ? Étudiée dans cette perspective, la pensée de Simone Weil peut contribuer au débat contemporain sur l’acceptabilité de toute théodicée justifiant l’existence du mal après que l’impossible fut devenu réalité à Auschwitz, selon le mot d’Hannah Arendt11.
Simone Weil propose d’abord, et jusque dans ses derniers écrits, une critique de l’idée de théodicée entendue soit comme la possibilité de concevoir une fin au mal, soit – ce qui est équivalent – comme la possibilité de résoudre la contradiction entre le mal et Dieu.
Cette critique se fonde sur l’affirmation d’une nécessité universelle, « l’enchaînement mathématique de causes et d’effets12 » dans la nature, auquel l’être humain est soumis, et qui est parfaitement indifférente aux valeurs morales. En 1934, les Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale aboutissaient au constat qu’une telle nécessité naturelle produit inévitablement une oppression sociale, dont le fondement est le jeu de la lutte pour la puissance ou de la force entre les êtres humains, et qui, si elle n’est jamais absolue, apparaît présentement indépassable13. Ainsi, en dépit de l’aspiration légitime de l’être humain de trouver dans la nature des moyens au service de son bien, les choses ont des causes, mais non des fins. Il y a là une contradiction indépassable :
La contradiction essentielle dans la vie humaine, c’est que l’homme ayant pour être même l’effort vers le bien est en même temps soumis dans son être tout entier, dans sa pensée comme dans sa chair, à une force aveugle, à une nécessité absolument indifférente au bien14.
Il existe alors deux manières illégitimes de résoudre cette contradiction qui effacent la réalité du second terme pour le rendre compatible avec le premier. La première manière, celle de Marx, consiste à vouloir démontrer « que le bien est un produit automatique de la nécessité »15 à l’œuvre dans la matière, et ceci en contradiction avec sa propre méthode matérialiste qui « consiste avant tout à examiner n’importe quel fait humain en tenant compte bien moins des fins poursuivies que des conséquences nécessairement impliquées par le jeu même des moyens mis en usage »16. La seconde, celle d’un christianisme qu’on pourrait dire leibnizien, pense exactement la même chose – le monde est régi par une « nécessité morale », c’est-à-dire « déterminé par la raison du meilleur » – mais considère que c’est là l’œuvre de Dieu et non de la matière17. Or là aussi, l’idée d’un plan divin, d’une instrumentalisation de toutes choses en vue du meilleur, est en contradiction flagrante avec ce que l’attention intellectuelle à la nécessité indique. S’il faut se représenter la puissance créatrice de Dieu à l’œuvre, on doit plutôt conclure que Dieu veut la nécessité en tant que telle18.
Simone Weil considère, plus loin, que ces deux voies qui visent à discerner une providence, l’une dans la nature, l’autre au-dessus, ne sont pas seulement illégitimes logiquement, mais immorales pratiquement. Non pas qu’elles n’incitent pas à agir, critique connue du Candide de Voltaire contre laquelle Leibniz avait déjà cherché par anticipation à se prémunir avec probablement trop de subtilité19. C’est plutôt que la conception de la providence interdit tout simplement d’agir moralement puisqu’attribuer une finalité à la souffrance, c’est nier son essence même qui est d’être sans signification20, ce qui empêche alors d’être attentif à celui ou celle qui est brisé par le malheur21. Ainsi, des « amis de Job » qui en laissant « fonctionner en eux l’imagination compensatrice » commettent un « crime » : ils détournent les yeux devant la souffrance d’autrui22. Et si Simone Weil ne doute pas de l’esprit de justice qui animait Marx, elle n’en constate pas moins que sa pensée entre les mains de nombreux révolutionnaires a conduit à considérer les prolétaires simplement comme des moyens, c’est-à-dire à les opprimer, en vue d’une fin meilleure qu’ils n’ont dès lors jamais été aussi loin d’atteindre23.
Ainsi, la philosophie doit, et c’est un impératif moral, exposer les contradictions auxquelles elle se confronte, et non chercher à les éliminer dans un système24. Dans le cas du mal, la pensée achoppe alors inévitablement sur les termes suivants : « Dieu est l’auteur de tout ; Dieu n’est l’auteur que du bien, on ne peut se tirer de là »25.
Mais là n’est pas le terme de la pensée de Simone Weil, qui la conduirait, si c’était le cas, certainement dans le camp de la révolte contre Dieu au côté d’Ivan Karamazov26. Ses cahiers révèlent plutôt qu’elle revient inlassablement à la contradiction entre Dieu et le mal, sans jamais rejeter un des deux termes, et en cherchant notamment à en formuler l’épreuve :
Accepter ce qui est amer ; il ne faut pas que l’acceptation rejaillisse sur l’amertume et la diminue ; sans quoi l’acceptation diminue proportionnellement en force et en pureté. Car l’objet de l’acceptation, c’est ce qui est amer, en tant qu’amer, et non pas autre chose. […] Dire comme Ivan Karamazov : rien ne peut compenser une seule larme d’un seul enfant. Et pourtant accepter toutes les larmes, et les innombrables horreurs qui sont au-delà des larmes. Accepter ces choses non pas en tant qu’elles comporteraient des compensations, mais en elles-mêmes. Accepter qu’elles soient, simplement parce qu’elles sont. […] Accepter tel évènement parce qu’il est, et par l’acceptation aimer Dieu à travers lui27.
Il faut remarquer la dimension éminemment pratique de ce passage. Il ne s’agit pas de penser classiquement la contradiction entre Dieu et le mal, à distance de notre perspective immédiate du réel qui nous tromperait sur ce problème. Il s’agit de vivre dans sa chair cette contradiction, soit dans l’épreuve du malheur, soit dans la compassion à l’égard d’autres touchés par le malheur, en acceptant l’horreur du mal sans cesser d’aimer Dieu. « Aimer Dieu à travers le mal comme tel. Aimer Dieu à travers le mal que l’on hait, en haïssant ce mal. Aimer Dieu comme auteur du mal qu’on est en train d’haïr », écrit encore la philosophe28.
Simone Weil formule de cette manière l’épreuve – au sens d’une expérience par laquelle on éprouve la qualité d’une chose – au cœur du problème du mal, parce qu’elle est elle-même convaincue que c’est en traversant un malheur sans compensation et en persévérant dans l’attention et l’amour implicite de Dieu qu’elle a senti soudainement en elle « à travers la souffrance, la présence d’un amour analogue à celui qu’on lit dans le sourire d’un visage aimé »29. Sans chercher ici à évaluer la valeur de cette expérience sui generis pour la philosophe, éclairons synthétiquement les conséquences métaphysiques qu’elle en tire à partir notamment, mais évidemment pas seulement, d’une relecture de Platon et du Nouveau Testament.
La création est ainsi conçue comme un acte de retrait par Dieu qui s’est vidé de sa divinité pour que les choses et les êtres puissent exister sans Lui30. Ce faisant, il renonce volontairement à sa puissance sur ces derniers, et abandonne sa création au mécanisme inflexible de la nécessité, signe manifeste de l’absence de Dieu ici-bas, qui engendre depuis notre perspective humaine l’intolérable du malheur et de l’oppression31. Mais cet ordre du monde vide de toute finalité est lui-même voulu par Dieu en vue d’une fin : l’amour32. Comme un enfant, un mendiant ou une amante importune33, Dieu quémande l’amour de l’être humain en se séparant de lui par l’écran de la nécessité afin qu’il puisse librement consentir ou non à L’aimer. Éloigné ainsi de Dieu par le fait même d’être créé34, l’être humain épuise sa volonté propre dans la recherche de son bien dans une nécessité qui invariablement le lui refuse jusqu’à la mort. Être doué de pensée, sa vocation à l’amour transparaît pourtant dans son attention à l’autre – l’ami, l’enfant ou l’inconnu –, son attention à la beauté du monde – ordre finalisé sans fin – à travers la création artistique, la recherche scientifique ou le travail manuel quand celui-ci n’est pas séparé de la pensée, ou encore son attention envers ce qui n’existe pas ici-bas – Dieu ou le Bien – par des pratiques religieuses qui en signifie la présence de façon conventionnelle. Mais cet amour, quel qu’il soit, ne sera jamais pur, c’est-à-dire parfaitement désintéressé ou inconditionné, tant que l’être humain n’aura pas renoncé à la perspective de la première personne, celle du « je », suivant laquelle les fins que pose sa volonté doivent être celles de l’univers.
L’extrême malheur, « à la fois douleur physique, détresse de l’âme et dégradation sociale35 », qui tombe brutalement sur un être humain, détruit d’un coup cette perspective et lui laisse l’âme en morceaux. Le plus souvent, l’être touché par le malheur cesse alors d’aimer toute chose, à commencer par lui-même, et tente désespérément de se débarrasser du mal qui l’écrase en faisant mal à autrui. Cependant, si la personne, avant d’être précipitée dans le malheur, a pu jouir de circonstances lui ayant permis de cultiver l’attention sous toutes ses formes, et si elle a déjà consenti et cherché à se défaire de l’ego, il est possible que le malheur, pour elle, ne soit pas seulement destructeur, mais aussi rédempteur. Car cette personne peut peut-être continuer à aimer – autrui, le monde, et implicitement Dieu – en dépit du malheur qu’elle traverse, et par-là atteindre le point extrême de la pureté de l’amour, celui d’aimer pour rien, sans y chercher une satisfaction pour soi, sans qu’il y soit répondu et sans savoir s’il y sera répondu36. Un tel amour serait alors « surnaturel » : ce serait Dieu qui aimerait à travers l’être humain qui a consenti à ce que la philosophe appelle la « dé-création », mais qui est, en un autre sens, l’achèvement de la création37. Ce serait la preuve expérimentale de l’amour ou de la bonté de Dieu.
Le mal – la souffrance ou la faute, qu’il soit subi ou commis, ou plus encore qu’il soit le mélange indistinct des deux à l’intérieur de chaque être humain, depuis sa perspective subjective – est ainsi pensé comme « une condition de la dé-création38 ». Sans lui, l’être humain ne se détacherait pas de l’illusion qu’il est le centre et la finalité de l’univers, il aimerait toute chose d’une façon intéressée, comme une nourriture en vue de sa satisfaction. Dès lors, il ne pourrait pas apprendre à aimer inconditionnellement ni, soudainement et bien malgré lui, ployer sous le malheur extrême lui donnant seul la possibilité d’aimer purement39.
Ainsi, nombre de passages des écrits de Marseille et de notes éparses des cahiers rédigés entre Marseille et New York composent, sans nul doute, les linéaments d’une réponse au problème du mal. Le mal pour nous n’est pas un moyen mais il a un sens, une finalité : il fait partie des conditions d’existence, régies par la nécessité, permettant la manifestation ici-bas de l’amour surnaturel40.
Soulignons désormais les difficultés dans lesquelles conduit cette réponse au problème du mal au point que, selon nous, en définitive, ce n’en est plus une au sens strict.
D’abord, notons une contradiction qui résulte du fait que poser la réponse modifie une des prémisses du raisonnement. Si Dieu, pour Simone Weil, aime les êtres humains de façon inconditionnelle jusqu’à se vider de sa divinité par amour comme la Création ou la Passion l’attestent, en attribuant une telle finalité au mal et à la nécessité, la pureté de l’amour du Dieu créateur n’est-elle pas cependant remise en question ? Que cet amour appelle secrètement, indéfiniment et silencieusement l’amour de ses créatures en retour, tout en les laissant libres de répondre ou non, et en ne sachant pas si elles répondront ou non, ne remet pas en cause sa pureté. Que l’amour attende l’amour, c’est une nécessité de l’amour, et l’être humain qui aime purement Dieu, s’il L’aime ainsi en dépit de son absence et même s’Il ne répond pas, ne cesse pas cependant d’attendre l’amour de Dieu. Mais si la création est un choix rationnel et volontaire constituant les conditions d’existence permettant à l’amour pur de s’y manifester, Dieu ne s’y est pas engagé sans savoir si, à son amour, les êtres humains répondront ou non. Il a créé le monde afin qu’ils y répondent. Et même s’ils sont sans doute très peu nombreux à le faire pour Simone Weil, il n’en reste pas moins que si la création est le résultat d’un calcul de conditions et de conséquences, Dieu ne nous a pas aimés pour rien, inconditionnellement. C’est pour cela qu’on trouve bien des images du Dieu créateur dans les cahiers de Simone Weil et que certaines d’entre elles mettent l’accent, non plus sur le caractère volontaire et rationnel de son œuvre, mais plutôt sur l’inconscience et la faiblesse d’amour avec laquelle Il crée. C’est également pour cela que cette réponse est aussi profondément christologique : dans la Passion, le Christ aime son Père en se sachant abandonné de lui. Son amour est pur, et son malheur son châtiment pour avoir créé41.
Plus loin, le caractère expérimental d’une telle réponse au problème du mal la rend incommunicable. Au-delà même de la question philosophique essentielle de savoir si une telle expérience d’amour pur coïncidant avec une expérience mystique est possible, remarquons que la réponse n’existe que dans cette expérience. Hors d’elle et après elle, le mal demeure incompréhensible et injustifiable, et cela même est la condition de l’expérience. Aussi, si Simone Weil ne cesse pas de retravailler inlassablement le problème du mal dans ses cahiers, c’est que la réponse une fois dite ou écrite a posteriori n’en est plus une, et qu’il faut revenir à l’épreuve à la première personne de la contradiction pour trouver la réponse42. Ainsi, en reprenant les mots de Paul Ricœur, « il faut dire sans délai que ce sens [donné au mal] ne peut-être enseigné : il ne peut être que trouvé ou retrouvé »43. Les cahiers portent la trace du désir de Simone Weil de parvenir à une conception de la miséricorde divine « qui puisse être communiquée à n’importe quel être humain […] sans être pour lui un outrage »44. L’amour de Dieu et le malheur est peut-être la tentative la plus nette et la plus paradoxale en ce sens. Et ce n’est pas un hasard si l’essai s’achève sur l’évocation du silencede Dieu comme réponse au pourquoi inlassable du malheureux qui persiste à aimer. Ce silence essentiel, c’est la « non-réponse45 » écrit-elle au même moment dans ses cahiers, la non-réponse au problème du mal pourrait-on ajouter : le silence, signe de l’expérience de l’ineffable qui comble l’être touché par le malheur, mais qui précisément ne peut être communiquée, seulement éprouvée.
Dans cette perspective, dans le débat contemporain sur le problème du mal, la pensée de Simone Weil rejoint le critère exposé par Marilyn McCord Adams selon lequel la bonté de Dieu n’est défendable que si le sens donné au mal, et particulièrement aux maux les plus extrêmes, est admis par la personne même qui a traversé ce mal et est parvenu à l’intégrer dans un bien plus grand au sein de sa vie46. Mais la philosophe n’aurait pas admis, ainsi que le proposent McCord Adams ou Paul Clavier47, qu’on puisse utiliser le témoignage de personnes ayant trouvé un sens au mal y compris dans les conditions les plus extrêmes, pour défendre la compatibilité logique entre le mal et Dieu. Tout simplement parce que la philosophie pour Simone Weil était indissociable de l’épreuve du réel dans sa vie propre, comme l’ont bien souligné Robert Chenavier ou Pascal David48. Si la vérité ne peut être atteinte qu’« au contact de l’objet49 », ce ne peut être en utilisant les témoignages d’autrui sur le malheur et Dieu qu’on y parvient, mais seulement en étant soi-même exposé.
Enfin, il faut mettre en évidence une insuffisance radicale de cette réponse dont Simone Weil a une conscience aiguë. La souffrance ne peut avoir un sens pour l’être humain que dans la mesure où il peut être attentif intellectuellement à la nécessité comme telle, capable alors de l’accepter par amour quoiqu’il arrive, joie ou peine, y compris si un jour il se trouve précipité dans le malheur. C’est l’expérience que pensait avoir faite Simone Weil entre 1935 et 1938, de l’usine à la certitude d’un contact direct avec Dieu. Mais si cette faculté d’attention qui porte en germe le libre consentement à la nécessité est absente, insuffisamment développée, ou abîmée, il est impossible de faire usage de la souffrance qui devient un « mal pur ». La souffrance animale est ainsi exclue de cette réponse50. De même, la souffrance de l’enfant bien incapable d’être attentif à la nécessité qu’il subit autrement que comme à un mal intolérable ne peut avoir pour lui de sens51. Enfin, pour toutes celles et ceux qui ploient sous l’oppression, trop longtemps ou depuis toujours, qu’ils soient parties prenantes d’une guerre ou condamnés à un travail d’exécution dans l’obsession de la vitesse, l’attention est la plupart du temps recroquevillée sur l’instant présent, celui de la survie ou de la répétition automatique des gestes dans un rythme ininterrompu. À moins de transformer radicalement leurs circonstances de vie, il ne peut être question pour eux d’exercer librement leur faculté d’attention et d’amour. Ainsi, Simone Weil concluait L’Amour de Dieu et le malheur où elle cherchait à communiquer la possibilité d’un usage surnaturel du malheur par l’aveu de l’impossibilité de cet usage pour le plus grand nombre : « on serait souvent tenté de pleurer des larmes de sang en pensant combien le malheur écrase de malheureux incapables d’en faire usage »52.
Il nous semble donc que si Simone Weil pensait avoir reçu et pensé un sens au mal, elle était bien consciente que cette « réponse » ne répondait pas en définitive au problème, et qu’elle était toujours à repenser et ré-éprouver. Elle tiendra ainsi, jusqu’à la fin de sa vie, le refus et le désir de parvenir à une théodicée53. Mais c’est pourquoi aussi selon nous, le problème théorique du mal – celui du sens et de la finalité – et son épreuve à la première personne, ne sont jamais qu’une part de sa philosophie qui s’achève, avec L’Enracinement, comme elle a commencé : par une réflexion sur les conditions éthiques et politiques permettant de surmonter le mal pratiquement.