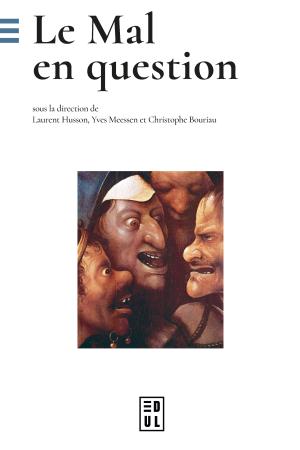
Cette étude souhaite aborder la question du mal sous sa figure la plus anodine, celle d’un lapsus involontaire dont on ne peut imputer à son auteur la moindre responsabilité. Un mot pris pour un autre, cela nous arrive quotidiennement, le plus souvent sans grand dommage. Le lapsus qui m’intéresse s’est produit lors du fameux débat sur le kantisme qui a opposé Ernst Cassirer à Martin Heidegger le 15 avril 1929 à Davos. Commençons par rappeler les termes de ce débat.
Cassirer veut montrer que chez Kant la « finitude », c’est-à-dire la condition de l’être humain réduit à une connaissance relative, dépendante de sa sensibilité, n’est qu’un point de départ, un terminus a quo. Ce relativisme, selon lui, est surmonté dans la sphère éthique où l’homme accède à un contenu, la loi morale, qui n’a pas de sens pour l’homme seulement, mais pour tous les êtres raisonnables, y compris les purs esprits et Dieu lui-même (à supposer qu’ils existent). A contrario, Heidegger veut montrer que chez Kant la finitude est un terminus ad quem, un point d’arrivée indépassable, et que même dans la sphère éthique les énoncés auxquels nous accédons n’ont de sens que pour des êtres rationnels finis, dotés de sensibilité.
Au cours de son argumentation, voulant établir la « percée » du sujet éthique kantien hors de la sphère de la finitude, Cassirer a le malheur d’utiliser le terme « impératif catégorique » (qui concerne les seuls êtres rationnels finis) en lieu et place de celui de « loi morale » (qui concerne l’ensemble des êtres rationnels, Dieu y compris). La thèse que je souhaite défendre dans les limites de cet article est que l’exploitation de ce lapsus par Heidegger va court-circuiter le débat et l’empêcher de progresser. S’agit-il là d’une faute philosophique ?
Je commencerai par rappeler les principaux textes de Kant consacrés au statut de la loi morale. En accédant à cette loi morale, sommes-nous selon Kant encore rivés à un monde humain, strictement humain ? Cette loi morale nous maintient-elle dans la sphère de la finitude ?
Je présenterai ensuite le lapsus de Cassirer en posant la question suivante : si Cassirer avait évité ce lapsus, s’il avait dit « loi morale » au lieu d’« impératif catégorique », Heidegger aurait-il pu réfuter son argumentation ? S’est-il donné la part belle en prenant Cassirer au mot ?
Je reviendrai ensuite sur l’emploi par Cassirer de l’expression « vérités éternelles », qui alimente le débat par un autre biais, et permet de renforcer son interprétation en faveur d’un dépassement de la finitude.
Enfin, j’examinerai dans quelle mesure, et dans quelles limites, l’interprétation de Heidegger peut néanmoins recevoir une part de légitimité.
Avec la loi morale, avance Cassirer, nous assistons à une « percée hors de la finitude ». Dans la loi morale, « est atteint un point qui n’est plus relatif à la finitude de l’être connaissant, mais où un absolu est posé1 ». Par le terme d’« absolu », Cassirer qualifie un contenu propositionnel qui n’est pas relatif à l’homme seulement, mais qui vaut sous tout rapport, qui s’impose à la raison de tous les êtres rationnels, humains ou non.
Cette interprétation trouve-t-elle dans les textes de Kant une justification ? Au sujet du « principe moral », c’est-à-dire de la loi morale, Kant écrit qu’elle s’impose non seulement aux hommes, mais encore « à la volonté divine relativement aux êtres raisonnables dans le monde, comme étant ses créatures2 ». La percée hors de la finitude évoquée par Cassirer semble confirmée par l’idée que la loi morale s’impose non seulement aux hommes, mais encore à la volonté divine. Elle ne vaut pas seulement pour les êtres finis que nous sommes, mais également pour l’être infini lui-même. En consultant la loi morale, précise, Kant, « chacun peut reconnaître par sa propre raison ce que Dieu veut »3. On peut parler ici d’une univocité de la loi morale : son contenu est le même pour l’homme, pour les êtres rationnels non humains, et pour Dieu, comme l’affirme Kant au § 7 de la seconde Critique :
Il [le principe de la moralité] n’est pas restreint aux hommes seuls, mais s’étend à tous les êtres finis qui disposent de raison et de volonté ; il s’étend même à l’Être infini en tant qu’intelligence suprême4.
Kant souligne que la loi morale n’est pas un décret arbitraire de dieu, mais qu’elle constitue sa volonté qui, comme volonté sainte, veut spontanément l’accomplissement de cette loi. L’expression volonté sainte s’applique chez Kant aux dieux et aux anges, qui veulent spontanément le bien et qui, contrairement à nous autres les hommes, ne sont pas tiraillés entre le devoir moral et les inclinations. Loin de créer la norme du bien, la volonté divine est déterminée par elle : « Une volonté parfaitement bonne [ou volonté sainte], selon sa constitution subjective, […] ne peut être déterminée que par la représentation du bien »5. Seules les lois conformes à la moralité déterminent sa volonté, sans qu’aucun motif autre n’intervienne. Dans son livre sur la religion, Kant invoque ainsi « une volonté divine déterminée à partir de simples lois morales »6.
De là, une distinction importante qui va être au centre de la discussion entre Cassirer et Heidegger. Lorsqu’il parle des volontés saintes, Kant emploie toujours l’expression loi morale, et non pas celle d’impératif catégorique. Pourquoi ? Parce que les volontés saintes, qui veulent spontanément le bien, ne reçoivent pas la loi morale comme un impératif, comme un devoir contraignant. Dépourvus d’inclinations sensibles, Dieu et les anges ne connaissent pas la situation des êtres humains qui, eux, reçoivent la loi morale comme un impératif absolu, c’est-à-dire comme un devoir sans condition qui peut contrarier leurs aspirations sensibles.
L’impératifcatégorique commande sans condition, que cela nous plaise ou non, et réclame de notre part un effort pour surmonter la tentation de préférer nos inclinations au devoir. Par exemple, nous pouvons être tentés de mentir quand cela sert nos intérêts, et il faut véritablement faire acte de vertu, presque au sens antique de virtu, de « force » ou de « bravoure », pour combattre cette tentation et dire la vérité. Dieu et les anges, en revanche, ne reçoivent pas loi comme un « tu dois » impératif, puisqu’ils ne veulent rien d’autre que son accomplissement.
Cassirer, éditeur des œuvres complètes de Kant, connaît bien les passages de Kant précités ainsi que la distinction entre loi morale et impératif catégorique. Cependant, dans le feu de son argumentation, il va commettre un lapsus malheureux, qui va déporter le centre de la discussion et permettre à Heidegger de reprendre la main.
Ce lapsus se trouve dans la phrase suivante :
L’impératif catégorique doit être tel que la loi qui est posée ne vaille pas seulement pour les hommes, mais pour tous les êtres raisonnables en général. C’est ici qu’apparaît brusquement ce passage si remarquable à un autre ordre7.
Le lapsus consiste ici à utiliser « impératif catégorique » pour « loi morale ». Dans d’autres passages de son œuvre, Cassirer se garde bien de commettre ce lapsus. Par exemple, dans sa recension de l’ouvrage de Heidegger, Kant et le problème de la métaphysique, il écrit :
La « loi morale », contrairement à la loi physique, « situe l’homme dans un monde qui possède la vraie infinité »8.
En lisant cette recension, Heidegger a pu voir qu’avec la loi morale l’homme, selon Cassirer, accède à un dépassement de sa finitude, en un double sens : 1. d’une part en agissant par respect pour la loi morale il n’est plus passif, réceptif, mais produit spontanément par son action des fins bonnes ; 2. en accédant à la loi morale, quand bien même il la reçoit comme un impératif, l’homme accède à un contenu – l’exigence d’universalité – qu’il partage avec Dieu lui-même (s’il existe).
Tel est précisément l’argument que Cassirer oppose à Heidegger pour justifier l’idée d’une percée hors de la finitude : la loi morale ne concerne pas les hommes seulement, mais aussi Dieu lui-même, de sorte qu’avec elle l’homme, pour reprendre une expression de Leibniz, « entre en société avec Dieu lui-même », atteint un contenu univoque à l’homme et à Dieu, et dépasse en ce sens la seule sphère de la finitude (celle des êtres rationnels finis). Malheureusement, en utilisant dans la phrase précitée « impératif catégorique » au lieu de « loi morale », Cassirer met en avant la forme humaine que prend la loi morale en tant qu’elle est reçue par l’être humain. L’impératif catégorique en effet concerne uniquement les êtres finis, pathologiquement conditionnés, qui reçoivent la loi morale comme un « devoir être » faisant parfois violence à leurs inclinations, au point que Nietzsche a pu voir dans cet impératif un relent de « cruauté »9. Or ce que Cassirer cherche à montrer, c’est précisément qu’indépendamment de ce mode de réception fini, l’homme accède à travers la loi morale ou les lois qui en découlent à un contenu univoque à la raison humaine et à la raison divine : assurément, comme le souligne Kant lui-même, Dieu ne reçoit pas cette loi comme un devoir, car c’est là la marque de notre finitude, mais il n’en demeure pas moins soumis comme nous à cette loi : « L’intelligence toute suffisante n’est pas au-dessus des lois, mais seulement au-dessus de l’obligation et du devoir10 ».
Mais Heidegger se jette sur le lapsus de Cassirer pour éluder cette objection très forte contre sa propre interprétation, selon laquelle le « sujet » kantien reste confiné dans la sphère de la finitude. Il souligne, en enfonçant une porte ouverte, que l’impératif catégorique n’a précisément de sens que dans la sphère de la finitude :
Dans l’impératif catégorique, il y aurait [selon Cassirer] quelque chose qui dépasse l’être fini. Mais justement le concept d’impératif comme tel manifeste la relation intrinsèque à un être fini11.
Si Cassirer avait été moins courtois, il aurait pu à cet instant couper la parole de son interlocuteur en s’écriant : j’ai voulu dire « loi morale », et non pas « impératif catégorique » ! Mais Cassirer, en bon gentleman, laisse son interlocuteur poursuivre son analyse de la finitude, bien qu’elle nous éloigne du cœur de l’objection. Heidegger obtient ici, momentanément, une victoire à peu de frais : évidemment l’impératif catégorique vaut pour les hommes, pas pour Dieu, puisque l’impératif est la forme que prend la loi morale appliquée aux hommes qui sont pathologiquement conditionnés ! Il est facile, à ce compte-là, de réaffirmer que l’homme, même dans le domaine éthique, est rivé à sa finitude, c’est-à-dire à sa nature à la fois rationnelle et sensible, affective. C’est que Heidegger n’envisage que la manière dont l’homme reçoit, se rapporte à la loi morale, en insistant sur la dimension sensible de cette réceptivité : de fait, comme le dit Kant, l’homme se représente cette loi in concreto par analogie avec une loi de la nature universellement valable (la loi de la nature étant le « type », c’est-à-dire le représentant sensible de la loi morale12), et il se rapporte à elle à travers le sentiment du « respect ».
Cependant, en poursuivant sur cette ligne sa prétendue réfutation de Cassirer, Heidegger commet une erreur d’interprétation concernant la position même de Kant. Cette erreur consiste à réduire le domaine d’application de la loi morale chez Kant aux seuls êtres rationnels finis, à l’encontre même des textes de Kant que nous avons cités précédemment. Heidegger écrit ainsi :
Même le passage à un niveau plus haut [c’est-à-dire au-dessus de l’espèce humaine] demeure à l’intérieur de la finitude, puisqu’il nous conduit à des êtres finis, à quelque chose de créé (les anges)13.
Heidegger veut dire ici que la loi morale concerne uniquement des êtres finis, créés. À un niveau supérieur à l’espèce humaine, elles concerneraient les seuls anges. Or ce n’est pas ce que dit Kant, qui déclare dans de nombreux passages que la loi morale concerne Dieu lui-même – à supposer qu’il existe –, et qu’elle commande univoquement les volontés humaines, celles d’éventuels êtres rationnels finis non humains, enfin les volontés saintes, c’est-à-dire les anges et Dieu.
On peut regretter que la restitution du débat par les étudiants présents se termine après la réponse de Heidegger, qui prend ainsi une tournure définitive alors qu’elle pourrait être réfutée point par point. Pierre Aubenque nous apprend dans sa préface que ce qu’on nomme le débat de Davos n’est en fait qu’un abrégé de la discussion, établie à partir des comptes-rendus donnés par les étudiants Otto Friedrich Bollnow et Joachim Ritter14. Cet abrégé, précise P. Aubenque, ne représente qu’un tiers du débat complet. On peut donc imaginer que Cassirer, dans la partie du débat qui nous manque, est revenu sur son lapsus et qu’il a remis l’église au milieu du village. De fait, Cassirer pouvait facilement corriger son propos en disant par exemple : certes, l’impératif catégorique, entendu comme la manière dont la loi morale est reçue par les êtres finis, vaut uniquement dans le champ de la finitude, mais la loi morale elle-même, comme le souligne Kant à maintes reprises, est univoque à l’intelligence humaine et à l’intelligence divine. Elle régit aussi bien la volonté humaine que la volonté divine. Et il aurait pu invoquer à l’appui le passage précité :
Il [le principe de la moralité] n’est pas restreint aux hommes seuls, mais s’étend à tous les êtres finis qui disposent de raison et de volonté ; il s’étend même à l’Être infini en tant qu’intelligence suprême15.
J’ignore si, dans la partie du débat qui nous manque, Cassirer a pu corriger son lapsus et rétablir son argument en bonne et due forme. Quoi qu’il en soit, dans la discussion avec les étudiants qui avait lieu l’après-midi de ce 15 avril 1929, on trouve à nouveau un argument en faveur d’un dépassement de la finitude, mais avancé d’une manière très indirecte et implicite, que je me propose ici de reconstruire.
La première question de « l’étudiant en philosophie » désigné par la lettre S, adressée à Cassirer, est la suivante :
De quelle voie vers l’infinité l’homme dispose-t-il ? Et quelle est la façon dont l’homme peut participer à l’infinité ?16
À l’occasion de cette question, Cassirer avait tout loisir de revenir sur la distinction entre impératif catégorique et loi morale, et de réfuter l’interprétation de Heidegger. Mais prenant du recul par rapport à Kant, il développe sa propre conception de l’infinité. Il parle alors d’« infinité immanente », au sens d’une tâche infinie qui nous incombe : l’effort de l’homme pour mettre en forme le divers matériel, pour l’ordonner rationnellement, est un processus infini. L’inépuisable richesse du réel ne cesse de nous défier, de nous présenter des phénomènes inédits qu’il nous revient d’interpréter et d’intégrer dans de nouvelles formes. L’infini immanent en question n’a plus rien à avoir avec Dieu, conçu comme un être infini transcendant.
Pourquoi Cassirer n’est-il pas soucieux de corriger son lapsus du matin ? Soit il l’a déjà fait dans la partie du débat qui nous manque, soit il se désintéresse à présent de la question purement historique ou exégétique concernant la philosophie de Kant. Mais c’est surtout un autre motif qui ressort : à présent, Cassirer entend exposer sa propre conception de la finitude tout en cherchant à identifier d’éventuels points de convergence avec Heidegger, dans un esprit de conciliation. En invoquant une « infinité immanente », entendue comme création incessante de nouvelles formes d’organisation, Cassirer pense rejoindre la conception heideggerienne de la finitude qui consiste à intégrer l’infini au sein même du fini en concevant l’infini comme un « procès infini », et non comme un au-delà transcendant :
Je crois que pour Heidegger aussi, si j’ai bien compris ses développements de ce matin, la liberté ne peut être proprement atteinte que sur la voie d’une libération progressive, qui est certainement pour lui aussi un procès infini17.
Le cœur du propos n’est donc plus de discuter au sujet de Kant. Cependant, lorsqu’il emploie dans la suite l’expression « vérité éternelle » à propos de Kant, Cassirer retrouve indirectement la thèse qu’il avait défendue le matin même. En effet, il entend cette expression dans le même sens que des auteurs tels que Malebranche et Leibniz, c’est-à-dire comme des vérités incréées univoques à l’entendement humain et à l’entendement divin. Par cette idée qu’il existe des contenus théoriques univoques à Dieu et aux hommes, il me semble que l’on retrouve précisément la thèse d’une « percée » de l’homme hors de la « sphère originelle » de sa finitude.
Rappelons que Malebranche et Leibniz n’étaient pas d’accord avec Descartes qui écrivait : « La nécessité de ces vérités n’excède point notre connaissance »18. Malebranche, Leibniz, mais également Kant, soutiennent au contraire qu’il existe des vérités ou encore des contenus normatifs qui sont les mêmes pour les hommes et pour Dieu, qui leur sont communs. Pour Leibniz, par exemple, dès que l’homme accède par son entendement aux vérités nécessaires, dites éternelles, il adopte le point de vue de Dieu lui-même sur ces vérités et il entre ainsi en société avec Lui et avec l’ensemble des êtres rationnels :
Les esprits, soit des hommes, soit des génies, entrant en vertu de la Raison et des vérités éternelles dans une espèce de Société avec Dieu, sont des membres de la Cité de Dieu19.
Malebranche adopte une position similaire. Il soutient que les rapports de perfection (qu’il nomme l’Ordre), tout comme les rapports de grandeur en mathématiques, sont des vérités que nous contemplons au même titre que Dieu lui-même. « Ces rapports », accessibles à notre propre entendement, « sont les mêmes vérités éternelles que Dieu voit »20. Pour Leibniz et Malebranche, l’homme dépasse sa finitude lorsqu’il accède aux vérités éternelles, et il est assuré de bien agir lorsqu’il règle sa pensée et sa volonté sur ces vérités.
Or, pour Cassirer, on retrouve exactement la même position chez Kant : en accédant aux vérités ou aux normes éternelles, constitutives de la raison divine, nous nous élevons au-dessus de notre finitude pour entrer en société avec Dieu. Dans La Religion dans les limites de la simple raison, Kant parle ainsi à plusieurs reprises d’un « corps éthique universel » ou encore d’« un peuple de Dieu soumis à des lois morales21. La loi morale unit Dieu et les hommes dans une même société, dont Dieu est le chef. De la même manière, dans la seconde Critique, Kant avance que la loi morale, qui prescrit de traiter la personne toujours en même temps comme une fin, s’impose non seulement aux hommes, mais encore « à la volonté divine relativement aux êtres raisonnables dans le monde »22. Autrement dit, les devoirs moraux que nous assumons envers autrui sont assumés par Dieu lui-même. Certes Kant utilise rarement l’expression « vérité éternelle ». Lorsqu’il le fait, il met clairement en lumière l’équivalence entre vérité « éternelle » et vérité « nécessaire » :
Toutes les vérités nécessaires sont des vérités éternelles23.
Pour Kant une vérité que nous percevons comme nécessaire est une vérité vraie de tout temps. C’est une vérité qui n’est pas instaurée par Dieu, comme le pensait Descartes, mais une vérité éternelle qui, comme telle, s’impose à tout entendement, humain ou divin. Ce que Kant précise en amont du passage cité en écrivant : « tout ce qui est nécessaire est éternel ». Cassirer a donc tout à fait raison d’avancer que les vérités éternelles sont chez Kant des vérités « universellement nécessaires, dont le contenu n’est pas uniquement fini »24. En d’autres termes, ce sont des vérités dont le contenu ne vaut pas uniquement pour les êtres finis. Cassirer emploie le terme d’« absoluité » à propos de ces vérités. Dire que les vérités éternelles sont « absolues », cela signifie qu’elles sont vraies sous tout rapport, pour toute forme d’intelligence. Comme exemple de vérités éternelles, Cassirer cite d’abord les vérités mathématiques. Et comme le commente justement P. Aubenque :
Cassirer veut dire que la mathématique, comme d’une autre façon l’éthique, échappe aux limites de la finitude25.
C’est donc bien Cassirer qui a raison contre Heidegger. En accédant aux vérités éternelles, nous faisons une percée au-delà de la sphère de la finitude. Certes, nous les hommes, avons besoin de recourir à l’imagination et à une procédure de construction pour accéder aux vérités mathématiques. Comme le dit Kant, les mathématiques procèdent par « construction de concepts ». Reste que les vérités ainsi conquises sont « nécessaires », c’est-à-dire, selon Kant, univoques aussi bien à l’esprit divin qu’aux esprits finis.
Certes, la loi morale n’est pas une vérité au même sens que les vérités mathématiques. C’est une norme, un devoir être, plutôt qu’une vérité statuant sur un état de choses. Cependant cette norme peut être dite vraie ou « objective » selon Kant au sens où elle est universelle, valable pour tout être rationnel. Et c’est précisément cette objectivité ou universalité de la loi morale que Cassirer invoque à nouveau, en reprochant à Heidegger de refuser de la voir pour se retirer dans la « clôture » de la finitude :
Heidegger veut-il renoncer à toute cette objectivité, à cette forme d’absoluité, que Kant a affirmées dans le domaine éthique, dans le domaine théorique et dans la Critique du jugement ? Veut-il se retirer entièrement sur la clôture de l’être fini ?26
À nouveau, Heidegger ne répond pas à cette objection de fond. Il l’esquive en deux temps. Tout d’abord en se focalisant sur le terme de vérité : « Il ne peut y avoir de vérité en tant que telle et la vérité n’a de sens que s’il y a Dasein »27 (p. 36). Heidegger s’attache à monter que la notion de vérité n’a de sens qu’à partir du moment où il y a un Dasein pour l’énoncer. C’est donc l’homme qui constitue la vérité en « donnant sa forme à l’étant », et la vérité consiste à énoncer correctement « quelque chose sur l’étant ». En se focalisant sur la vérité ainsi définie, Heidegger restreint son sens au seul domaine humain et il élude ainsi la question posée par Cassirer : la loi morale, qu’on la nomme « vérité éternelle » ou « norme », vaut-elle uniquement dans l’horizon de l’être fini ? N’est-elle pas absolument valide au sens où elle s’impose aussi bien au fini qu’à l’être infini ?
Ensuite, Heidegger se focalise sur l’adjectif « éternel » : que veut dire « éternel » quand on parle de vérités éternelles ? La réponse de Heidegger est que c’est le temps comme forme de notre sensibilité qui nous permet de nous faire une idée de ce qu’est l’éternité. En effet tout passe dans le temps, sauf le temps lui-même :
Que signifie donc ici éternel ? D’où vient notre savoir de cette éternité ? Cette éternité n’est-elle pas tout simplement la permanence de l’aei (le toujours) du temps ?28
Heidegger a beau jeu de rappeler que le temps est pour Kant la forme de notre sensibilité, et qu’il permet de concevoir « la permanence de la substance », qui est la seule manière dont nous parvenons à nous représenter l’éternité comme ce qui permane ou demeure sous le changement. À nouveau, Heidegger se focalise sur la manière dont l’homme se représente l’idée d’éternité, comme précédemment il se focalisait sur la manière dont il se représentait la loi morale29. De cette manière, il esquive l’objection de Cassirer qui conserve cependant toute sa force. Que nous ayons besoin de l’intuition pure du temps pour concevoir l’éternité ne remet pas du tout en cause le fait qu’il existe pour Kant des vérités nécessaires et universelles, des « vérités éternelles » qui sont valables aussi bien pour l’homme que pour Dieu lui-même (à supposer qu’il existe).
En se concentrant sur la manière dont le sujet fini se représente la loi morale, la vérité, l’éternité, Heidegger psychologise en quelque sorte la question et élude le propos de Cassirer en faveur d’un passage du fini à l’infini, d’une percée au-delà de la finitude le faisant entrer, par le biais de certains énoncés nécessaires et universels, en société avec des esprits rationnels non humains et avec Dieu lui-même.
Dans sa recension de l’ouvrage de Heidegger Kant et le problème de la métaphysique, antérieure au débat de Davos, Cassirer apporte des éléments qui répondent précisément à cette question. Cette recension est reproduite aux pages 53-83 du Débat sur le kantisme et la philosophie.
Cassirer reconstruit la thèse centrale de Heidegger selon laquelle le sujet kantien reste enfermé dans la sphère de la finitude. Un des arguments majeurs de Heidegger consiste à souligner que ce que Kant avance 1. au sujet de Dieu, présenté comme un intuitus originarius ou créateur30, 2. au sujet des « noumènes » (la liberté et l’immortalité de l’âme, l’existence d’un Dieu bon et tout puissant), enfin 3.au sujet des êtres raisonnables non humains (anges ou « volontés saintes » ; « habitants de la lune » ou extra-terrestres), n’a pas d’autre statut que celui de simples « Idées » formées par l’homme. Pareilles « Idées », faute de pouvoir être remplies intuitivement, ne peuvent prétendre à l’objectivité théorique. Elles sont mobilisées par Kant pour servir son argumentation philosophique. Par exemple, lorsque Kant envisage un intuititus originarius dans l’esthétique transcendantale, c’est dans un but précis : en imaginant une intuition de type divin, créatrice des objets, il entend mettre en lumière, par contraste, la nature de l’intuition humaine : nous, les hommes, ne disposons pas d’une intuition créatrice des objets ; nous ne pouvons accéder aux objets que sur le mode de la réceptivité, grâce une intuition de type sensible. Cassirer résume ainsi le point de vue de Heidegger :
L’ intuitus originarius est […] un concept limite que la raison finie pose d’elle-même, qu’elle s’impose à elle-même pour limiter les prétentions de la sensibilité31.
En d’autres termes, Kant conçoit une intuition créatrice uniquement pour montrer nos limites : nous autres les hommes, nous ne pouvons prétendre connaître un objet qu’au gré de notre intuition sensible qui n’est pas créatrice, mais réceptive.
De la même manière, lorsque Kant parle de la loi morale comme valable pour tous les êtres raisonnables, même non humains, il ne conçoit pas ces êtres raisonnables non humains comme des êtres effectifs avec lesquels nous entrerions en communauté par le biais de la loi morale32. C’est là la grande différence avec Leibniz et Malebranche qui concevaient ces êtres non humains comme réellement existants. Selon Heidegger, ces êtres rationnels non humains ne sont pour Kant que des Idées ou encore des conjectures utiles pour faire comprendre que la loi morale découle de la structure même de la « raison pure », et qu’elle pourrait très bien s’étendre à des êtres non humains si et seulement si pareils êtres existaient. Mais encore une fois, rien ne permet d’avancer que ces êtres raisonnables non humains existent, puisque nulle intuition ne nous y autorise. Pour Kant, tel que l’interprète Heidegger, le sujet fini forme les Idées métaphysiques précitées, mais sans jamais leur accorder l’existence, pour la simple et bonne raison que leur concept ne peut être rempli par aucune intuition de type sensible. Ainsi, selon Heidegger, lorsque Kant invoque Dieu, ce n’est jamais pour se ménager une sortie hors de la finitude en prétendant qu’on partage une vérité ou un contenu normatif avec Lui. C’est seulement pour donner sens à l’idée d’un « souverain bien » après la mort : dans la seconde Critique l’idée d’un Dieu infiniment juste et puissant est un simple « postulat de la raison pratique » qui sert à penser un lien synthétique entre vertu et bonheur : l’homme peut concevoir qu’il existe un Dieu récompensant le vertueux après sa mort, mais c’est là un simple objet d’espérance sans prétention à la vérité.
Pourquoi Cassirer, tout en restituant correctement la position de Heidegger, n’est-il cependant pas convaincu par elle ? Pourquoi maintient-il qu’il existe chez Kant une percée hors de la finitude ?
C’est parce que, selon Cassirer, contrairement à ce qu’affirme Heidegger, Dieu n’est pas pour Kant une simple Idée formée par nous : nous avons de solides raisons pratiques de croire qu’Il existe effectivement : « Kant laisse place à une existence d’une autre importance (que l’existence phénoménale), il laisse place à l’existence nouménale non de choses, mais d’intelligences, à l’existence d’un règne de personnalités librement agissantes et absolument autonomes33 ». Certes nous n’avons aucune raison d’ordre théorique de croire en leur existence, car ces « personnalités » échappent à notre intuition sensible, mais nous avons selon de fortes raisons pratiques d’affirmer leur existence. Kant invoque une « foi pratique », ou encore une « foi rationnelle » en faveur de l’existence de Dieu. Il écrit :
[…] Je croirai immanquablement à l’existence de Dieu et à une vie future, et je suis sûr que rien ne peut rendre chancelante cette croyance, parce que cela renverserait mes principes moraux eux-mêmes, auxquels je ne peux renoncer sans être à mes yeux digne de mépris34.
Renoncer à l’existence de Dieu, ce serait pour Kant renoncer aux principes moraux dont nous observons qu’ils structurent notre raison pratique, et qui font de nous des êtres autonomes, dignes, dotés d’une valeur absolue et non relative. Il existe ainsi selon Kant un lien indéfectible entre la loi morale, dont l’observation respectueuse nous rend dignes du bonheur, et l’existence d’un Dieu qui, par la perspective du souverain bien dans un autre monde, donne son sens à notre action morale. Kant écrit :
La croyance en Dieu et en un autre monde est à ce point liée à ma disposition morale que, tout aussi peu suis-je disposé à perdre cette disposition, tout aussi peu ai-je à craindre de ne pouvoir jamais me voir ravir cette croyance35.
Cette foi rationnelle en Dieu se justifie de la manière suivante : nous constatons la loi morale comme un fait de la raison et prenons connaissance par elle de notre disposition à la moralité. Or cette disposition à la moralité, sans être motivée par le bonheur, trouve cependant en lui, sous la forme du souverain bien, un objet d’espérance qui lui donne son sens. Or seule la supposition d’un Dieu bon et tout puissant nous permet de concevoir le souverain bien comme synthèse de la vertu et du bonheur dans une vie future, et de penser la rétribution divine des vertueux après leur mort, au terme d’un progrès indéfini. C’est en ce sens que Kant, au § 87 de la troisième Critique, invoque une « preuve morale » de l’existence de Dieu : pour concevoir le bonheur auquel peut prétendre celui qui se rend « digne d’être heureux », il faut « admettre qu’il existe un Dieu ». Certes, Kant précise que c’est un argument « subjectivement suffisant », qui ne prouve pas l’existence de Dieu objectivement, mais qui suffit à conforter « les êtres moraux » dans la réalisation des fins bonnes. Il existe donc un lien intime et rationnel entre notre disposition à la moralité et notre foi en Dieu. Dieu n’est pas dans la perspective du Kant une simple Idée posée par le sujet fini, il est également objet d’une foi rationnelle, ce qui signifie : foi en son existence, et confiance en Lui, motivée par la cohérence entre ces idées que sont l’exigence morale, la perspective du souverain bien, l’existence de Dieu.
Revenons à notre question initiale : pourquoi Heidegger a-t-il ainsi exploité le lapsus de Cassirer ? Plusieurs interprétations sont permises. Celle que je retiens n’est pas la plus généreuse : il me semble que Heidegger a exploité ce lapsus car 1. il allait dans le sens de sa thèse, celle d’une finitude insurmontable du sujet kantien ; 2. cela lui permettait de contourner l’objection de fond de Cassirer en se concentrant sur la lettre de son énoncé malencontreux. À mon sens, le débat de Davos s’est ainsi écarté de la question clé, celle qui aurait permis de trancher s’il existe ou non, chez Kant, une percée du sujet fini au-delà de sa finitude initiale. Cette question était celle-ci : partageons-nous effectivement avec Dieu des énoncés d’ordre moral qui régissent nos volontés respectives ? Si Dieu n’est pour Kant qu’une simple « Idée », alors Heidegger a raison : il ne faut pas prendre au pied de la lettre les passages où Kant avance que la loi morale s’étend à Dieu lui-même. C’est là une simple manière de parler, puisqu’en toute rigueur Dieu n’est qu’un simple être de raison dont on ne peut prouver l’existence sur la voie théorique. Dans l’optique heideggérienne, Dieu n’est qu’un objet de pensée pour le sujet fini, n’a de signification que dans son horizon et n’est pas un objet de connaissance. En revanche, si Dieu, comme le soutient Cassirer, est du point de vue de Kant un être existant, objet d’une foi rationnelle, alors oui, nous dépassons notre finitude en faisant communauté avec lui sous le régime de la loi morale. Tel est le point de discussion qui aujourd’hui encore pourrait prolonger le fameux débat de Davos, en vue de trancher, sous cet angle du moins, la question qu’il posait.