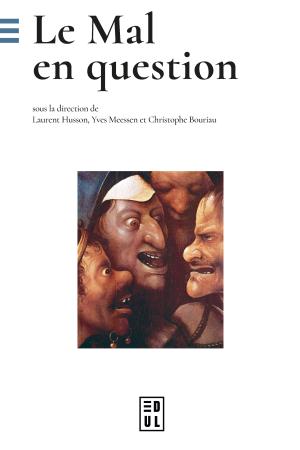
« Un dieu d’amour pourrait dire un jour, ennuyé par sa vertu : “tâtons un peu de la diablerie !” – et voyez, une nouvelle source du mal ! Né de l’ennui et de la vertu !
Friedrich Nietzsche1
Dans La Religion dans les limites de la simple raison, Kant amorce son examen du problème du mal radical dans la nature humaine par le constat du regard pessimiste que les hommes portent inexorablement sur une vie de souffrances dans un monde en déclin, vouée à la perdition et à la destruction :
maintenant (et c’est un maintenant aussi vieux que l’histoire) nous vivons dans les temps ultimes, le dernier jour et la fin du monde sont à nos portes, et, dans certaines contrées de l’Hindoustan, le Dieu qui doit juger et détruire le monde, Ruttren (appelé encore Siba ou Siwen), est déjà adoré comme le Dieu qui est maintenant le plus fort, depuis que Vishnou, le conservateur du monde, fatigué de la charge que lui avait donnée Brahma, le créateur du monde, s’en est démis il y a déjà plusieurs siècles2.
Comment comprendre ce funeste procès qui semble grever l’avenir de l’homme, ne le laissant vivre depuis ses prémices culturelles que dans l’imminence de la fin ? Kant, qui interprète la pensée indienne au filtre de la morale européenne, indique à ce propos que « le mal moral […] marche toujours de pair avec le mal physique3 » : s’il exclut l’idée d’une volonté diabolique en l’homme (autrement dit, l’idée d’un motif déterminant du libre-arbitre qui reposerait sur l’opposition par principe à la loi morale), l’inversion des maximes lui révèle comme une « intelligence secrète » avec un « tentateur »4. L’hypothèse d’un penchant inné à la transgression répond ainsi, quoique par un mystère, à la demande de justification des souffrances humaines, légitimant symboliquement celles-ci comme la sanction d’une faute originaire impénétrable, tout en offrant l’espoir d’une résipiscence.
Nietzsche lui aussi remet le sort des hommes aux mains d’un dieu de la force, un « grand tentateur » qu’il désigne du nom de Dionysos. Mais la destruction s’y inscrit cette fois dans la perspective d’une renaissance :
« Tu me sembles avoir de noirs desseins, dis‑je un jour au dieu Dionysos : à savoir détruire les hommes ? » — « Peut-être, répondit le dieu, mais de telle sorte que j’en tire quelque chose pour mon profit. » – Quoi donc ? demandai‑je avec curiosité. — « Qui donc ? devrais‑tu demander ». Ainsi parla Dionysos, puis se tut de la façon qui lui est propre, de sa façon tentatrice. — Vous auriez dû le voir ! C’était au printemps, et tous les arbres étaient dans la jeunesse de leur sève5.
La destruction de l’humanité intervient chez Nietzsche comme une tout autre sanction de la morale : son autodépassement dans « un autre idéal », « l’idéal d’un bien-être et d’une bienveillance humains-surhumains qui apparaîtra assez souvent inhumain6 ». Dionysos, figure de la philosophie à venir, médite ainsi une inquiétante forme de surhumanité :
Il m’arrive d’aimer l’homme […]. Je lui veux du bien : je réfléchis souvent à la manière dont je pourrais le faire progresser encore et le rendre plus fort, plus méchant et plus profond qu’il ne l’est. — « Plus fort, plus méchant et plus profond ? » demandai-je effrayé. « Oui, répéta-t-il, plus fort, plus méchant et plus profond ; plus beau aussi » — et sur ce, le dieu tentateur se mit à sourire de son sourire alcyonien, comme s’il venait de dire une charmante gentillesse7.
Si ce n’est « effrayé », c’est souvent avec un certain malaise que le lecteur sort des écrits nietzschéens, « non sans une espèce d’appréhension et de méfiance affectant jusqu’à la morale, voire assez fortement tenté de, et encouragé à se faire le défenseur des pires choses : comme si, peut-être, elles n’étaient que les mieux calomniées »8. Loin de se récrier face aux réactions scandalisées à ses œuvres, Nietzsche revendique ainsi une écriture aux accents savamment sataniques : « De fait, pour ma part, je ne crois pas que quelqu’un ait jamais sondé le monde avec un soupçon d’une pareille profondeur, et non pas seulement en avocat occasionnel du diable, mais tout autant, pour parler la langue de la théologie, en ennemi et accusateur de Dieu ». La tentation a souvent été grande de tourner en dérision, à la parodie ou à la littérature toute la sémiotique théologique du « sans-dieu ». Peut-on toutefois réduire ces résonances « démoniaques9 » à de simples bravades ou à d’inconséquentes provocations, quand Nietzsche affirme qu’avec cet idéal tentateur « débute peut-être pour la première fois legrand sérieux »10 ?
L’image paradoxale du « dieu tentateur » Dionysos articule ainsi étroitement plusieurs aspects cruciaux de la réforme de la philosophie que Nietzsche appelle de ses vœux : sa redéfinition comme « art de la tentative et de la tentation11 » (Versucherkunst), d’une part, et sa visée « surhumaine », spontanément perçue comme « inhumaine » et « méchante », d’autre part. Or, cette surdétermination du « tentateur », typique de l’expression nietzschéenne, s’avère redoutablement construite et complexe. Si le Versuch comme pensée de la tentative et de l’essai a fait l’objet de précieux commentaires, son lien constitutif avec la tentation en tant que subversion morale a peu été examiné, si bien que même l’analyse extrêmement fine de Walter Kaufmann l’appréhende comme un « jeu de mots »12.
La perplexité inquiète et tenace vis-à-vis de la philosophie nietzschéenne, tout autant que le puissant attrait qu’elle exerce, tiennent pourtant pour une part essentielle à la réinterprétation du « mal » opérée par cette expression que Nietzsche qualifie de « démonique ». Notre étude se propose d’examiner le double schème du tentateur chez Nietzsche, en éclairant la manière dont la psychologie démonique articule Versuch et Züchtung (ou pensée de l’élevage, ligne de mire du projet de réforme de la culture).
C’est au paragraphe 345 du Gai Savoir, « la morale comme problème », que Nietzsche pose de la manière la plus synthétique la problématique fondamentale de la philosophie selon lui, après avoir reconduit au paragraphe précédent la recherche de la vérité à l’aversion pour la tromperie, donc au terrain moral. En se donnant pour visée l’établissement d’une science morale qui permette le choix du meilleur mode de vie, les philosophes ont, depuis Platon, présupposé résolu un problème qu’ils n’ont jamais authentiquement affronté : celui de l’évaluation des jugements de valeur moraux. Ce que nous estimons « bon », à commencer par cette volonté de « vérité » qui, poussée scientifiquement à ses extrémités, se révèle illusoire, est-il favorable à « l’élévation du type “homme” »13 ? Revenant sur son parcours, Nietzsche affirme dans la préface aux Éléments pour la généalogie de la morale que sa confrontation précoce avec la question matricielle de l’origine du mal, loin de lui en révéler une quelconque profondeur métaphysique, n’a été que l’amorce d’un questionnement bien plus fondamental encore — un questionnement « physique14 », au sens où il relève de l’histoire naturelle des affects :
De fait, le problème de l’origine du mal me poursuivait déjà quand j’étais un jeune garçon de treize ans […] et pour ce qui est de ma “solution” d’alors à ce problème, j’accordai l’honneur à Dieu, en toute équité, et j’en fis le père du mal. […] Par chance, j’eus tôt fait d’apprendre à séparer le préjugé théologique du préjugé moral et ne cherchai plus l’origine du mal derrière le monde. Un peu de formation historique et philologique, avec un sens inné de l’exigence à l’égard des questions psychologiques en général, métamorphosa rapidement mon problème en cet autre : dans quelles conditions l’homme a-t-il inventé ces jugements de valeur de bien et de mal ? et quelle valeur ont-ils eux-mêmes ? Ont-ils freiné ou favorisé jusqu’à présent l’épanouissement humain ?15
Comprendre la métamorphose que Nietzsche impose au problème du mal exige en premier lieu de saisir ce que sont pour lui les « jugements de valeurs de bien et de mal ». Nietzsche le répète, le jugement moral est une illusion : « il n’y a pas de faits moraux du tout. […] La morale n’est qu’une interprétation de certains phénomènes, pour le dire plus précisément, une mésinterprétation »16. Ce que sa « formation historique et philologique » a permis à Nietzsche d’étudier est la très grande variabilité des évaluations conditionnant les sentiments moraux. Une valeur morale n’est pas une donnée factuelle susceptible d’une appréhension objective, pas davantage une prescription universalisable, mais une manière infra-consciente pour le corps d’interpréter, c’est-à-dire de ressentir par des attirances et répulsions ce qu’il estime facteur de croissance ou de dégénérescence vitale. Se placer « par-delà bien et mal » ne signifie donc nullement refuser toute effectivité aux normes morales, mais abolir leur prétention à constituer, sur le modèle idéaliste, des essences objectives et anhistoriques.
Au sein d’une réalité que l’analyse minutieuse de notre expérience conduit à définir comme processuelle et non substantielle, toute évaluation est relationnelle. Les valeurs sont ainsi nécessaires, attendu qu’elles relèvent « des rapports de domination dont découle le phénomène “vie” »17, mais elles reposent sur des appréciations évolutives et variables, fonction des besoins et contraintes propres aux différentes cultures. Chaque interaction implique une appréciation bilatérale, celle des forces ayant l’ascendant et celle des forces dominées. Il y a dès lors toujours une « double préhistoire de bien et mal18 », un dédoublement des perspectives inhérent à toute relation hiérarchisée : une « morale des maîtres » et une « morale d’esclaves », selon la célèbre formulation nietzschéenne, métaphorique. Le bien de l’oiseau de proie n’est pas celui du mouton, et au sein du seul homme, la grande diversité des hiérarchies locales induit des appréciations mêlant les deux optiques.
Dans ces conditions complexes, l’évaluation des valeurs impose un critère de méthode inédit, praxique. Puisque les jugements moraux sont « des symptômes et des langages figurés où se trahissent des processus de réussite ou d’échec physiologique19 », ils ne sont descriptibles et comparables qu’à partir de l’expérimentation et de son déchiffrement. Le philosophe doit « avoir fait en personne 100 espèces de tentatives de vie20 », l’extension de ses expériences permettant, par leur synthèse organique, d’atteindre à la plus grande puissance. La philosophie authentique que Nietzsche entend initier engage donc des « tentatives rigoureuses et courageuses pour vivre telle ou telle morale21 ». L’« art de la tentative » constitue de cette manière le protocole d’une science extra-morale des mœurs, ayant dépassé le dogme d’un bien et d’un mal en soi. C’est en ce sens que Walter Kaufmann présente le Versuch qui prend corps dans le texte nietzschéen comme un « expérimentalisme » (experimentalism) : « “Versuchen wir’s !” Essayons ! Expérimenter implique de tester une réponse en essayant de vivre en accord avec elle »22.
Mais si Nietzche entend tourner le dos aux préjugés théologiques comme moraux en matière de régulations vitales, comment comprendre qu’il recoure à une sémiotique religieuse (à commencer par une divinité antique, Dionysos, apparemment désuète ou folklorique) pour représenter cette « science de l’avenir » ?
En introduisant la notion de « moralité des mœurs », Nietzsche insiste sur le caractère étroitement conditionné des principes moraux et révoque le biais intentionnaliste (qu’il soit intuitionniste, transcendantal ou utilitariste) par lequel nous croyons pouvoir juger de la moralité d’une action : « La moralité n’est rien d’autre (donc littéralement pas plus !) que l’obéissance aux mœurs, de quelque nature qu’elles puissent être ; or les mœurs sont la manière reçue d’agir et d’évaluer »23. Le sentiment du devoir procède de la longue subordination aux mœurs (habitudes, coutumes, lois, rites) commandées par des autorités redoutées, la répétition transformant progressivement la contrainte en source de plaisir tout en conférant à l’action l’assurance d’un instinct. Les impératifs incorporés s’expriment ensuite naturellement non seulement par la voix de la « conscience morale », mais plus globalement par l’ensemble des évaluations perceptives. Si Nietzsche distingue le préjugé moral du préjugé théologique, il n’en relève pas moins leur étroite collusion initiale, au travers des rites cultuels et du pouvoir des prêtres. La peur des forces naturelles hypostasiée ainsi que les pratiques propitiatoires ou conjuratoires pour se les concilier ont si longuement et étroitement été associées aux « sentiments supérieurs » de l’homme (adoration, triomphe, gloire, reconnaissance, extase), que ceux-ci sont comme entremêlés aux imaginaires religieux. Nietzsche établit ainsi un lien fondateur et récursif entre le symbolisme théologique et les sentiments moraux :
Sous l’emprise de la moralité des mœurs, l’homme méprise donc premièrement les causes, deuxièmement les conséquences, troisièmement la réalité, et il rattache tous ses sentiments supérieurs (ceux de la vénération du sublime, de la fierté, de la gratitude, de l’amour) à un monde imaginaire, appelé le monde supérieur. Et nous en voyons encore la conséquence : là où le sentiment de l’homme s’élève, son monde imaginaire entre de quelque manière en jeu. C’est bien triste, mais, en attendant, tous les sentiments supérieurs doivent être suspects à l’homme de science, tant la folie et l’absurdité s’y mêlent. Ce n’est pas qu’ils devraient l’être en soi et pour toujours, mais parmi toutes les purifications progressives qui attendent l’humanité, celle des sentiments supérieurs sera la plus lente24.
Les schèmes psycho-affectifs fixés par la moralité des mœurs aux époques de superstition massive et monopolistique ont joué un rôle primordial dans la formation des états d’âme « élevés » de l’homme (formulation qui condense l’idée d’un sentiment de puissance suprême et celle de son obtention réglée par un élevage moral spécifique). Les « idéaux » de l’humanité consistent ainsi pour Nietzsche dans les formes d’« ivresse » ou de « débauche du sentiment25 » spontanément recherchés par le corps : ils sont les « vers quoi » (wohin) et « pour quoi »26 (wozu) inaperçus et ininterrogés qui guident actions et réactions. Ces idéaux, conditionnements infra-conscient hérités des interprétations religieuses, restent opératoires à titre d’« instincts » ou de « pulsions » dans les conduites de l’Européen moderne, même athée. C’est la raison pour laquelle Nietzsche affirme de manière régulière, et de prime abord sibylline, que « les dieux aussi philosophent »27. Si la philosophie consiste en une praxis législatrice, ce sont les types historiques du « divin », dieux, génies, démons et autres diables devenus instincts, « qui commandent et qui légifèrent […], ils déterminent en premier lieu le vers où ? et le pour quoi faire ? »28 :
Celui qui examinera les instincts fondamentaux de l’homme afin de se faire une idée du degré précis auquel ils peuvent être entrés en jeu ici en tant que génies inspirateurs (ou démons, ou farfadets –), trouvera qu’ils ont déjà, tous autant qu’ils sont, fait de la philosophie un jour, – et que chacun d’eux à titre individuel ne serait que trop heureux de se donner lui-même pour but ultime de l’existence et pour maître et seigneur légitime de tous les autres instincts. Car tout instinct est tyrannique : et c’est comme tel qu’il cherche à philosopher29.
Nietzsche tire de ces analyses des conséquences pour la tâche qu’il s’assigne, favoriser la volonté de vie contre le nihilisme qui l’exténue. Car le nihilisme qui grève l’avenir de l’homme est une crise des « idéaux », une contradiction et une faillite progressive des autorités affectives orientant spontanément l’action humaine : « Une histoire des sentiments élevés, des “idéaux de l’humanité” – et il est possible qu’il me faille la raconter – serait presque du même coup une explication du pourquoi d’une telle corruption de l’homme »30. La « purification » des sentiments supérieurs de l’humanité engage certes un démantèlement de leur enchevêtrement avec des croyances religieuses désormais incompatibles avec l’instinct rationnel, mais elle exige dans le même temps une réorientation de leur charge affective en déshérence. Si Nietzsche mobilise et instrumentalise les symboles religieux, « moyens d’élevage et d’éducation entre les mains des philosophes31 », ce n’est donc ni par simple provocation ni par légèreté parodique, mais par rigueur méthodologique : créer de nouveaux idéaux exige nécessairement de s’appuyer sur ceux préalablement incorporés. Toute la « démonologie » nietzschéenne s’inscrit dans cette stratégie d’intervention et d’expérimentation ciblées sur les instincts du lecteur.
Dans la typologie religieuse des sentiments moraux qu’il entreprend à ces fins d’élevage (Züchtung), Nietzsche insiste sur une opposition essentielle entre l’axiologie propre à l’Antiquité grecque et l’axiologie chrétienne. Pour le polythéisme grec, toute puissance passionnelle, toute pulsion vitale, quel qu’en soit le caractère dangereux ou nocif, est divinisée : l’agressivité, la colère, la volupté, la duplicité, l’envie, trouvent sous les traits d’Arès, de Zeus, d’Aphrodite, d’Hermès ou d’Éris leur droit de cité au panthéon des puissances vénérées. Une telle économie affective permet une décharge réglée des divers instincts naturels, tout en adoucissant par la codification et la ritualisation leur violence débridée. Il n’est jusqu’à la transgression de l’ordre social et de la moralité, telle qu’elle se présente avec l’arrivée en provenance d’Asie du culte de Dionysos, qui ne trouve finalement dans la culture tragique son idéalisation apollinienne, sa forme, sa maîtrise32.
Pour celui qui considère le monde grec, peut-être n’y a-t-il rien de plus déconcertant que de découvrir que de temps en temps les Grecs célébraient pour ainsi dire leurs passions et leurs mauvais penchants naturels et même organisaient au nom de la Cité une sorte d’ordre des cérémonies de leur trop-humain. […] Ils tenaient ce trop-humain pour inéluctable et préféraient, plutôt que de le vilipender, lui accorder une sorte de droit de deuxième rang en l’intégrant dans les usages de la société et du culte : oui, tout ce qui dans l’homme est puissance, ils l’appelaient divin et l’inscrivaient au fronton de leur firmament33.
Loin de tenir grief à l’existence des douleurs générée par l’adversité naturelle, le pessimisme tragique qui s’exprime dans le monde homérique la glorifie par l’exaltation des extases multiples offertes par les élans rivaux. Les souffrances infligées par la conflictualité inhérente à la vie sont ainsi justifiées en une idéalisation artistique qui les porte à l’apothéose :
Comment ce peuple doté d’une sensibilité si excitable, de désirs si fougueux, si singulièrement apte à la souffrance, aurait-il pu sans cela supporter l’existence si, dans ses dieux, celle-ci ne lui avait pas été montrée baignée d’une gloire supérieure. […] Les dieux justifient de la sorte la vie humaine – en la vivant eux-mêmes – la théodicée qui suffit à elle seule !34
Or, Nietzsche ajoute aux effets autorédempteurs de ce polythéisme pulsionnel une « utilité majeure » : par l’ennoblissement (c’est-à-dire par le renforcement et l’accès au statut de force dominante) et par la sublimation artistique de la pulsion dionysiaque de transgression, il a préparé le terrain affectif à l’affirmation de l’individu comme législateur axiologique autonome :
Utilité majeure du polythéisme. – Que l’individu s’érige son propre idéal et en dérive sa loi, ses joies et ses droits – voilà qui a été considéré jusqu’à présent comme la plus monstrueuse de toutes les aberrations humaines et comme l’idolâtrie en soi ; les rares qui l’osèrent ont en effet toujours eu besoin d’une apologie pour eux-mêmes, laquelle prenait habituellement la forme suivante : « pas moi ! pas moi ! mais un dieu à travers moi ! » L’art et la force merveilleuse de créer des dieux – le polythéisme – voilà ce en quoi cette pulsion pouvait se décharger, en quoi elle se purifiait, s’élevait à la perfection, s’ennoblissait : car à l’origine, c’était une pulsion vulgaire et insignifiante, apparentée à l’entêtement, à la désobéissance et à l’envie. Être hostile à cette pulsion d’idéal personnel : c’était autrefois la loi de toute moralité. Il n’y avait alors qu’une norme : « l’homme » – et tout peuple croyait détenir cette norme unique et ultime. Mais au-dessus de soi et en dehors de soi, dans un lointain surmonde, on pouvait voir une multiplicité de normes : un dieu n’était pas négation de l’autre dieu ou blasphème envers lui !35
Nietzsche emprunte donc au polythéisme grec le nom de Dionysos pour désigner la tendance particulière, originairement « apparentée à l’entêtement, à la désobéissance et à l’envie », qui pousse à la rupture des obligations, mais aussi à la création de nouveaux dieux, la « pulsion d’idéal personnel ». Pour saisir pleinement le rôle crucial et atypique de cette pulsion, il faut lui associer un élément historique décisif. L’institution de la paix et de la vie sociale, autrement dit l’organisation en communauté politique, induit selon Nietzsche une transformation culturelle profonde, « l’intériorisation de l’homme »36, à la fois introversion et spiritualisation de l’activité pulsionnelle. Ce processus implique la réversibilité des hypostases polythéistes : les instincts idéalisés sous formes externes de déités sont également vécus comme des forces extérieures pouvant posséder ou inspirer l’âme individuelle. D’où le topos du « dieu » privatif, invoqué à titre apologétique pour justifier l’infraction à la moralité des mœurs, et que signale dans le texte précédent l’allusion au signe démonique (daimonion sêmeion37) de Socrate.
C’est notamment masquée sous la variation terminologique du « démonique » (dämonische) que l’analyse du dionysiaque se poursuit durant la dizaine d’années qui succède à La Naissance de la tragédie. Que nous apprend cette piste exploratoire quant à l’idéal tentateur que Nietzsche place sous le signe de Dionysos philosophos ?
En philologue averti, Nietzsche n’ignore pas le double usage fait par Homère du terme de daïmōn. Parfois équivalent à theós, il peut désigner des déités identifiées du panthéon grec, mais dénote plus souvent une divinité mystérieuse et provisoirement cachée, dont l’identité est ignorée de celui qui l’évoque comme de celui à qui elle inspire des pensées, de stratégie guerrière généralement38. Le terme de « démonique » apparaît sous la plume de Nietzsche dès 1864, dans une lettre à Rudolf Buddensieg, ancien camarade de Pforta, pour désigner une suggestion passionnelle exercée musicalement sur le spectateur. L’effet démonique y est décrit comme une « excitation nerveuse » pouvant être produite par « tous les arts supérieurs ». Déclenchée par un élément fortement contrastant, cette stimulation « agit comme un soudain miracle » réveillant des « pressentiments de mondes supérieurs »39. Le paragraphe 240 d’Aurore, « De la moralité de la scène », reprend cette analyse près de 17 ans plus tard à partir de l’exemple de Macbeth :
Celui qui se figure que le théâtre de Shakespeare a un effet moral et que la vue de Macbeth détourne irrésistiblement des méfaits de l’ambition, celui-là se trompe. […] C’est avec quelque chose de royal, mais rien d’un franc coquin, que son ambitieux parcourt sa carrière une fois son forfait accompli ! Ce n’est qu’à partir de ce moment qu’il exerce une attirance « démonique » et suscite l’imitation des natures semblables. J’entends ici par démonique : à l’encontre de l’intérêt et de la vie, au profit d’une pensée et d’une pulsion. Croyez-vous donc que Tristan et Isolde donnent une leçon contre l’adultère parce qu’ils en meurent tous les deux40 ?
Trois caractéristiques essentielles de l’« attirance “démonique” » sont ici exposées, qui toutes intéressent Nietzsche pour sa tâche d’élevage pulsionnel :
La psychologie démonique fait l’objet d’une thématisation particulièrement appuyée dans Aurore, ouvrage dans lequel Nietzsche examine les modalités de l’éducation morale au prisme des logiques affectives sous-tendant le sentiment de puissance. Le paragraphe 33 introduit la « puissance démonique » comme une divinité nouvelle, concurrente de celle auparavant adorée et réclamant l’invention de nouveaux usages pour mettre fin aux fléaux frappant une communauté après qu’une infraction aux mœurs a été commise. Le paragraphe 172 réinvestit cette « force démonique » dans l’examen de la puissance d’envoûtement exercée par la pitié tragique sur les mentalités guerrières :
Tragédie et musique. Les hommes de mentalité foncièrement guerrière, comme par exemple les Grecs à l’époque d’Eschyle, sont difficiles à émouvoir, et quand la pitié vient à vaincre leur dureté, elle les saisit comme un vertige semblable à une « force démonique » : ils se sentent alors privés de liberté et agités d’un frisson religieux. Après coup, ils font des réserves sur cet état ; aussi longtemps qu’ils s’y trouvent, ils jouissent du ravissement d’être hors de soi et de celui du merveilleux, auquel se mêle l’absinthe la plus âcre de la souffrance : c’est un véritable breuvage de guerriers, quelque chose de rare, de dangereux et de doux-amer que l’on n’a pas facilement en partage43.
La pitié se manifeste comme l’antagoniste de la « dureté », l’une des vertus dominantes de l’aristocratie hellénique archaïque puis tragique, rigoureusement conformée au commandement et à la maîtrise de soi par la discipline militaire. D’où peut alors provenir chez ce type d’homme l’atypique « ravissement d’être hors de soi », à la fois jouissance et souffrance ? Dans une communauté à la moralité sévèrement verrouillée par l’intérêt de la cité, mais animée par l’agôn, le sentiment le plus enivrant est celui de « vaincre » une puissance tyrannique dominante, en l’occurrence, celle des mœurs :
Tous les Grecs (cf. Gorgias de Platon) croyaient que posséder la puissance du tyran constituait le bonheur le plus enviable : sans en exclure la scélératesse. […] Le bonheur suprême auquel chacun croyait était entièrement assimilé au sentiment de puissance : mais on traitait cet état comme l’immoralité absolue (ennemie des mœurs, c.‑à‑d. individualiste égoïste)44.
Le démon de la pitié tragique intervient donc comme une force illicite, dont le triomphe sur l’instinct régnant procure à l’âme guerrière la violente exultation d’une prise de pouvoir. Loin d’être anodine, cette analyse du démon de la pitié est essentielle pour la compréhension de l’évolution de la morale européenne, car elle met en évidence l’un des ressorts de l’expansion du christianisme. Celui-ci, selon Nietzsche, s’appuiera stratégiquement sur la représentation du martyre (à commencer par celui de Jésus) pour faire de la violence renversante de la pitié le socle de sa contagion affective aux sphères dominantes, laissant pour héritage dans la morale occidentale un idéal incontesté de compassion.
Tout démon, conclut le paragraphe 262 d’Aurore, quels que soient la forme empruntée et le nom qu’on lui donne, autrement dit quel que soit le désir qui lui serve d’occasion et celui dont il vient contester la suprématie, est le « démon de la puissance » : la pulsion de renversement d’un commandement moral tyrannique :
Le démon de la puissance. Non, ce n’est pas la nécessité vitale, ni le désir, qui est le démon des hommes, mais l’amour de la puissance. On peut tout leur donner : santé, nourriture, logement, divertissement, ils sont et restent malheureux et lunatiques ; car le démon attend, attend encore et veut être satisfait. Qu’on leur prenne tout, et qu’on satisfasse le démon : les voilà presque heureux, autant que peuvent l’être hommes et démons45.
Le démonique, foncièrement polymorphe, est donc une structure psychologique ne renvoyant à aucun contenu spécifique qui puisse être absolutisée ou essentialisée : tout instinct peut exercer cet attrait tentateur, selon la complexion axiologique à laquelle il s’oppose et qu’il détruit, devenant alors à ses yeux l’incarnation d’un « mal ». Le démon tentateur est pour Nietzsche ce que Kant refusait : une structure psychologique d’opposition à la « loi » morale liant les instincts, un processus interne à « la volonté » (organisation unifiée, mais intrinsèquement multiple selon Nietzsche) poussant à l’inversion de la hiérarchie des maximes. Selon qu’un instinct est perçu et désigné du point de vue du complexe de domination adverse, ou qu’il règne en souverain attitré, il sera démon ou dieu : « Tous les dieux n’ont-ils pas jusqu’à présent été des diables devenus saints et rebaptisés de la sorte ? Et que savons-nous en fin de compte de nous-mêmes ? Savons-nous comment l’esprit qui nous mène veut qu’on l’appelle ? (c’est une affaire de nom) »46.
Dans l’examen des logiques de rivalité affective, le daimonion sêmeion socratique joue le rôle d’un cas paradigmatique, sur lequel Nietzsche revient très fréquemment47.
C’est ainsi parce que Socrate le plébéien vivait « comme un soldat »48 soumis au strict commandement des lois athéniennes, mais aussi à la tyrannie de passions naturelles surpuissantes, qu’un daïmōn l’a détourné de la vie politique pour une vie philosophique, lui insufflant insidieusement d’imposer une autre forme de pouvoir et de prestige à Athènes49.
Cependant, alors même qu’au nom du nouvel ordre dialectique qu’il édifie, Socrate combat l’instinct créateur des poètes, autorités vénérées, un daïmōn artistique lui susurre au soir de sa vie : « Fais de la musikè, compose50 ». Nietzsche voit dans cet appel démonique l’inspiration poétique du « divin » Platon, qui suggère agonalement au noble disciple la tentation d’imposer quant à lui à la Cité à la fois de nouvelles lois et une nouvelle foi51. Car les « essences » ou « vertus » platoniciennes (le Juste, le Bien, le Vrai) ont finalement exercé, souligne Nietzsche, « les droits et la puissance d’une surhumanité sanctifiée » :
Dans la Grèce tardive, les cités regorgeaient de telles abstractions divines humanisées (qu’on pardonne ce terme bizarre à cause de la bizarrerie de la notion) ; le peuple s’était arrangé à sa façon un « ciel des idées » platonicien au milieu de sa terre, et je ne crois pas qu’on ait trouvé les hôtes de ce ciel moins vivants que n’importe quelle divinité de l’antiquité homérique52.
Arrêtons-nous sur ce point, éclairant la notion nietzschéenne de « surhumain » : l’homme socratique, incarnation des abstractions idéelles renversant le panthéon homérique, est (paradoxalement) « surhumain » relativement à l’homme tragique. Pour cette même raison, il incarne cependant la corruption d’un certain idéal d’humanité enfermé dans la hiérarchie des valeurs antérieures. Le processus de renversement produit nécessairement un jugement d’immoralité53, en même temps qu’une apparente déshumanisation.
Récapitulons : l’histoire naturelle de la morale entreprise par Nietzsche met en évidence le rôle primordial des « idéaux » religieux dans l’affirmation de la volonté de vie. L’étude du polythéisme grec permet de cerner l’économie affective d’accroissement de la puissance, en précisant les logiques oppositionnelles qui conduisent aux renversements de régime affectif. Le démonique prend ainsi ses sources dans la conflictualité interne propre à l’organisation collective de la culture tragique, que Nietzsche analyse comme une aristocratie pulsionnelle immortalisée dans l’Olympe homérique. Le démon « inspirateur » émerge de l’intériorisation des pulsions (notamment de la pulsion dionysiaque de transgression, relayée par la pulsion d’idéalisation artistique), dont résulte un phénomène symptomatique : la création de nouveaux idéaux personnels.
À ce point de notre enquête, une difficulté mérite d’être soulevée : si l’optique nietzschéenne est celle d’un élevage des pulsions propices à une humanité supérieure, et assurée d’un avenir, comme Nietzsche aime à le répéter, pourquoi placer cette entreprise sous le signe d’une pulsion portant chaque configuration à sa destruction ?
Dès 1874, Schopenhauer éducateur offre sur cette question des indices, en partant cette fois-ci du démon de Faust, tel que Goethe l’envisage54. Le « génie démonique » qui possède « l’humain goethéen » pose d’ailleurs à cette occasion une instructive difficulté à Marie Baumgartner, traductrice du texte lors de sa première édition en français, qui propose de restituer dämonisch par « diabolique ». Nietzsche lui répond spirituellement en l’incitant à lire « entre les lignes » les indications laissées pour prévenir toute confusion entre démonique et diabolique :
Je suis presque toujours d’accord avec les propositions de traduction ; je recommande à votre attention quelques notes que j’ai écrites entre les lignes. Il n’y a que le diable que nous devons en tout cas expulser ; dès que nous disons « diabolique », nos pensées prennent une coloration dans laquelle je ne reconnais pas du tout mon pauvre « démonique ». C’est qu’existent de bons démons, et Faust était possédé par l’un d’entre eux55.
Quel est, au juste, ce bon démon qui possède Faust ? La troisième Considération inactuelle le précise en décrivant la succession de trois types psychologiques « d’où les mortels tireront encore bien longtemps l’impulsion à transfigurer leur propre vie »56 : l’humain de Rousseau, force de révolte contre la dénaturation, l’humain de Goethe, contemplatif de grand style, et l’humain de Schopenhauer, Méphistophélès incarné, affirmant par sa véracité héroïque et passionnée les lois d’une vie plus haute. Si l’esprit démonique qui possède l’homme de Goethe est un « bon démon », c’est qu’il intervient dans cette série typologique comme un intermédiaire et un intercesseur. En invitant le savant à voyager avec équanimité parmi toutes les grandes réalisations de l’histoire des différentes cultures, à les assimiler sans s’arrêter définitivement à aucune des valeurs qui les ont fait naître, il est « le correctif et le sédatif » des violents instincts d’insurrection rousseauistes. Parce qu’il œuvre au rassemblement des perspectives et s’oppose à l’univocité axiologique héritée de la morale platonico-chrétienne, le démon faustien est l’anti-fanatisme même, la pondération réciproque des forces. L’humain goethéen ouvre ainsi la voie à une nouvelle synthèse des valeurs, un « aristocratisme de l’avenir » qu’il ne peut toutefois réaliser faute d’un affect unifiant : « Il manque le grand homme synthétique : dans lequel les différentes forces se trouvent jugulées sans scrupule pour un seul but. Ce que nous avons, c’est l’homme multiple […] Goethe, la plus belle expression du type (– en aucun cas Olympien !) »57.
L’analyse de l’humain goethéen précise ainsi, au-delà du seul démon faustien, l’un des aspects essentiels du démonique : il est « une force qui conserve et qui concilie58 ». Le diabolique, tout au contraire, comme le signale du reste son étymologie, relève d’une logique qui divise et désunit. Alors que la fonction « démonique » procède d’une logique vitale d’affirmation de la puissance par recombinaison affective, l’instanciation du diable (Teufelei) signe sa décomposition.
Innovation stratégique chrétienne par excellence, L’Antéchrist présente la diabolisation comme une tactique de domination détournée consistant à affaiblir la force qui subjugue en culpabilisant la puissance elle-même, non la capitulation face à elle : « C’est là que le mot “diable” a été une bénédiction : on avait un ennemi très puissant et redoutable, on n’avait plus à avoir honte de souffrir de la part d’un tel ennemi »59. Le diable n’est plus l’adversaire envié et respecté, mais l’ennemi honni, le « maître » exécré et calomnié :
À l’aide du même instinct par lequel les dominés ravalent leur Dieu au « Bien en soi », ils effacent les bonnes qualités du Dieu de leurs dominateurs, ils se vengent de leurs maîtres, en diabolisant leur Dieu60.
La diabolisation de la puissance, expression d’une « morale d’esclaves », selon la métaphorique politique, traduit le ressentiment du « peuple » (les pulsions dominées) envers toute volonté de domination et introduit en l’homme une aversion, devenue instinctive, envers la maîtrise et la hiérarchie elles-mêmes. En faisant de la volonté de puissance l’expression du « mal », le dualisme moral chrétien diabolise toutes les pulsions naturelles qui en sont la manifestation, tout en divinisant de manière uninominale leur antithèse, l’impuissance à la puissance, le « bon Dieu ». L’axiologie chrétienne inscrit ainsi jusque dans la définition de l’humanité la haine de soi et l’aspiration à sa propre destruction, faisant du « triomphe dans l’agonie » son « sentiment supérieur », son idéal.
La diabolisation des pulsions a cependant pour effet d’aiguillonner les esprits « héroïques », qui courent à l’interdit. Quand domine encore la logique vitale, puissance d’assimilation et d’organisation, la répression aiguise les pulsions et les articule autrement à l’idéal dominant. Ainsi, par exemple, des pulsions sexuelles : Érôs, démon-philosophe chez Platon61, s’est spiritualisé en amour-passion sous le joug des valeurs chrétiennes qui l’ont diabolisé, imposant finalement un nouvel idéal :
Pour finir, cette diabolisation de l’Éros a connu une issue comique : le « diable » Éros a eu peu à peu plus d’intérêt pour les hommes que tous les anges et tous les saints grâce aux basses intrigues et menées secrètes de l’Église en matière érotique62.
Cela étant, Nietzsche n’en dresse pas moins un inquiétant constat : si le christianisme a inscrit la haine de la puissance dans les instincts humains, la « mort de Dieu », qui a pour corolaire l’extinction progressive de ses adversaires, démons et diables, épuise à son tour la logique vitale d’accroissement de la puissance. En situation de vacance du commandement axiologique, l’agôn se détend, l’ensemble de la structure affective s’affaiblit :
Qu’était-ce que la joie à une époque où l’on croyait aux diables et aux tentateurs ! Qu’était-ce que la passion, quand on voyait les démons guetter, tout proches ! Qu’était-ce que la philosophie quand le doute était ressenti comme un péché de l’espèce la plus dangereuse, et ce en tant que sacrilège envers l’amour éternel, méfiance envers tout ce qui était bon, élevé, pur et miséricordieux !
Nietzsche martèle, particulièrement dans ses derniers écrits, cet élément crucial : l’antagonisme des forces en présence est la condition d’une augmentation de puissance, on doit « aimer ses ennemis ». Cette détermination affective, l’amour de l’adversité, est le signe de l’aristocratie que Nietzsche entend établir en prenant pour modèle la culture de la Grèce tragique, mais sur la base de pulsions affinées par l’histoire. L’écriture nietzschéenne vise en effet à élever une série de valeurs concurrentes, associées à une aptitude à la discipline permettant à chacune d’entre elles de « rester dans le rang, mais en étant capable à tout instant d’en prendre la tête »63, de se faire maîtresse ou auxiliaire, selon sa mesure des forces associées et affrontées : « Toute élévation du type “homme” fut jusqu’à présent l’œuvre d’une société aristocratique »64. L’amplitude du spectre axiologique est ainsi le ressort et l’effet de la psychologie démonique, ainsi que le critère de durée d’une structure. La multiplicité des normes permet en effet à chaque force d’être le contre-pouvoir de la violence destructrice des autres, tout en exaltant la puissance de l’ensemble de la structure affective : « Sous toute oligarchie – l’histoire entière l’enseigne – se cache toujours l’envie de tyrannie ; toute oligarchie vibre constamment sous la tension dont a besoin tout individu qui en est membre pour rester maître de cette envie »65. Il reste à comprendre par quelles « tentations » Nietzsche prétend communiquer une telle détermination affective.
À partir du milieu des années 1880, le thème du « démonique » s’efface, relayé par deux figures distinctes, mais associées. La figure de « l’esprit libre », précurseur du philosophe authentique, passe au premier plan, incarnant la rupture des obligations et l’exception contre la règle. S’il n’apparaît cependant qu’à titre prémonitoire66, c’est que dans ce type se profile une pulsion dionysiaque sublimée, résultat de la « synthèse » démonique. L’esprit libre est l’aboutissement du processus de spiritualisation des pulsions d’opposition à la norme et de recherche de la distinction, condensant et épurant les formes historiques de l’indépendance. De même, le thème du « tentateur » (Versucher) synthétise les pulsions « héroïques » de tentation du défendu (le « nitimur in vetitum » dont Nietzsche fait sa devise) et l’exigence scientifique d’expérimentation (la « tentative »).
C’est en s’appuyant sur le schème démonique que Nietzsche élabore un « art de la tentative et de la tentation » ainsi que de « l’astuce diabolique en tout genre »67 (Versucherkunst und Teufelei jeder Art). La réponse à l’exhaustion nihiliste repose en effet sur l’exhaussement réciproque et l’équilibre tendu des pulsions rivales, condition de leur spiritualisation progressive, laquelle retarde et catalyse tout à la fois un renversement axiologique. Cet élevage pulsionnel expérimental n’est pas annoncé à titre programmatique, il s’effectue dans le texte, l’écriture constituant pour Nietzsche une technique de sélection et de formation affective du lecteur. C’est ce que pointe précisément Éric Blondel dans l’analyse qu’il effectue du Versuch comme écriture « généalogique », c’est-à-dire comme expression scripturale d’une polyphonie pulsionnelle contrariant le fixisme et l’univoque de la métaphysique du langage : « C’est le texte-même de Nietzsche qui assure cette construction-destruction de la métaphysique, discours systématique de propositions enchaînées dans l’univocité, aboutissant à la négation de la vie, du corps, du devenir, et c’est dans sa pratique du texte qu’il faut en repérer les règles de fonctionnement »68.
Les « règles de fonctionnement » de cette pratique nous ont été fournies par Nietzsche dans son analyse de la communication démonique, il les emploie à sa tâche. La tentative de faire valoir une nouvelle perspective comme tentatrice, requiert d’abord, rappelons-le, la mobilisation par le biais d’excitations sensorielles d’états d’âme élevés (« merveilleux », « mondes supérieurs », « extase »), ainsi qu’un effet de contraste attachant le « thème innovant » (la passion à valoriser) aux sentiments bouleversants. Le renversement n’est toutefois que la première phase du dépassement, qui implique que les anciennes pulsions soient ensuite mises au service de nouvelles valeurs affirmatrices.
De même que la majesté altière de Macbeth glorifie l’ambition régicide, ou que la passion sacrificielle de Tristan et Yseult magnifie l’adultère, Nietzsche entend pour sa part dévaluer les concepts typiques des idéaux négateurs (la pitié, l’abnégation, le ressentiment, la véracité, notamment), et réinvestir affectivement les concepts axiologiques « nobles » (l’agressivité, l’émulation, la solitude, la hiérarchie, la puissance, la maîtrise). Se faire « accusateur de Dieu » et « avocat du diable » implique ainsi d’invoquer la sémiotique des idéaux hérités, de manière à produire linguistiquement de nouvelles associations pulsionnelles renversant les valeurs décadentes. En mobilisant la langue, l’imagier ou le ton de la théologie, le « sans-dieu » compose donc une symphonie affective à réception variable :
L’influence que l’on peut exercer à l’aide des religions en termes de sélection, d’élevage, c’est-à-dire toujours également de destruction et de création et d’imposition de forme, est multiple et diversifiée suivant l’espèce d’hommes qui se trouvent placés sous leur charme et leur protection69.
La sensibilité à l’évocation du « démon » est déjà sélective, dans la mesure où elle témoigne d’une dominante affective déterminée. La crainte de « l’engeance diabolique »70 repoussera le lecteur en qui dominent les idéaux chrétiens, permettant à Nietzsche de garder l’accès de ses idées les plus défendues, quand l’attirance pour le démon, témoignant d’autres échos culturels ou d’une certaine « décadence » des idéaux négateurs, attirera les esprits libres : « une “stimulation des sens” n’est une “tentation” que dans la mesure où il s’agit d’êtres dont le système est trop aisément ébranlé et influençable »71. C’est ainsi en empruntant les mots de l’inspiration démonique que Nietzsche évoque la pensée de l’élevage :
Une question se repose toujours à moi, une question tentatrice et mauvaise, peut‑être : soufflons‑la à l’oreille de ceux qui ont droit à ce genre de questions qui méritent questionnement, aux plus fortes âmes d’aujourd’hui, celles aussi qui se maîtrisent le mieux : ne serait‑il pas grand temps, plus on développe actuellement en Europe le type « animal du troupeau », de tenter d’instaurer un élevage systématique, artificiel et conscient afin de produire le type opposé et ses vertus ?72
C’est également par la voix d’un démon (appelé à devenir « divin ») qu’est présentée la doctrine de l’éternel retour au § 341 du Gai Savoir. Or, cette croyance s’oppose aussi bien au dogme chrétien d’une survie de l’âme, qui entraîne le mépris de la vie terrestre, qu’à la thèse matérialiste d’une définitive fugacité de l’homme. Elle se présente donc comme une possibilité d’« épurer » les croyances antérieures de leurs effets dissolvants sur l’attachement à la vie, tout en conservant et en conciliant leurs tendances affirmatrices (l’amour de soi et de sa survie, l’adhésion perpétuelle au sensible).
Si la référence à un démon est parfois explicite, comme dans les exemples précédents, l’effet transvaluateur de la suggestion démonique agit principalement de manière tacite, et par la seule manipulation des résonances affectives. Avant de terminer notre étude par une brève illustration d’une telle tentative, rappelons les éléments nécessaires à sa compréhension. Nietzsche insiste sur la coexistence en un même homme des axiologies « nobles » (guerrière et sacerdotale, aux idéaux originairement rivaux) et « plébéienne » (ou « esclaves »), mélange encore plus accentué au sein d’une « nature supérieure » :
[I]l n’y a peut-être pas de marque plus caractéristique de la « nature supérieure », de la nature vraiment spirituelle que d’être en dissension au sens que l’on vient d’évoquer et de demeurer un véritable champ de bataille où s’affrontent ces opposés. Le symbole de ce combat, écrit d’une écriture demeurée lisible à travers toute l’histoire humaine jusqu’à présent, est le suivant « Rome contre la Judée, la Judée contre Rome »73.
Le texte nietzschéen s’adresse en conséquence synchroniquement aux diverses perspectives évaluatrices, de manière à remobiliser l’antagonisme des forces et à en organiser une nouvelle synthèse. Fidèle à son art revendiqué de l’énigme, Nietzsche donne d’ailleurs une clé du modus operandi du renversement de toutes les valeurs dans un posthume datant du mois précédant son effondrement : « le Renversement doit paraître en deux langues. […] Je tiens à avoir pour moi tout d’abord les officiers, et les banquiers juifs : – ces deux groupes représentent ensemble la volonté de puissance74 ». On comprendra que « ces deux groupes » pris « ensemble » renvoient, par le biais de l’auto-traduction nietzschéenne, à l’antagonisme des aristocraties pulsionnelles précitées. C’est en adoptant ce dispositif que se réalise en fait concrètement cette « hétérologie » qu’Éric Blondel présente comme étant la spécificité du texte généalogique : « La généalogie devrait être hétérologie, alors que tout logos ne peut se soutenir que d’un principe d’homologie. Voilà Nietzsche au rouet : partagé, à la lettre, entre la philologie et la misologie »75.
De quelle manière ce double discours s’exprime-t-il pratiquement au sein du même texte ? Rappelons encore que l’évaluation noble a pour « affects supérieurs », présidant respectivement à ses qualifications en bien et en mal, la fierté et le mépris, quand l’évaluation plébéienne a pour affects appréciatifs le sentiment d’innocuité et la peur. Suivant ces indications, arrêtons-nous au paragraphe 26 du troisième traité des Éléments pour la généalogie de la morale, dont la tonalité tranche par la soudaine véhémence avec le reste de l’œuvre. Nietzsche, s’y réclamant ironiquement du dionysiaque patronage d’Anacréon, intrique systématiquement dans ce paragraphe trois gammes d’affects, qui s’associent en une charge solidaire contre les idées nihilistes. Le lexique de l’ironie acerbe et du dégoût, tonalités disqualifiantes provenant de l’aristocratie sacerdotale (type psychologique ayant pour valeur dominante l’intelligence) et de l’aristocratie militaire (type psychologique ayant pour valeur fondamentale l’épanouissement physiologique) s’y expriment sur un ton de « fureur » propre à inspirer, pour l’axiologie plébéienne (le peuple des pulsions), la craintive soumission.
Le leitmotiv de cette charge à deux voix est l’anti-pitié (« je n’ai pas de sympathie pour », expression répétée six fois de suite), prenant pour cible des figures hybrides (représentative de l’homme moderne, pour Nietzsche) combinant les antithèses des deux axiologies nobles. Ainsi, l’exécration pour « la lâche contemplation de l’eunuque concupiscent » exprime aussi bien le dédain guerrier envers le manque de « virilité » du contemplatif que le mépris d’ascète envers une pathétique « lubricité ». L’évocation sarcastique des « sépulcres blanchis qui jouent la comédie de la vie » rassemble la défiance narquoise de l’héroïsme juvénile envers la vieillesse régressive et le dégoût cultivé envers la comédie. Quant à l’assaut qui vise les « agitateurs endimanchés en costume de héros, recouvrant d’un heaume magique d’idéal la botte de foin qui leur tient lieu de tête », elle synthétise en une image caustique cette contradictio in adjecto qu’est le chevalier très chrétien (tel que Wagner en communique l’idéal aux philistins cultivés dans Parsifal, selon Nietzsche).
Habitués à appréhender la philosophie comme une discipline théorique et le raisonnement comme un acte intégralement conscient, nous demeurons généralement aveugles, face au texte, au jeu d’affects qui entraîne nos interprétations. Analysant l’écriture nietzschéenne, P. Wotling rappelle qu’elle ne consiste pas en un corps de doctrines, mais constitue en elle-même une expérimentation en constante élaboration. Le Versuch est conjointement une stratégie scripturale (une série de tentations) et un essai d’interprétation des tentatives axiologiques constituant l’histoire humaine : « Nietzsche considère bien l’histoire si diversifiée de l’humanité comme un immense Versuch : c’est le lieu où se sont effectuées d’ores et déjà des séries de « tests » permettant de savoir si l’on peut vivre en accord avec telle ou telle série de valeurs, et d’établir également quel est le résultat produit à chaque fois par la tentative »76. Dans cette histoire de la culture, le lecteur est partie prenante de l’expérimentation dont participent ses interprétations, c’est en lui et sur lui que se poursuit le projet de l’élevage du philosophe à venir.
Dionysos, démon incitant chaque forme de vie à tester un remaniement des configurations de domination, n’appelle donc à la destruction de « l’humanité » que dans la mesure où elle n’a pas encore exploré toutes les axiologies par lesquelles elle pourrait se développer et se surmonter. Pour l’y inviter, le texte nietzschéen agit comme un réservoir de tentatives latentes à disposition du lecteur, modifiant progressivement et de manière réglée ses logiques pulsionnelles, tout en tirant de ses expériences les enseignements nécessaires à leur poursuite. L’observation clinique des « différents modes de croissance qu’ont connus et que peuvent encore connaître les pulsions humaines suivant les différents climats moraux » est l’espace ouvert « d’une expérimentation dans laquelle toute espèce d’héroïsme pourrait se satisfaire, qui éclipserait tous les grands travaux et sacrifices de l’histoire écoulée jusqu’à présent »77. Si Nietzsche, pour mieux réveiller la pugnacité et l’audace des antiques instincts héroïques, revêt « la malice du diable et le costume du diable »78, c’est ainsi, dit-il, en « saint masqué », œuvrant à ressusciter l’amour de la vie, sacrifié sur l’autel nihiliste d’une volonté d’impuissance.