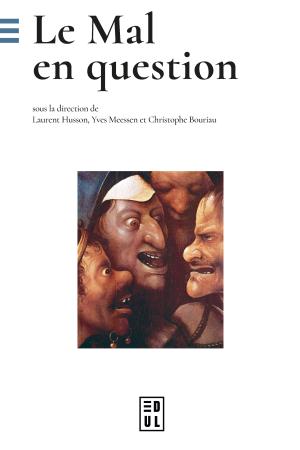
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon » (Gn, 1 : 311). Cette affirmation de principe, inaugurale en quelque sorte, de toute la Bible, soulève inévitablement la question du mal et de sa présence dans le monde tel que celui-ci se donne à expérimenter concrètement. L’approche de ce questionnement à l’occasion de cette contribution sera théologique, s’inscrivant dans la tradition de la théologie chrétienne latine. L’angle adopté sera celui de l’observation des discours, ou des genres littéraires mis en œuvre pour traiter la question du mal, et plus précisément la question du diable comme réponse théologique à la question du mal. Tout comme on a pu l’observer en philosophie, le questionnement théologique ne peut se dispenser de deux approches : d’un côté, une approche par le mythos, et de l’autre côté, une approche par le logos. Dans la mesure où les deux approches co-existent dans les discours théologiques, on peut en déduire d’emblée qu’aucune d’entre elles n’épuise la question du mal et du diable, encore faut-il en examiner la validité, les limites, les contradictions éventuelles ou les articulations. Du côté du logos, on ne manquera pas de rencontrer la pensée sur le mal de Thomas d’Aquin et la question de la théodicée. Du côté du mythos, ce sont un certain nombre de textes bibliques qu’il s’agira d’interpréter, compte tenu d’études de référence en matière de « mythes ».
La Somme théologique2 de Thomas d’Aquin est un modèle de système théologique selon le logos. Aux questions 48 et 49 de la prima pars, il commence par traiter la question du bien et du mal (comme privation du bien) selon Aristote. Il y distingue le mal selon deux modalités : le « mal de peine », une privation de bien en tant qu’état de fait, et le « mal de faute », une action par laquelle un esprit doté du libre-arbitre décide le mal3. Aux questions 50 à 64, Thomas d’Aquin traite de la création des anges, et spécifiquement de l’apparition des mauvais anges, aux questions 63 et 64. Leur existence est rapportée au « mal de faute » uniquement, car Dieu ne peut décider de créer des êtres mauvais4. Il attribue la déchéance de certains anges à l’orgueil :
Une nature spirituelle, en effet, ne s’attache pas aux biens proprement corporels, mais aux biens qui peuvent se trouver dans les réalités spirituelles ; car on ne désire que ce qui peut convenir de quelque manière à sa propre nature. Or, il n’y a péché à s’attacher aux biens spirituels que si on le fait sans tenir compte de la règle établie par le supérieur. Et c’est un péché d’orgueil de ne pas se soumettre à son supérieur lorsqu’on le doit. C’est pourquoi le premier péché de l’ange ne peut être qu’un péché d’orgueil5.
À l’article suivant, il précise que le péché des anges consiste en l’aspiration à la béatitude par ses propres forces : « l’ange a désiré posséder sa béatitude dernière par ses propres forces, ce qui n’appartient qu’à Dieu »6. Et l’auteur d’établir que le diable doit être l’ange le plus « élevé » initialement7 et qu’il est à l’origine de la chute de tous les autres démons8. Aux questions 108 et 109 de la première partie, il reprend des perspectives patristiques, principalement le pseudo-Denys et Grégoire le Grand, sur les hiérarchies et ordres angéliques ainsi que l’organisation des mauvais anges.
On peut remarquer que Thomas d’Aquin se situe, dans toutes ces démonstrations, dans l’optique de la théologie de la création, et c’est la pensée aristotélicienne sur le bien qui sert de structure fondamentale à sa pensée théologique, conformément à la méthodologie qui traverse toute la Somme. En ce qui concerne l’origine du mal, il affirme que le bien peut être « sujet du mal », en tant que le mal se définit comme un « défaut de bien »9 et que, pour la même raison, Dieu peut être à l’origine du mal, mais uniquement du « mal de peine »10. Théologiquement parlant, donc, on voit pourquoi Karl Lehmann fait remarquer que pour Thomas d’Aquin, le diable n’est pas la seule réponse à la question du mal11. Toutefois, on peut percevoir aussi qu’il s’agit pour lui de démontrer que Dieu, tout en étant le Souverain Bien et l’unique Créateur, ne peut avoir créé le mal, le diable et les mauvais anges, comme tels. La pensée philosophique est mise au service d’une réflexion dont une problématique de fond procède de la théodicée.
Question incontournable lorsqu’il y va du mal, on connaît la solution de compromis proposée par Leibniz pour articuler l’existence du mal avec l’affirmation conjointe de la bonté et de la toute-puissance de Dieu12 : le monde tel qu’il existe est le meilleur monde possible en tant que monde contingent13. On peut remarquer que pour Leibniz, le mal est de trois ordres : métaphysique, physique et moral14 et que, si l’être humain commet le mal, c’est en raison de sa finitude et parce que Dieu le permet15. Focalisé sur l’affirmation de la sagesse et de l’infaillibilité de Dieu, Leibniz ne retient pas l’explication du mal par le diable, si bien qu’il ne l’évoque qu’incidemment, comme par impossibilité de nier des affirmations traditionnelles.
Le mensonge ou la méchanceté vient de ce qui est propre au diable, ek tôn idiôn, de sa volonté, parce qu’il était écrit dans le livre des vérités éternelles, que contient encore les possibles avant tout décret de Dieu, que cette créature se tournerait librement au mal, si elle était créée. Il en est de même d’Ève et d’Adam ; ils ont péché librement, quoique le diable les ait séduits16.
Dans son travail de thèse17, Jean-Pierre Batut a analysé le thème de la « toute-puissance » du Père (Pantocrator) dans la tradition pré-nicéenne et la réception patristique des textes bibliques qui figurent la puissance de Dieu. Il a montré que ce thème de la toute-puissance de Dieu était compris par les Pères comme ressortissant de la théologie du salut. Il ne désigne pas une omnipotence absolue, purement et simplement, mais la capacité et la volonté de Dieu de déployer sa puissance en faisant appel à des envoyés, à l’instar de Moïse pour la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte. Même un texte comme le déluge (Gn, 6), qui se prêterait spontanément à une lecture selon les catégories de la justice dans le déploiement d’une puissance vengeresse sur le péché, est à prendre comme un texte de salut, puisque Dieu orchestre une poursuite de son œuvre créée et non sa destruction, en passant par la vie et l’action du juste Noé qui récapitule dans l’arche toute cette création et lui ouvre une postérité. La même logique se retrouve dans l’œuvre du salut reconnue comme accomplie par le Christ, à qui, selon le quatrième évangile, « le Père a tout remis entre les mains » (Jn, 3 : 35), qui est à l’œuvre sans cesse, en alliance avec l’œuvre du Fils (Jn, 5 :17).
Il apparaît dans tout ce qui précède que c’est à partir du salut qu’il convient de considérer le mal et non l’inverse. […] Dans l’acception de la toute-puissance que recouvre le mot pantocrator, cela relève en particulier de l’histoire du salut : le titre divin pantocrator désigne en effet non pas une toute-puissance absolue (à quoi tend la traduction latine omnipotens à laquelle se réfère Ambroise), mais la souveraineté de Dieu sur l’univers et singulièrement sur l’histoire. Mais si Dieu est le Seigneur de l’histoire, c’est comme on l’a vu à travers des libertés qu’il exerce cette seigneurie […].
C’est ainsi que l’on peut soutenir sans paradoxe que le Père est d’autant plus tout puissant sur le monde et son histoire que sa puissance peut passer à l’acte à l’intérieur de ce monde, ce qui ne peut advenir que par l’engagement de libertés créées18.
Cette perspective situe la différence d’approche entre Leibniz et cette théologie patristique. À observer la théodicée, on s’aperçoit que l’ouvrage se situe presque exclusivement dans une perspective de théologie de la création. Même s’il évoque le salut par l’Incarnation19, il reste fasciné par une figure divine absolue dans son omniscience et son omnipotence, ce qui laisse de côté que la création puisse être traversée par une dynamique de renouvellement complet tel que le suggère le Nouveau Testament avec le thème du Règne de Dieu, et l’épître aux Romains en particulier (voir Rm, 8 : 18-27), fondé sur un amour plus que sur une démonstration de puissance. Le Dieu de Leibniz est-il le Dieu d’un philosophe qui s’exprimerait dans des catégories culturellement chrétiennes, mais théologiquement très pauvres ? À moins qu’il ne soit un reflet de la théologique néoscolastique de son temps dont il n’est pas certain qu’elle ait elle-même donné à la sotériologie toute l’importance qu’elle a eue dans la tradition chrétienne primitive.
Si, par ailleurs, on estime que la conception d’un Dieu qui est amour est le propre de la révélation judéo-chrétienne, cela met en exergue une ambivalence de cette problématisation de la théodicée. Si elle est située dans une perspective philosophique, elle est mise au défi de justifier philosophiquement l’adoption d’une affirmation selon laquelle Dieu est bon, avant de l’opposer à l’affirmation de sa toute-puissance et l’existence du mal, car la bonté de Dieu est une notion spécifiquement théologique. Si l’on se situe en théologie chrétienne en considérant que la bonté de Dieu est un acquis, la question de la théodicée ne peut être pensée autrement que dans la perspective du salut tel que formulé dans ce contexte, ce qui impose d’intégrer la perspective d’un Dieu lui-même engagé dans une lutte contre le mal20, dont l’origine n’est attribuée par principe ni à Dieu ni à l’humanité, mais à un tiers. S’ouvre ainsi une série de problématiques ultérieures qui renvoient notamment au mythos.
L’approche d’une question par le mythos est explicative, sous la forme d’une causalité narrativisée. Elle ne se soucie pas de la plausibilité empirique d’une narration, mais institue le sujet qui reçoit la narration dans la condition humaine – dont il fait, lui, l’expérience empirique – par un recours à des origines supposées de cette condition humaine. C’est en ce sens que l’on fait mémoire des études de Mircea Eliade sur le mythe21, dont il faut remarquer qu’elles concernent des cultures qui n’ont pas développé un discours rationnel sur la condition humaine et ses modalités. Tout autre est le contexte de l’Antiquité grecque dès lors qu’elle s’est attachée à penser les relations entre logos et mythos, comme le montre Luc Brisson22.
Les textes bibliques où figure le diable entrent assez exactement dans ce genre littéraire et mettent la pensée théologique du christianisme au défi de déterminer ses critères de réception de ces textes.
En matière de démonologie, la Bible chrétienne est assez diserte. Elle s’ouvre avec le récit emblématique du serpent qui pousse à la transgression Adam et Ève (Gn, 3) et se termine au livre de l’Apocalypse sur une récapitulation et une concentration en un seul être de toutes les figures diaboliques qui ont été évoquées de façon éparse :
Il fut précipité, le grand dragon, l’antique serpent celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. [Ap, 12 : 9]
Cette convergence entre une protologie et une eschatologie est une des caractéristiques du mythe, dont la perspective linéaire et non plus cyclique est relevée par M. Eliade comme une spécificité judéo-chrétienne23. Toute la démonologie élaborée à l’époque patristique se fonde en grande partie sur ce passage de l’Apocalypse, qui permet de relier entre eux des passages assez hétéroclites : le serpent du livre de la Genèse, le Satan du livre de Job, habilité par Dieu à nuire à Job pour le mettre à l’épreuve, le Satan qui, dans une vision, se tient à côté de Josué pour l’accuser devant Dieu, au livre de Zacharie (3, 1-3). En écho à cette vision, il est appelé « l’accusateur de nos frères » (Ap, 12 : 10). Au diable est attribuée la jalousie au livre de la Sagesse (2, 24), raison pour laquelle il est considéré comme ennemi de l’humanité, et du livre d’Isaïe on a tiré le nom de Lucifer, en lui attribuant un passage qui déplore la chute de roi de Babylone : « Comment es-tu tombé du ciel, Astre brillant, Fils de l’Aurore ? […] tu as dû descendre dans le séjour des morts, au plus profond de la Fosse » (Is, 14 : 12-15). Dans le Nouveau Testament, il se présente comme l’ennemi du Christ en premier lieu dans les récits de tentations après le baptême (Lc, 4 : 1-13), pièges dans lesquels le Christ ne tombe pas, et sur qui la victoire du Christ se manifestera par les exorcismes (Lc, 4 : 31-37). Ceux-ci deviennent un lieu de polémique entre Jésus et ses détracteurs, qui attribuent l’efficacité de ses exorcismes à la puissance du diable, appelé Beelzéboul (Mc, 3 : 22), Bélial (2 Co, 6 : 15) ou Mammon (Mt, 6 : 24).
La réalité d’une lutte contre le diable et les esprits mauvais est donc présente dans le Nouveau Testament, en particulier dans le genre apocalyptique, comme on le voit en Éphésiens :
Revêtez l’armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n’est pas à l’homme que nous sommes affrontés, mais aux Autorités, aux Pouvoirs, aux Dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. [Ep, 6 : 11-12]
Un tel passage pourra fonder les considérations patristiques sur les « armées » d’esprits mauvais, du diable et sur les critères du discernement de leur action. Le caractère trompeur du diable est évoqué dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens : « Satan lui-même se camoufle en ange de lumière » (2 Co, 11 : 14). On retrouve la tonalité du combat dans la première épître de Pierre (1 P, 5 : 8-10) qui le compare à un fauve tapi en embuscade, dans la première épître de Jean (1 Jn, 3 : 8) ou encore l’épître de Jacques (4, 7).
Pour André Wénin, la stratégie essentielle du serpent de la Genèse consiste à s’interposer (dia-ballein) entre Dieu et son peuple, avec lequel il a voulu conclure une alliance en suscitant sa convoitise, c’est-à-dire en exacerbant son désir pour qu’il s’affranchisse de toute Loi, celle-ci étant garante de la nécessaire modération du désir pour que des relations en altérité puissent avoir lieu. La convoitise, comme immodération du désir, conduit donc à la transgression de la Loi et ce faisant à des relations mortifères24. C’est également l’interprétation que l’on retrouve au chapitre 7 de l’épître aux Romains, qui décrit le péché comme une convoitise (Rm, 7 : 7-13)25. La convoitise, comme désir immodéré ou « désir de totalité »,26 implique donc un refus d’être une créature. Telle est l’origine de l’idolâtrie condamnée par les textes bibliques : une projection de soi,
un simulacre de relation avec le divin où l’homme n’a, en fait, de relation qu’avec lui-même, avec ses angoisses et ses désirs auxquels il croit pourtant se soustraire – ce en quoi il s’abuse lui-même27.
On note à ce propos que « le péché », au singulier, peut être entendu chez Paul comme un synonyme du diable, présenté ici comme une sorte de force à l’œuvre dans la création, qui cherche à la déconstruire en rendant l’humain incapable d’une cohérence entre le bien qu’il connaît et le mal qu’il pratique (voir Rm, 7 : 8-23).
Les développements angélologiques et démonologiques ultérieurs seront en grande partie ancrés dans le style apocalyptique que l’on trouve aux livres bibliques de Zacharie, Ézéchiel ou Daniel et dans la littérature intertestamentaire. A. Wénin signale le livre des Jubilés, les livres d’Hénoch, le Règlement de la guerre, de Qumrân, le Testament de Lévi28.
Influencées fortement par le néo-platonisme, l’angélologie et la démonologie connaîtront de multiples développements à l’époque patristique, avec un apogée chez Origène (v. 185-v. 253) dans son Traité des origines et chez Augustin d’Hippone (354-430) dans la Genèse au sens littéral et LaCité de Dieu. C’est à partir de ces auteurs que la création des anges et la chute de certains sont situées au premier jour, celui de la création de la lumière29. C’est également Augustin qui attribue leur chute à un mouvement d’orgueil, puisque, pour lui, l’envie ou la convoitise est consécutive à l’orgueil30. À ces ouvrages il faut associer les enseignements sur le discernement des esprits que l’on trouve, par exemple, chez Évagre le Pontique (346-399) dans le Traité pratique ou l’Antirrhétique, ou Jean Cassien (v. 360-435), dans les Institutions cénobitiques ou les Conférences. Ces enseignements ont une portée pratique car destinés à structurer la vie spirituelle des moines en décrivant les « passions de l’âme » et l’action du tentateur sur ces passions pour le détourner de la foi et de l’accueil du salut et en proposant des démarches spirituelles en réponse à ces tentations, le tout constituant le « combat spirituel ».
Peut-on qualifier toute cette littérature, biblique et patristique, de « mythique » ? Ou en d’autres termes, l’appellation « mythe » est-elle justifiée pour désigner tout discours qui ne s’exprimerait pas dans les catégories de la conceptualité, du raisonnement et qui ne chercherait pas l’élaboration de systèmes explicatifs cohérents – en un mot, qui ne présenterait pas les caractéristiques du logos ? Pour notre propos, serait ainsi désigné tout discours qui figurerait l’action de Dieu, des anges, du diable et des démons, qui chercherait à rendre compte de l’origine du mal en dressant un portrait-robot du diable, et qui aurait en vue la communication de repères pour tout sujet qui reçoit ce discours. Sous cet angle, on pourrait répondre par la positive.
Reprenant les caractéristiques du mythe énoncées par M. Eliade, P. Gibert fait remarquer que le mythe fait fond sur l’impossibilité pour l’humain de mettre des mots rationnels sur ses origines, ce qui nécessite que l’on distingue les catégories de début, de commencement et d’origine (en lien avec celles de fondement et de fondation, de causes et de raisons) 31. Cependant, le fait précisément qu’un discours qui figure l’insaisissable des origines puisse ne pas être nécessairement un « récit de commencement » le porte à relativiser l’usage de la catégorie du mythe quant aux discours sur les origines32 :
En réalité, pas plus les origines que les commencements, les causes que les fondations n’exigent un genre littéraire qui serait reconnaissable comme tel. C’est dans le corps du texte, en général au début ou en introduction, que l’expression du commencement prend le plus souvent place, même si telle formule, tel procédé souligne l’objet « commencement ». D’autre part, certains textes, qui ne se proposent pas immédiatement comme traitant d’origines ou de commencements, peuvent, en un temps second, être sollicitables ou déterminables comme se rapportant au commencement ou à l’origine33.
Envisageons cette problématique à la lumière de l’étude de L. Brisson sur les mythes grecs. Il montre que les mythes grecs ont été « sauvés » du rejet pur et simple au nom de leur irrationalité, par deux types d’interprétations : celle de Platon et celle des Stoïciens. Pour Platon, et c’est la raison pour laquelle il éprouve le besoin d’en inventer, les mythes sont une autre expression de la philosophie, marquée par son utilité, non pas opposée, mais complémentaire même si à un rang de langage subalterne :
Même s’il est un discours invérifiable qui ne présente pas un caractère argumentatif, le mythe est investi d’une efficacité d’autant plus grande qu’il véhicule un savoir de base partagé par tous les membres d’une collectivité donnée, ce qui en fait un redoutable instrument de persuasion à portée universelle. […] le mythe joue un rôle de paradigme auquel, par le moyen non de l’enseignement, mais de la persuasion, sont amenés à se référer pour y conformer leur comportement, tous ceux qui ne sont pas philosophes, c’est-à-dire la majorité des êtres humains34.
Les Stoïciens, quant à eux, considèrent les mythes comme des allégories, mode d’interprétation qui se poursuivra jusqu’à l’époque moderne35. Celle-ci considère que les mythes parlent, sous couvert de récits impliquant les divinités, des modalités de la condition humaine. Alors que cette perspective se présente chez les philosophes comme une lecture areligieuse des mythes, elle a été investie par les théologiens du Moyen-Âge et de la Renaissance comme une manière de retrouver la présence d’éléments de la Révélation judéo-chrétienne dans les mythes grecs36.
De ce point de vue, qu’en est-il des récits démonologiques, si on les envisage du point de vue de la réception des textes mythiques ? Il ne manque pas de commentateurs qui suggèrent une lecture allégorique de ces textes, le démon représentant en part de soi des volontés de toute-puissance du lecteur. C’est le cas d’A. Wénin :
Cette figure [démoniaque] traduit, pour ainsi dire l’expérience du croyant qui, quand il a posé des choix qui l’éloignent de son Dieu, a le sentiment d’être victime de forces extérieures, qui l’y ont sournoisement poussé. D’où l’idée d’un être qui, jaloux de Dieu et de son accord avec les hommes, s’emploie à leur faire obstacle, à conduire à l’échec le projet de l’alliance, voire à faire mourir l’homme dont Dieu veut passionnément la vie37.
Dans le même sens, Alexandre Ganoczy (La Métaphore diabolique) ou Xavier-Léon Dufour (Que Diable !).
Une lecture plus classique reprendra aisément le point de vue de Platon sur les relations complémentaires entre logos et mythos, en considérant celui-ci comme une approche suggestive et efficace du mystère des origines du mal, approche dont l’« utilité » interdit en définitive une dépréciation. La préférence pour cette option de lecture tient au fait que le diable y est considéré comme un être « hypostatique » ou « parhypostatique »38. Adolphe Gesché parle à ce titre d’une « dogmatisation » de la question du mal puisque l’enjeu en est le destin de l’humanité39. On trouve une expression de cette perspective dans le Catéchisme de l’Église catholique (n. 391, en référence à Latran IV, DS 800). Que le diable soit présenté comme un serpent, un séducteur, etc. suggère un fonctionnement non pas allégorique, mais métaphorique des récits de type mythiques.
À entendre les réserves de P. Gibert on peut se dire que l’utilisation du mot « mythe » n’est certainement pas une cause absolue à défendre dans une discussion sur les catégories qui visent à rendre compte de l’existence du mal et de sa provenance. Chez M. Eliade, on trouve une présentation du mythe tel qu’il joue son rôle de vecteur de questions et de réponses existentielles dans des cultures où ces questions ne sont pas traitées par une réflexion conceptuelle. Avec L. Brisson, il devient clair que le mythe ne peut plus jouer ce rôle exclusivement, dès lors que l’on aborde les questions existentielles avec le logos. Inévitablement, le mythos demande à être réinterprété. Force est cependant de constater qu’en théologie chrétienne, les deux genres littéraires coexistent, notamment sur la question du diable, ce qui tendrait à montrer que chacun exprime des réalités que l’autre ne peut pas exprimer.
Dans le raisonnement d’Augustin sur la création et la chute des anges, on peut observer qu’il met en œuvre un raisonnement théologique particulier : l’apophatisme. Au chapitre IX du livre XI de LaCité de Dieu, il commence par exclure que les anges, d’après le premier chapitre de la Genèse, puissent avoir été créés un autre jour que celui de la création de la lumière. Il poursuit en démontrant qu’ils sont créés lumière :
Ainsi, donc, en aucune manière, et en aucun temps, les esprits que nous appelons anges n’ont commencé par être ténèbres ; mais, à l’instant même de leur création ils ont été lumière ; créés non pour être ou vivre simplement, mais encore illuminés pour vivre, sages et heureux. Plusieurs, se détournant de cette lumière, ont été déshérités de la vie, par excellence la vie sage et heureuse, qui n’est autre que la vie éternelle avec la confiance et la certitude de son éternité ; mais ils ont conservé la vie raisonnable, quoique déchue de la sagesse, et ils ne sauraient la perdre quand même ils le voudraient. […]
[Car] quelle que soit la durée de la vie, elle ne saurait être appelée éternelle, si elle doit avoir une fin. Or, c’est à la vie qui n’a point de fin qu’appartient le nom de vie éternelle. Ainsi, quoique le bonheur ne soit pas la conséquence nécessaire de l’éternité – le feu vengeur ne doit-il pas être éternel ? –, cependant si la véritable et parfaite béatitude a besoin de l’éternité, telle n’était pas la béatitude de ces anges, puisque, à leur insu ou non, elle ne devait pas être éternelle. S’ils le savaient, la crainte ; s’ils l’ignoraient, l’erreur ne leur permettait pas d’être heureux. Si leur ignorance, partagée entre l’incertitude et l’erreur, demeurait dans un parfait équilibre de doute sur la durée éternelle ou passagère de leur félicité, ce doute lui-même était incompatible avec cette pleine et souveraine béatitude que nous attribuons aux saints anges. Car nous ne resserrons pas cette expression de béatitude dans les termes d’une signification tellement restreinte que nous la réservions pour Dieu seul40.
Le raisonnement d’Augustin consiste en ce qu’il exclut les affirmations qui ne sont pas concevables, pour observer ce qu’il peut dire une fois celles-ci exclues. Cette démarche est celle de l’apophatisme : une succession d’affirmations et de négations qui dépendent les unes des autres. Puisqu’il n’est pas pensable que les anges soient ténèbres, ils sont lumière ; puisqu’il n’est pas pensable qu’ils soient incertains ou qu’ils se trompent sur leur bonheur, il faut en conclure qu’ils étaient dans la confiance et la certitude de leur bonheur... Même si l’on peut penser qu’il y a une part de rhétorique dans ces développements, on peut aussi considérer que par sa réflexion, portant sur des réalités non attestées comme telles par les textes – dans les récits de création –, Augustin cherche ce qu’il peut en dire après avoir écarté ce qui n’est pas plausible et cohérent avec les affirmations explicites des Écritures et du cadre dogmatique du christianisme.
Une démarche analogue a été empruntée par Joseph Ratzinger dans un article concernant l’identité du diable, où il se demande s’il faut le considérer comme une « personne ». Compte tenu de la manière dont on définit traditionnellement la personne dans l’anthropologie théologique du christianisme, il estime que l’appellation « personne » est problématique, dans la mesure où l’action du diable est plutôt « dépersonnalisante ». Par conséquent, il suggère de le considérer comme une Un-Person : une « non-personne »41.
On peut remarquer qu’une telle démarche ne consiste pas purement et simplement en une succession de propositions négatives, mais une succession de propositions tout à tour affirmatives et négatives, les unes se renvoyant aux autres. C’est ainsi qu’Olivier Boulnois présente la démarche apophatique :
Le dernier mot de la théologie n’est ni l’affirmation, ni la négation, car il n’y a pas d’antériorité de l’une sur l’autre. Il revient à l’éminence absolue de Dieu, qui dépasse affirmation et négation en les renvoyant dos à dos. L’expression « théologie négative », souvent utilisée pour désigner cette méthode, est donc impropre. Elle n’a d’ailleurs aucun fondement textuel. Pour Denys, la « théologie affirmative » (terme qu’il emploie) et la théologie négative (terme qu’il n’emploie pas) désignent des clés herméneutiques, des manières de déchiffrer l’Écriture sainte, mais aucun de ces termes ne caractérise sa méthode dans son ensemble. Ainsi, les noms ne nous conduisent pas à la connaissance, mais au dépassement de toute connaissance, à « l’inconnaissance » de Dieu 57. Plutôt que « théologie négative », il faudrait la nommer « théologie de la transcendance »42.
Même si dans le sillage du pseudo Denys l’Aréopagite, il est davantage coutumier de pratiquer l’apophatisme pour suggérer la transcendance ineffable de Dieu, il n’est pas impossible de reconstituer un raisonnement apophatique qui pourrait représenter l’approche par le logos de ce qu’exprime par ailleurs le mythos. Ainsi, puisque tout manichéisme est exclu de la foi judéo-chrétienne, le Dieu unique ne peut être que le Créateur de tout ce qui existe en dehors de lui (voir Gn, 1-2). Puisqu’il est bon, et que cette bonté ne peut être mise en question, tout ce qui est créé par lui est bon : les créatures incarnées et les créatures non-incarnées (voir les passages de l’Écriture qui parlent d’« anges »). Par principe, ni Dieu ni l’humain ne sont à l’origine du mal (c’est ce que signifie l’intervention du serpent en Gn, 3) ; c’est donc qu’il doit être rapporté à une créature tierce, nécessairement spirituelle, car elle doit être capable de liberté. S’il s’agit d’une créature, elle doit être pensée comme créée bonne, si bien que sa négativité ne peut pas être attribuée à la volonté de Dieu, mais uniquement à son initiative de se couper de Dieu, donc à une « chute ». Et selon les interprétations, cette chute sera attribuée soit à la jalousie par rapport à l’humanité, soit à l’orgueil. En poussant plus loin, on pourra dire qu’une coupure par rapport à l’amour de Dieu fait de lui un être intelligent, mais sans amour, cherchant la division entre l’humanité et Dieu et mettant en œuvre des stratégies de séduction, comme celle de Gn, 3 et celles des tentations du Christ.
À supposer que ce raisonnement soit accepté comme représentatif de la foi, sa réception ne pourra pas ne pas tenir compte du fait qu’il est le produit d’une démarche apophatique, ce qui, du point de vue des affirmations qui constituent la foi chrétienne ne lui confère pas le même statut que les raisonnements « immédiatement affirmatifs » comme « Jésus est ressuscité », ou « Jésus est Fils de Dieu ».
Déjà évoquée plus haut, la thématique du discernement des esprits traverse toute la spiritualité chrétienne, orientale et occidentale, patristique, médiévale et moderne, de manière privilégiée dans la vie monastique. Elle a donné lieu à un genre littéraire où on peut reconnaître à la fois des éléments du discours théologique – des affirmations théologiques, anthropologiques et spirituelles qui constituent la foi chrétienne et qui se situent sur le registre du logos – dans une expression narrativisée qui s’apparente au mythos. La métaphore la plus utilisée est celle du « combat spirituel », estimant que le sujet croyant qui désire approfondir sa vie spirituelle est aux prises avec un ou des ennemis : des forces résistantes ou esprits, qui veulent l’en détourner, au premier rang desquelles, le diable, qui cherchent à « actionner » les « passions de l’âme ». Le terrain de ce combat est le monde des pensées, au sens où elles président aux décisions du sujet, qui se trouve dans la condition décrite en Rm, 7. Une des pratiques monastiques fondamentales sera donc d’observer les pensées afin de déterminer quelle est leur origine et de réagir en conséquence.
On peut remarquer une forme d’ambivalence dans l’usage du mot « esprits » : tout à tour, il peut désigner des entités spirituelles extérieures à l’être humain, dont il est dit qu’elles désirent l’influencer, tantôt il est question de « l’état d’esprit » et des dispositions intérieures du sujet.
À titre d’exemple, on peut citer Ignace de Loyola, dont les Exercices spirituels sont une sorte d’entraînement à la pratique du discernement :
Je présuppose qu’il y a en moi trois sortes de pensées : l’une qui m’est propre, qui naît de ma seule liberté et de mon seul vouloir ; et deux autres qui viennent du dehors, l’une qui vient du bon esprit et l’autre du mauvais43.
Dans la ligne ignacienne et patristique, on peut évoquer l’ouvrage de Jean-Baptiste Scaramelli (1688-1752), contemporain, à une génération près, de Leibniz, dont est publiée en 1753 une synthèse sur le discernement des esprits, à usage des « directeurs des âmes » :
Ici, nous entendons par esprits une impulsion, un mouvement ou une inclination intérieure de notre âme vers quelque chose qui, quant à l’entendement, est vrai ou faux, et quant à la volonté est bon ou mauvais. Ainsi, si quelqu’un est porté à mentir, nous disons qu’il a l’esprit de mensonge ; s’il est porté intérieurement à mortifier son corps, nous disons qu’il a l’esprit de pénitence ; s’il est incliné à s’élever au-dessus des autres, nous disons qu’il a l’esprit d’orgueil ; s’il est dominé par une certaine envie de paraître bon, beau, spirituel aux yeux du public, nous disons qu’il a l’esprit de vanité ou de vaine gloire. Or, cette impulsion interne vers des choses tantôt vicieuses ou vertueuses, tantôt fausses ou véritables, consiste en deux actes dont l’un appartient à l’intelligence : c’est celui par lequel nous nous sentons inclinés à croire ou à rejeter ce qui est vrai ou faux ; l’autre appartient à la volonté et nous porte à embrasser ou à repousser ce qui est bon ou mauvais. C’est ce mouvement de la volonté que nous appelons esprits44.
On devine dans ce passage la forte composante anthropologique de cette littérature. L’enjeu de cet examen de la « teneur » spirituelle des pensées est celui de l’accueil et de l’incarnation de l’œuvre du salut accomplie, selon la pensée chrétienne, par le Christ et transmise par l’Esprit-Saint. C’est à cette dimension que fait référence ici le qualificatif « spirituel », et en ce sens, l’orientation de cette réflexion est pratique, c’est-à-dire orientée vers une prise de décisions ajustées et cohérentes avec le salut.
Une certaine dimension mythique est repérable par le fait que cette démarche est une recherche de l’origine d’emblée cachée des pensées et dans l’expression narrativisée de l’action des esprits sur la personne. On pourrait citer dans les Exercices d’Ignace de Loyola, la Méditation des deux étendards ou encore, parmi les règles du discernement, la 14e règle :
Il [l’ennemi] se comporte également comme un chef de guerre voulant vaincre et dérober ce qu’il désire. En effet, un capitaine et chef d’armée en campagne, après avoir établi son camp et examiné les forces ou le dispositif d’un château, l’attaque par l’endroit le plus faible. De même, l’ennemi de la nature humaine fait sa ronde, examine en particulier chacune de nos vertus théologales, cardinales et morales ; et c’est là où il nous trouve plus faibles et plus démunis pour notre salut éternel, qu’il nous attaque et essaie de nous prendre45.
Cette manière de présenter les enjeux de la vie spirituelle confine à un usage métaphorique du discours mythique, de même que l’ambivalence entretenue autour de la notion d’« esprit », comme entité extérieure cherchant à exercer une influence, ou inclination de l’intériorité du sujet. Il reste que de tels textes « fonctionnent » pour le sujet croyant, selon l’efficacité des mythes, lorsqu’ils instituent un sujet dans sa propre existence au sein d’une culture et de son histoire – ici, dans une tradition spirituelle. Elle lui inspirera une forme de « sagesse pratique », en fournissant à sa réflexion sur son agir un cadre au plan spirituel. Le présupposé est que le sujet soit engagé dans un cheminement spirituel au nom de sa foi, sinon cette critériologie narrative ne lui semblera d’aucune pertinence. On pourrait donc considérer que cette littérature du « discernement des esprits » est une manière d’articuler logos et mythos dans une approche de la spiritualité chrétienne avec ce qu’elle comporte d’affrontement de la question et de la réalité du mal. Elle ne s’identifie complètement ni à l’une ni à l’autre, tout en reposant sur la première et en offrant des traits de la seconde. Son efficacité est conditionnée à l’investissement du sujet qui la reçoit dans un chemin spirituel.
Sur le plan théologique, il apparaît clairement qu’une question comme celle du mal ou du diable ne peut être traitée de façon exhaustive par une seule forme de raisonnement ou un seul genre littéraire. Tout se passe comme s’il était inévitable que subsiste une coexistence irréductible de discours qui émargent à la catégorie du logos, et d’autres qui présentent les caractéristiques du mythos. Au sein même de ces catégories, des approches diversifiées comme une approche systématique (comme celle de Thomas d’Aquin ou celle de Leibniz) ou une approche apophatique, d’un côté, tout comme, de l’autre côté une interprétation allégorique ou métaphorique, suggèrent que l’on est en présence de réalités qu’il n’est possible d’aborder que médiatement. Identifier et différencier ces approches permet sans doute de garder la distance suffisante avec chacune, individuellement, pour ne pas les surinterpréter, mais pour recevoir ce qu’elles peuvent dire et figurer, tout en gardant à l’esprit de façon systémique les apports possibles des autres approches.