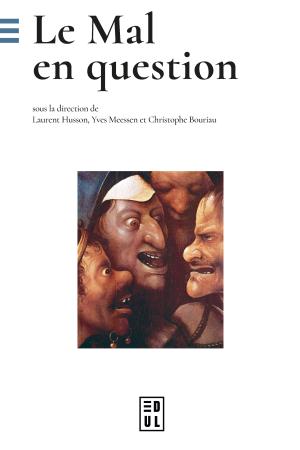
L’usage de Jean-Paul Sartre par Eugen Drewermann dans Le Mal
Dans le tome 3 de son ouvrage Le Mal, consacré à l’exégèse du récit yahviste des origines, Eugen Drewermann donne une place particulière à la philosophie de Jean-Paul Sartre et plus précisément à L’Être et le néant et à la Critique de la raison dialectique1. L’auteur y voit un instrument fondamental pour analyser la logique conduisant au mal l’homme pécheur, notamment dans les convergences entre les données de Gn, 2-11 et les analyses de Sartre. Cependant, Sartre, même s’il annonce à la fin de L’Être et le néant une morale et s’il repère dans son ontologie des points de départ pour celle-ci, sépare nettement les deux domaines. Si nous ajoutons que, pour lui, la question du Mal ne se pose ni au niveau métaphysique ni au niveau ontologique, mais implique une concrétude sociale et notamment un Bien social2, la question qui se pose est celle de la portée et des limites de l’usage de l’ontologie et de l’anthropologie sartrienne aussi bien en elle-même que dans leur articulation avec les autres sources de la pensée sartrienne convoquée par Drewermann3. Comment ce dernier intègre-t-il l’ontologie sartrienne à ses réflexions propres ? Que veut dire cette intégration ? L’ontologie de Sartre est-elle une théorie du mal qui s’ignore ? Et, in fine, que peut faire la théologie à la philosophie ?
Le grand ouvrage de Drewermann, Le Mal : Structures et permanence, se présente comme une interprétation à la fois exégétique (tome 1), psychanalytique (tome 2) et philosophique (tome 3) du récit yahviste.
L’approche exégétique du tome 1 a pour vue l’établissement du sens du texte pris dans sa lettre. Au travers de la diversité des ressources mobilisées et de l’établissement du sens et du séquençage de celui-ci, elle fait poindre la nécessité d’une intériorisation plus profonde derrière ce qui demeure une structure statique donnant un objet (la peur devant Dieu), mais pas le mouvement de cet objet. Le tome 2 mobilise l’interprétation psychanalytique. Il dégage une dynamique interne et permet donc une totalisation plus profonde. Cependant, celle-ci reste marquée du sceau de la nécessité et elle ne permet pas de comprendre la dimension de choix du péché.
La tâche du tome 3 est d’« établir philosophiquement comment ce en quoi la psychanalyse ne voyait que pure destinée régie par des influences extérieures […] résulte d’un acte de liberté originelle »4. La dimension philosophique, enfin, donne un sens à ce péché, mais elle commence par le faire – Kant et Hegel sont notamment visés – au prix d’une référence à un absolu qui vient en absorber le sens comme moment d’une totalité faite et à venir. Le sens ou le tout sont présupposés et la liberté est convertie en nécessité. L’apport spécifique de Sartre serait, selon Drewermann, de s’en tenir à la liberté humaine. Elle permettrait une approche au plus près de l’exercice de celle-ci et de maintenir ce faisant, dans l’irréconciliation et dans la tension, l’existence présente de l’homme. Cet apport représente en même temps sa limite et, de manière plus générale, la limite de la philosophie elle-même, dans son incapacité à rendre compte véritablement du sens du drame de l’existence humaine et de l’impossibilité à la dépasser comme le confirment, selon Drewermann, les œuvres dramatiques de Sartre.
De fait, l’examen de l’analyse sartrienne – le plus long par rapport à ceux consacrés à Kant, Hegel et Kierkegaard – vise à montrer comment une liberté sans Dieu ne libère pas de la névrose suscitée par l’angoisse contrairement aux « promesses de l’athéisme »5 philosophique, mais laisse l’homme aux prises avec la « passion inutile »6 qui l’anime. Ce qu’écrit Sartre est donc une « ontologie phénoménologique du péché, capable de décrire une existence qui est de soi coupable, du simple fait que, sous un surcroît d’angoisse, elle exclut Dieu en se rapportant purement à elle-même et […] qu’elle ne fait que transformer en murs les structures de sa contingence »7.
L’analyse de Sartre est ainsi un instrument de relecture de la Genèse qui dégagerait dans sa radicalité et son irrémédiabilité le chemin de la créature humaine vers le mal à partir du péché comme peur de Dieu (issue de l’expérience de l’angoisse de l’humaine créature face à l’interdit divin). La confrontation se déroule en deux moments : le premier est celui de la mise en rapport des analyses de L’Être et le néant et de Gn, 2-5. Le second est celui de la mise en rapport des analyses de la Critique de la raison dialectique et de la corruption universelle de l’humanité en Gn, 6- 11. Pour chacun de ces deux temps, Drewermann propose en premier lieu un exposé de la philosophie de Sartre selon une logique interne8 puis, dans un deuxième temps, rapporte les données ainsi obtenues à sa problématique. Au sein de l’examen de la première partie, deux points sont dégagés par l’auteur. Le premier – rapporté au récit de la chute (Gn, 2-3)9 – concerne principalement le surgissement du pour-soi, l’analyse de l’intra-structure de la conscience, sa présence au monde et le désir d’être Dieu. Le second concerne la dimension de l’être pour-autrui et la question de l’aliénation. Ce dernier aspect est rapproché, quant à lui, de Gn, 4 : 4-6. Drewermann suit dans cette articulation aussi bien le texte biblique que le texte de Sartre, au sein duquel la considération de l’être pour-autrui occupe une place majeure.
Ce point est envisagé à partir de la définition du pour-soi, telle qu’elle se donne chez Sartre à partir de l’examen de la présence à soi et comme résultant hypothétiquement (c’est une hypothèse métaphysique – au sens où Sartre entend ce terme – et non un donné phénoménologique) d’un effort de l’être pour se fonder10. Pour Drewermann, qui rapproche ici Sartre de Hegel11, ce premier moment correspond à la chute de Dieu et la liberté humaine qui en découle comme résultant de cette chute. Ce premier point est, pour le théologien allemand signe à la fois de la portée de la description sartrienne et en même temps marque de sa limite : signe de la portée de sa description en ce que nous nous situons bien après la chute, mais signe de sa limite en ce que, dans la description du yahviste, la liberté est antérieure à la chute. Dès lors, l’ensemble des caractères déployés dans L’Être et le néant au titre des « structures immédiates du pour soi »12 et leurs déclinaisons dans le reste de l’ouvrage présentent les caractères qui sont précisément ceux des conséquences du péché et non des phénomènes de structures : le manque, l’angoisse, la nausée comme nausée devant soi et devant les choses, puis enfin la mort.
On peut ici envisager cette reprise selon deux registres : d’une part, ce qui relève chez Sartre de la facticité et qui est ce à partir de quoi le pour-soi est présence contingente au monde et dont la nausée est révélation, aussi bien par rapport à soi que par rapport au monde ; d’autre part, ce qui renvoie à la logique de l’ipséité : le manque à être qui se dévoile à partir de l’expérience de la facticité et l’ensemble des structures du pour-soi et à partir de soi se constitue ce que Sartre appelle le circuit de l’ipséité13. La circularité infinie constituée par le rapport à soi du pour-soi déployée dans les possibles et la temporalité sont aimantés par la vaine recherche de la réalisation de soi comme en-soi-pour-soi (Sartre ne dit pas, à ce premier niveau de l’analyse, qu’il s’agit de Dieu, mais seulement d’un idéal d’être qui hante le pour-soi et qui ne peut ici être identifié à Dieu comme autre que l’homme). Le circuit de l’ipséité est ce qui, chez Sartre, ferait que serait interdite « toute perspective de ne jamais parvenir à sortir du ghetto de la conscience, de l’Être pour soi, pour en revenir à l’unité hégélienne de l’en-soi-pour-soi »14.
Selon cette approche, la source du mal est au cœur de l’être même du pour-soi, sa source première (on verra qu’il y en a une autre) et celle du développement de sa structure. Sartre ferait une description ontologique sous condition théologique du péché, ce dont il ne s’aperçoit pas en raison de son athéisme, mais qu’il réussit à décrire en raison de sa lucidité. La conséquence – que Drewermann illustre notamment par les références à ces œuvres littéraires – en est justement la manière dont Sartre renvoie à un certain nombre de sentiments (la nausée, l’angoisse et le pathos de la condamnation à la liberté15) et déploie un monde qu’il décrit d’ailleurs lui-même comme l’enfer.
Il y a effectivement chez Sartre de quoi nourrir une telle vision, notamment dans la manière dont il reprend des schèmes théologiques pour les réintégrer dans son ontologie ainsi que dans la manière de rattacher pour partie son projet intellectuel à un athéisme clairement affirmé. Cependant, en ce qui concerne l’œuvre philosophique, il importe – et cela contre certaines expressions sartriennes – d’être rigoureux quant aux parallèles ainsi instaurés et de restaurer la logique propre de l’ontologie sartrienne. En premier lieu, sur le plan méthodologique, le rabattement de l’œuvre littéraire sur l’œuvre philosophique n’est pas simple et ne relève pas de la pure illustration. D’une part, les registres d’écritures demeurent différents et obéissent à d’autres logiques que celles de l’expression philosophique. D’autre part, au sein même de l’œuvre de Sartre, il y a une évolution incessante16.
Cependant, la manière dont Drewermann assimile le passage de l’en-soi au pour-soi chez Sartre à la dialectique hégélienne (que Sartre semble certes s’approprier, mais de manière encore rudimentaire au moment de l’écriture de L’Être et le néant) – et sur lequel il fonde la lecture sartrienne de la liberté comme fruit de la chute – est contestable. En effet, la détermination de l’en-soi n’y a pas du tout la même fonction que chez Hegel et le parallèle fait par Drewermann17 doit être reconsidéré. L’en-soi, chez Sartre, est la détermination première pour qu’on puisse parler d’être, pour que quelque chose, quelle qu'elle soit, puisse être dit être et non être dissous dans la subjectivité. C’est le fondement du réalisme de Sartre, fondement qu’il tire d’une analytique de l’intentionnalité18. La détermination du pour-soi à partir de l’en-soi tire sa légitimité d’abord d’une logique méthodologique (on est au bout d’une démarche régressive) et de la capacité de penser le rapport possible entre la détermination de l’être et celle de la conscience. Ce qui est ici en cause est moins la chute que la création, le néant pouvant être pensé et relié à l’être en tant qu’il est, selon les mots de Sartre, son « unique possibilité »19. Si on veut rapporter l’événement absolu du surgissement du pour-soi de schèmes théologiques, c’est plus à la question de la création qu’à celle de la chute qu’il faut se rapporter, et cela à deux titres : le premier est celui de l’impossibilité ontologique de toute pensée de la création à partir de l’en-soi seul ; le second est la spécificité de la création humaine comme création de ce qui est20. De même, les structures telles que la facticité et l’ipséité d’abord à rapporter à ce qu’elles rendent possible et pensable, à savoir l’émergence du monde lui-même.
Il faut donc distinguer le dégagement des structures ontologiques et ses conditions du questionnement métaphysique d’une unité de l’en-soi et du pour-soi au travers des structures et projets du pour-soi. Or, les descriptions sartriennes sont à la croisée de ces deux logiques, ce qui peut expliquer qu’on soit dans une ontologie, mais que cette ontologie puisse aussi être dite une ontologie « d’avant la conversion »21 ou une « eidétique de la mauvaise foi »22 et qu’il soit possible d’envisager une structure existentielle après la conversion, une présentation purifiée, ce que tentent de faire les Cahiers pour une morale23. Ces derniers construisent par exemple une tentative pour donner un sens positif à cette contingence comme gratuité assumée, et même comme chance notion abordée dans L’Être et le néant24 – pour le pour-soi et le pour-autrui25. Que cette tentative n’ait pas été prolongée ne l’invalide pas totalement même si Sartre a pris un chemin différent et a estimé que cette tentative ne correspondait plus aux exigences du moment mais manifeste qu’elle est possible et condition même de la créativité humaine et d’un rapport renouvelé avec autrui. Sartre peut ainsi écrire :
Le rapport du Pour-soi à tout est différent si le Moi tombe : c’est désormais : exister comme quelqu’un pour qu’il y ait tout. Au lieu qu’il y ait chute, il y a dépassement. Et le rapport à la contingence se renverse également : par sa reprise, elle devient gratuité c’est-à-dire explosion perpétuelle de la libre décision qu’il y ait un monde26.
Ce que révèlent également ces Cahiers, c’est la nécessité de distinguer la structure originelle de l’ipséité, condition d’être du monde, de la concrétion existentielle à partir de laquelle elle est saisie. De ce point de vue, l’exemple du désir pris par Sartre27 n’est pas très heureux et témoigne d’une confusion entre deux points : ce qu’on prend de la conscience commune (le fait humain de l’homme comme désir) et la structure qu’on vise à dégager en lien avec la discussion de la tradition philosophique. De même, l’« angoisse » et la « nausée » sont des concrétions existentielles et aussi des objets littéraires, mais elles ne peuvent être mises au même rang que la facticité. La description de la nausée citée par Drewermann28 trouve d’une certaine manière son pendant dans celle des Cahiers29 ou il parle de la joie d’une découverte du monde. À terme et c’est ici le sens de ces remarques l’ontologie sartrienne peut certes s’appuyer sur des conduites qui sont théologiquement interprétables, qui entrent peut-être en résonance avec le texte du yahviste, mais qui n’emporte pas d’emblée la totalité de l’ontologie de Sartre sous l’égide de l’ontologie du péché, du moins à ce premier niveau.
Cependant, il y a un deuxième terme, et qui opère lui-même un basculement, celui ouvert par l’existence d’autrui. Ici, l’analyse de Drewermann semble rencontrer de plein fouet celle de Sartre, ne serait-ce par la manière dont ce dernier rapporte à la structure du pour-autrui la « chute originelle »30 ou le péché originel31, ce qui est le titre du deuxième point de l’examen de Drewermann32. Deux aspects sont ici envisagés. Le premier est celui de la honte33, le second celui des relations avec autrui34. C’est avec l’examen de la structure du pour-autrui et son réinvestissement dans sa lecture théologico-philosophique de Gn, 2-11 – et plus précisément avec la relation Caïn-Abel et le chant de Lamech – qu’apparaît de manière spécifique la question du Mal, au-delà de celle de la chute et du péché.
La question de la honte35 est celle où le point de proximité apparaît comme le plus important et le plus frappant36. La nudité du premier couple et la honte éprouvée à partir du regard d’autrui sont une seule et même chose – une perception de leur non-justification à partir d’une chute loin de Dieu, chute qui est pour Drewermann à la source de la conception de Dieu comme pur regard. Dieu apparaît pour Sartre comme une « subjectivité formalisée »37, ce dernier évoquant Dieu comme « le concept d’autrui poussé à la limite »38. Un certain nombre de descriptions, qui font écho à celle de la honte, sont de plus mobilisées par l’auteur, notamment celle présente dans « L’enfance d’un chef »39 et Les Mots40. Drewermann insiste, dans la conjonction de ces descriptions, sur leur lien avec la définition de la contingence, sur les conditions de leur pertinence ainsi que sur leurs conséquences. Ainsi, pour Drewermann, la honte de n’être que créature n’étant pas acceptée comme contingence en Dieu, elle vient s’imprimer plus fortement sur l’ensemble de son être et conditionne à partir de là les relations concrètes avec autrui en tant qu’elles ont pour fil conducteur le désir d’être Dieu conduisant à la captation, voire à la mort de l’autre, et qu’également (ce que nous verrons ci-dessous), elle vise la mort de l’autre. C’est pour cela que, pour Drewermann, l’ontologie intervient toujours « trop tard, uniquement après la chute »41 et qu’elle ne peut penser la relation à autrui que sur ce qui invalide de fait une conception de Dieu comme autrui, alors que, selon le yahviste, Dieu n’a rien « d’un autre »42 et ne peut être vu comme la formalisation de « l’autre sujet »43.
Cette reprise des analyses sartriennes pose cependant deux difficultés. La première tient à la manière dont la honte est ici survalorisée au regard de son rôle d’abord méthodologique. Cette survalorisation – et des pièces comme Huis clos viennent effectivement renforcer cette idée ainsi que le plaisir par Sartre de faire morceau – en cache néanmoins la fonction méthodologique qui est de mettre au jour la structure de l’être-pour-autrui. À cet égard, cette seule analyse est parlante, mais n’est pas suffisante. Elle demeure abstraite au regard des conduites existentielles visées par le yahviste qui renvoient à un contexte langagier beaucoup plus fort. Autrement dit, c’est ici la condition de possibilité de la honte et non la honte elle-même qui est mise en avant, à savoir la question de mon objectivation par autrui, l’émergence d’une dimension de non-révélé qu’est mon être objet pour autrui, lequel d’ailleurs repose bien sur ma contingence comme présence au milieu du monde, mais une contingence qui est toujours dépassée tout en étant – comme le montre l’analyse du corps, ici totalement absente – condition de révélation du monde. Ici, ce qui est introduit est la structure de l’objectivité, par quoi je deviens un être au milieu du monde, cette objectivité étant nécessaire pour mes relations avec autrui quelles qu’elles soient. Au sein même du propos de la Genèse, le fait pour Adam et Ève de ne pas éprouver de honte (Gn, 2 : 25) implique qu’ils aient un corps et que ce corps existe l’un pour l’autre. La question de l’assomption de ce corps et de l’être pour-autrui de ce corps se pose à un niveau ultérieur. De ce point de vue, on peut même reprocher à Sartre, dans sa volonté d’être pédagogue et de faire parler la culture de son lecteur, d’avoir usé un peu rapidement de la référence biblique44. En fait, il envisage non la culpabilité, mais la condition de possibilité d’une culpabilité déterminée, autrement dit l’engagement dans le monde. Lorsque Drewermann dit que l’ontologie sartrienne vient toujours trop tard, il a en un sens raison, non sur le plan de l’ontologie, mais sur le plan existentiel. Sartre n’envisage pas ici, ce qu’il fera plus tard dans son œuvre (notamment les biographies existentielles), les premières relations, où la primauté de la honte n’est pas présente45. Un dernier point concerne la question du statut de Dieu comme Autre absolu, ce que Drewermann refuse, non seulement en opposition avec Sartre, mais en opposition avec d’autres théologiens, par exemple les théologies fondées sur Dieu comme Tout-Autre46. Or – et c’est une question qui engage de manière générale le rapport entre théologie et philosophie – Dieu n’est pas l’homme. Il n’en reste donc pas moins un autre pour-soi, c’est-à-dire un être pour lequel le monde comme créé demeure le monde. Le penser autrement reviendrait à dire que l’ensemble des catégories philosophiques dont Drewermann se sert ne sont pas valides en elles-mêmes et que la théologie se devrait de développer non seulement un autre concept de Dieu, mais aussi un autre concept de conscience et d’existence qui ressaisirait l’ensemble de la philosophie. Un autre élément est aussi en question : la formalisation ici adoptée tient à ce qu’il demeure obscur de penser une présence divine hors de toute relation incarnée. Que signifie une présence divine, question qui aujourd’hui demeure posée au sein de la philosophie et de la phénoménologie ?
La question du mal comme mal défini – et pouvant faire par ailleurs l’objet de discours moraux et d’interdictions légale et morale47 – n’est pas encore abordée comme telle. Elle ne le devient que lorsque l’analyse de Drewermann s’élargit aux autres hommes, dans la mesure où, pour lui :
Le récit des origines considère que l’opposition absolue de Dieu et de l’homme entraîne immédiatement celle des hommes entre eux, ceci sous forme de concurrence absolue, de lutte mortelle pour la vie48.
Or, cette généalogie trouverait, selon Drewermann, un écho chez Sartre par la radicalisation qu’il opère du problème de l’Autre, comme subjectivité absolue et dans la manière dont Sartre affirme ainsi que « le conflit est le sens originel de l’être-pour-autrui »49 dès lors qu’on s’inscrit dans un projet d’être qui se définit ici comme projet de récupération de mon être. Sartre n'est, pour Drewermann, utile qu’à cette condition, c’est-à-dire qu’en tant qu’il faut examiner « non pas la relation positive d’ouverture à l’autre, celle de l’amour et de la reconnaissance, mais au contraire, celle d’hostilité, de honte et de sadomasochisme »50, cette relation avec autrui pouvant inclure le rapport à Dieu, comme le montrerait l’exemple de Daniel dans Le Sursis51 qui développe envers Dieu une attitude masochiste. L’autre texte de référence concernant ces relations avec autrui et mis en rapport avec Caïn et Abel est bien sûr Huis clos, la pièce reconnue comme la plus célèbre de Sartre et où, selon Derwermann, « Sartre cherche […] à illustrer les conséquences ultimes de ce qu’est notre existence sans Dieu pour peu qu’on se donne le mal de l’analyser jusqu’à ses fondements »52.
Le rapprochement avec Huis clos est à la fois significatif et paradoxal. En effet, les cas de Caïn et Abel et de Huis clos sont significatifs en cela que « les jeux sont faits », soit parce que pour Drewermann, la coupure avec Dieu est en quelque sorte consommée avec le péché originel et nous conduit au mal, (et l’usage de l’œuvre de Sartre vient renforcer en quelque sorte cette nécessité), soit parce que, avec Sartre, le mal est fait, que nous sommes en enfer et que formule classique « l’enfer c’est les Autres »53, ce qu’on retrouve sous la plume de Sartre pour décrire les analyses de L’Être et le néant comme « l’Enfer des passions »54. Cependant, il y a un paradoxe qui tient à ce que les relations entre Caïn et Abel ne ressortissent pas à l’enfer des passions, c’est-à-dire à l’incapacité de réalisation d’un idéal à deux, mais à une situation qui est celle des relations entre deux personnes sous le regard d’un tiers, d’un Autre-sujet55, c’est-à-dire un moment où je suis engagé dans un conflit avec l’autre et où survient le tiers par qui mes actes se trouvent objectivés, le conflit étant « constaté et transcendé par un tiers »56. La question du meurtre de l’Autre est bien évoquée par Sartre dans L’Être et le néant, mais pour dire que le meurtre ne résout rien57. La dimension de l’être pour autrui est une dimension permanente de mon être qui ne permet pas de sortir de ce cercle.
Le paradoxe – mais qui renvoie probablement au principe de l’usage de Sartre par Drewermann et au rôle qu’il lui fait jouer dans l’économie de sa thèse, notamment sur les rapports entre philosophie et théologie – tient à ce que Huis clos est une pièce où précisément « les jeux sont faits »58, c’est-à-dire où les personnages sont morts et n’ont plus d’avenir. Ils sont donc « en proie aux vivants »59. Or, ce n’est justement pas le cas de Caïn, mais Drewermann – avec l’aide de Sartre – semble nous dire cela, dès lors que la rupture par peur de Dieu est consommée. Un second aspect de ce paradoxe est l’ignorance totale par Drewermann de l’ensemble des éléments par lequel Sartre suggère la possibilité d’une « morale de la délivrance et du salut » accessible par une « conversion radicale »60. De même, Sartre, à propos de la fameuse formule « l’enfer, c’est les autres » a lui-même fait une mise au point dans une préface « parlée » (prononcée en 1965) à Huis clos :
On a toujours cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres étaient toujours empoisonnés, que c’était toujours des rapports infernaux. Or, c’est tout autre chose que je veux dire. Je veux dire que si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, alors l’autre ne peut être que l’enfer. Pourquoi ? Parce que les autres sont au fond ce qu’il y a de plus important en nous-mêmes pour notre propre connaissance de nous-mêmes [...]. Cela ne veut nullement dire qu’on ne puisse avoir d’autres rapports avec les autres61.
Sans se référer à un texte aussi tardif, on peut revenir aux Cahiers pour une morale où Sartre développe de manière approfondie cette notion de conversion, et cela, au moment même d’évoquer l’ « Enfer des passions ». Il indique :
[…] qu’il y avait générosité et création. Car en surgissant dans le monde, je donne aux autres Pour-soi une nouvelle dimension d’être. L’Être est au milieu du monde. […]. Ainsi par l’Autre je suis enrichi d’une nouvelle dimension d’être : par l’Autre je me mets à exister dans la dimension de l’Être, par l’Autre je deviens objet. Et ceci n’est nullement une déchéance ou un péril en soi. Cela ne le deviendra que si l’Autre refuse de voir aussi en moi une liberté.62
Ces manuscrits montrent certes, selon les termes mêmes de Sartre ce que, à un moment donné, il a voulu faire, mais qu’il n’a pas poursuivi63. Ils demeurent néanmoins un témoignage précieux, congruent avec d’autres, pour une mise en perspective des analyses utilisées par Drewermann comme se suffisant à elles-mêmes.
Nous l’avons indiqué au début de ce propos, un des aspects caractéristiques du propos de Drewermann est non seulement d’aborder certains thèmes, mais de relier l’œuvre de Sartre à la totalité du parcours de Gn, 2-11. Un aspect particulier est la manière dont Drewermann reprend la figure de Lamech (Gn, 4 : 8-24)64, descendant de Caïn et forme ultime du développement de la voie caïnique, représentant d’une assomption du Mal comme liberté absolue et comme violence. Drewermann le rapproche du personnage principal de la trilogie des Chemins de la liberté, Mathieu Delarue, depuis L’Âge de raison jusqu’à La Mort dans l’âme, et la manière dont il est en proie à la liberté, et dont celle-ci s’accomplit (provisoirement) en sniper en haut d’une tour65. La liberté est vécue comme vide et responsabilité du vide dans le contexte de l’avant-guerre et d’une rupture larvée du personnage principal avec sa maîtresse enceinte : « Il était seul, au milieu d’un monstrueux silence, libre et seul, sans aide et sans excuse, condamné à décider sans recours possible, condamné pour toujours à être libre »66. Dans le second extrait, le fantasme de toute puissance de la liberté, où se rassemble toute la vie (jusqu’à présent67), Mathieu aurait marqué, selon Grell, ses « premiers pas vers un engagement responsable, des pas qui le conduiront vers ce que Sartre appellera plus tard la morale du groupe en fusion »68 et qui, pour Drewermann, sont « le sadisme triomphant d’une violence exacerbée »69, les deux lectures se rejoignant sous le signe de la vengeance.
La dernière figure convoquée est celle de Goetz dans Le Diable et le bon Dieu. Ce personnage, selon Drewermann, représente le lien entre l’expérience par l’homme de son propre néant (ici sa bâtardise) et le vide du chant de triomphe sadomasochiste de Lamech : « Bâtard, je l’étais de naissance. Mais le beau titre de fratricide, je ne le dois qu’à mes mérites »70. Pour Drewermann, Sartre, avec le personnage de Goetz, nous présente « en toute clarté les structures du mal » et révèle « le lien existentiel entre l’expérience de la nullité d’un être privé de toute justification, l’orgueilleuse mégalomanie avec laquelle il s’affirme face à Dieu et la cruauté arbitraire envers l’homme »71. Ce que montrerait ainsi le personnage de Goetz dans ses retournements (la revendication du Mal, puis du Bien), c’est que, au-delà d’un choix singulier du Bien et du Mal, le fait même que ce choix se fasse par l’homme (en tant que condamné à la liberté) le voue nécessairement à l’autodestruction.
Face à cette lecture, deux remarques peuvent être faites. La première est celle du sens de la condamnation à la liberté. Sartre, dans les Cahiers pour une morale, l’éclaircit de la manière suivante : la condamnation à la liberté renvoie à la nécessité d’être dans le monde en le dépassant comme étant la seule manière d’être dans le monde : l’infirmité, le handicap n’existent de ce point de vue que comme dépassés, y compris dans leur prorogation. Il ne peut y avoir pure et simple passivité. À cet égard, on voit comment l’appréhension par Mathieu de sa propre liberté demeure, de ce point de vue limitée au terme de l’âge de raison, comme le montre la conclusion désabusée et incomplète. Quant à la fin de la première partie de La Mort dans l’âme, si l’action de Mathieu représente un début d’engagement, on en voit d’emblée la limite, liée d’une part à la situation de la guerre, d’autre part au caractère symbolique de l’action qui n’est pas si loin de l’appropriation destructrice et qui se fait avec les moyens du bord, y compris les moyens psychiques (l’ensemble du passé repris par l’engagement et à partir duquel l’avenir confère un sens au présent). En ce sens, la formule finale de la description : « il était pur, il était tout puissant, il était libre » est probablement encore une formule mystifiée, une manière dont la liberté s’apparaît faussement à elle-même dans une situation donnée. Il n’y a pas ici la dimension d’invention qui sera présente plus tard.
Pour la volonté du mal chez Goetz, un certain nombre des remarques précédentes peuvent être reconduites, tout en sachant que le contexte est différent. Le Diable et le Bon Dieu, tout comme Saint Genet,comédien et martyr (1952), se situe à un moment particulier de l’évolution de Sartre, celui où il constate que toute morale qui ne se déclare pas impossible aujourd’hui est une mystification72. C’est surtout une morale qui ne peut qu’avoir partir liée avec le mal et qui doit se vouloir synthèse du Bien et du mal dans la mesure où le Bien s’identifie à l’être dans le cadre d’une société donnée – qui est une société d’oppression – et où tout dépassement de l’être est nécessairement l’Autre du Bien, et donc le Mal. Cette réinscription dans le social est un élément essentiel pour appréhender la figure de Goetz. Le néant de sa bâtardise n’est pas simplement le symbole de la néantisation ontologique et de la contingence structurelle de toute existence humaine, mais cette bâtardise est un néant social, liée à un régime particulier de naissance par lequel se définissent bonne et mauvaise naissance sociale et le Bien est lui-même un bien socialement défini. La synthèse du Bien et du Mal recherchée par Sartre est une synthèse non hégélienne liée, non à une liberté absolue, mais à une appréhension active du monde à partir d’un dépassement de ce dernier qui implique une libération de l’oppression. On touche ici au virage avec la problématique sociale qui remet justement en cause la séparation du Mal et du Bien, comme étant deux dimensions séparées et stables.
Quelles sont les conclusions tirées par Drewermann de cette première approche qui nous mène, sur le fondement d’une ontologie du péché, au seuil du mal social, liée à la situation d’oppression qui caractérisera à partir de là le devenir social de l’ontologie ?
Une première thèse est celle selon laquelle la conscience est « chute hors de l’être » sans possibilité de réconciliation73, cette chute aboutissant à une structure du pour-soi qui n’est qu’une structure valable pour l’homme tombé et non pour tout homme, l’angoisse succédant à la chute au lieu d’en être la source, comme le proposent Drewermann et Kierkegaard. Une seconde thèse concernant l’œuvre de Sartre est que celle-ci produit « un modèle phénoménologique et existentiel qui nous permet de comprendre la réalité de l’existence humaine »74 et la logique du péché (angoisse et honte, menace sur autrui, autodivinisation). Nous aboutissons ainsi à une explication de la chute de l’homme vers le mal universel, la problématique sociale de la Critique de la raison dialectique prenant ici le relais.
Cependant, cet usage suscite deux questions, l’une liée à la lecture de l’œuvre, les autres liées au statut de la philosophie au regard de la théologie. Concernant la lecture de l’œuvre, le point principal concerne la manière dont la lecture de de l’œuvre de Sartre par Drewermann écrase l’existential sous l’existentiel, le philosophique sous le littéraire pour en tirer des conclusions en termes de logique nécessaire, alors que l’existentiel est une exemplification parmi d’autres possibles et que le littéraire obéit à une logique spécifique mettant en œuvre des médiations particulières et un autre travail de l’écriture. Certes, nombre d’éléments peuvent nourrir la relecture de Drewermann et, de plus, Sartre mobilise des schèmes chrétiens. Mais, précisément, il les mobilise comme éléments communs de discours et non comme structures ontologiques. Il faudrait donc revenir sur celles-ci et en explorer à nouveaux frais les possibilités philosophiques de cette ontologie.
C’est ici qu’intervient la seconde question qui conditionne en fait la première, à savoir le statut de l’ontologie : d’une part, celle-ci intervient toujours trop tard et seule la théologie intervient au bon moment, c’est-à-dire à partir du Dieu créateur. D’autre part, ce que Drewermann veut retenir de Sartre, c’est bien plus sa phénoménologie de la conscience, son développement en ontologie lui apparaissant comme une erreur, car directement contradictoire avec Gn 2, 5 notamment par les thèses directrices de son ontologie. Ce faisant, il rejette au nom de la théologie, la portée des concepts fondamentaux de Sartre et c’est à ce prix qu’il peut faire jouer à la phénoménologie un rôle existentiel de phénoménologie de l’existence coupée de Dieu et vouée au mal. C’est l’inverse du rôle que lui fait jouer Sartre et de la manière dont celui-ci a toujours positionné le problème du Mal, comme problème surgissant à partir de la situation et non comme structure de cette situation.
On est donc devant une alternative : ne doit-on pas complètement rejeter l’ontologie et donc refuser toute pertinence aux catégories ontologiques et à l’ontologie elle-même pour un autre discours, ou bien n’est-il pas possible de fournir une autre ontologie à même de rendre compte à la fois de la vie d’avant et après le péché ? Au-delà de la nécessité d’articuler le récit yahviste à l’ontologie sartrienne, on est alors devant une alternative : le mal est-il un scandale subvertissant le discours philosophique pour la théologie ou un effet dont ce même discours devrait pouvoir faire la genèse et situer comme une problématique intersubjective ?75