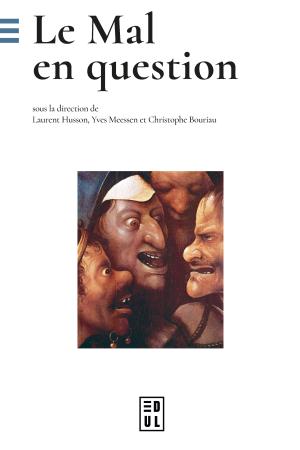
L’une des notions au prisme desquelles les penseurs chrétiens ont affronté la question du mal est celle, fameuse, de « péché originel ». Qu’est-ce que le péché originel ? Ce n’est pas simplement la chute de l’humanité, soit l’idée que l’humanité serait aujourd’hui dans une situation moins bonne que celle dans laquelle Dieu l’aurait créée, privée du paradis terrestre, affaiblie et mortelle. Le péché originel indique plus que cela : le mal n’est pas seulement la condition de l’humanité, pas seulement une donnée extérieure avec laquelle l’humanité doit composer. Il est logé en l’être même de l’humanité, à sa racine. C’est chaque être humain qui, du simple fait de son origine, le propage. Cette idée a joué un si grand rôle dans l’histoire du christianisme latin que certains y ont vu la contribution majeure du christianisme à l’anthropologie européenne. C’est le cas par exemple du philosophe polonais Leszcek Kołakowski, marxiste révisionniste et dissident1. Pour lui, cette doctrine est un garde-fou contre toute intention humaine, aussi bonne soit-elle, au nom de laquelle on voudrait justifier toutes les atrocités – la marque du contexte des dictatures communistes est évidente. Dans la mesure où, à cause du péché originel, aucun projet humain ne peut être tout à fait bon, il convient de toujours s’en méfier et de ne jamais trop sacrifier à l’un ou l’autre de ces projets. Ainsi, pour Kołakowski, la doctrine du péché originel apporte-t-elle à l’action humaine le doute qui, écrit-il, est à la fois sa conséquence malheureuse et son correctif nécessaire. Sa conséquence malheureuse, parce qu’aucune action ne peut être considérée avec certitude comme bonne, dans la mesure où aucune ne peut causer du bien sans en même temps causer du mal. Son correctif nécessaire, parce que la conscience de ce fait implique une certaine retenue permettant d’éviter les pires conséquences que la meilleure des actions humaines ne manquerait pas d’avoir, si l’on y croyait trop.
Du point de vue chrétien, il s’agit peut-être d’un malentendu. Après tout, cette doctrine n’a pas été élaborée dans un cadre anthropologique ni pour expliquer la présence du mal en l’humain. Dans l’économie de la pensée d’Augustin, qui lui a donné le premier sa formulation la plus nette2, c’est tout le contraire. C’est dans un cadre théologique, et pour penser non le mal, mais le bien que Dieu fait, en Jésus-Christ, à l’humanité, que le théologien d’Hippone en est venu à élaborer la doctrine. Ce n’est pas en analysant l’être humain et en méditant sur son malheur. Dans la composition du tableau théologique augustinien, le péché originel n’est que l’ombre nécessaire à l’éclat de la lumière du Christ. Toutefois, par une ironie habituelle dans l’histoire de la pensée, la doctrine s’est pour ainsi dire autonomisée. La théologie est devenue philosophie, et la méditation sur la grandeur de l’œuvre divine et la bonté du salut, déploration de la bassesse et de la misère humaines. Au point, quelquefois, d’être utilisée pour nier toute possibilité de progrès humain et justifier les pires conditions de vie comme de justes punitions. Il y aurait beaucoup à dire sur ce mouvement et beaucoup à critiquer de l’anthropologie chrétienne pessimiste qu’elle a contribué à encourager. Toutefois, ce glissement de la doctrine hors du cadre théologique qui l’a vu naître doit aussi être mis au crédit de la théorie. C’est en effet la marque de sa plausibilité anthropologique. Après tout, il se pourrait bien qu’en ayant voulu parler d’abord et avant tout de l’acte de Dieu – qui certainement n’a pas besoin de la doctrine du péché originel pour être pensé, et qui doit pouvoir l’être sans elle dans de nombreuses situations – Augustin ait fait une découverte anthropologique. Et dans ce cas, les philosophes auraient eu bien tort de ne pas la récupérer.
C’est d’ailleurs le grand argument de Pascal, autre grand défenseur du péché originel – et dont Kołakowski était spécialiste : sans le péché originel, « nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes »3. Autrement dit, c’est bien sa dimension anthropologique qui fait toute la valeur de la doctrine. Sans admettre le péché originel, pense Pascal, on ne saurait expliquer ce qu’il appelle la « double condition » humaine, sa grandeur et sa bassesse. La valeur explicative du péché originel est donc telle qu’il serait plus fou de rejeter cette doctrine que de l’admettre. Certes, mais il ajoute :
Chose étonnante cependant, que le mystère le plus éloigné de notre connaissance qui est celui de la transmission du péché soit une chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-mêmes. Car il est sans doute qu’il n’y a rien qui choque plus notre raison que de dire que le péché du premier homme ait rendu coupables ceux qui étant si éloignés de cette source semblent incapables d’y participer. Cet écoulement ne nous paraît pas seulement impossible. Il nous semble même très injuste, car qu’y a-t-il de plus contraire aux règles de notre misérable justice que de damner éternellement un enfant incapable de volonté pour un péché où il paraît avoir si peu de part, qu’il est commis six mille ans avant qu’il fût en être4.
Le péché originel a donc une grande valeur explicative, mais il est en lui-même inexplicable... Il est inexplicable pour une double raison. D’abord parce qu’il est inadmissible théoriquement : on ne peut pas comprendre son fonctionnement. Mais il est aussi, écrit Pascal, inacceptable moralement. Attribuer la culpabilité d’une faute à quelqu’un qui ne l’a pas commise nous semble trop injuste. Ces deux aspects sont d’ailleurs difficiles à dissocier, comme on le verra : la manière dont on comprend le mécanisme de transmission héréditaire du péché a une influence sur l’évaluation que l’on peut faire de la justice de cette transmission. Car le cœur du problème est bien celui-ci : la transmission de la culpabilité. Tout simplement, il semble que la culpabilité soit intransmissible.
C’est aujourd’hui un argument repris dans la littérature sur le péché originel, pour s’écarter de la doctrine augustinienne et pascalienne. Ainsi, Oliver Crisp5 insiste sur le fait que notre usage habituel, judiciaire notamment (dans notre « misérable justice », mais qui est aussi la seule que l’on connaisse), de la notion de culpabilité, est incompatible avec son transfert d’une personne à l’autre. Par définition même, il faut, pour être coupable d’une action, que l’on puisse se voir attribuer cette action à soi et non à une autre. Une personne n’est coupable d’une action que dans l’exacte mesure où c’est elle qui a commis cette action. Cela suffit à Crisp pour refuser cette version de la doctrine du péché originel, que l’on peut appeler sa version forte, et lui préférer une version faible, n’impliquant aucun transfert de culpabilité6. Dans cette seconde version, chaque personne humaine naît certes en état de faiblesse ou de corruption, suite au péché d’Adam ou à un événement ancien dans l’histoire de l’humanité, mais cette faiblesse et cette corruption ne lui sont pas imputables. Elles sont des conséquences que les individus subissent sans en être responsables. Bien entendu, elles peuvent certes induire chez eux une propension à commettre des péchés. Cependant, elles n’impliquent pas en elles-mêmes une culpabilité.
Préférer cette version faible à la version forte, c’est finalement rejeter la doctrine du péché originel stricto sensu pour lui préférer une doctrine de la chute. Et ce n’est certainement pas illégitime du point de vue chrétien. Le catéchisme de l’Église catholique (§ 405) fait d’ailleurs un pas dans cette direction, sans toutefois être très clair sur le sujet. Si cette doctrine forte a joué un grand rôle dans l’histoire du christianisme, elle n’a jamais tout à fait convaincu dans sa partie orientale, ni n’a jamais été la seule en vigueur en Occident. Dans ces conditions, la difficulté conceptuelle soulevée par l’idée d’un transfert de culpabilité pourrait donc sembler une bonne raison de l’abandonner.
Toutefois, ainsi qu’Olli-Pekka Vainio le fait remarquer, abandonner la version forte de la doctrine du péché originel ne règle pas le problème de l’injustice. Il se pourrait même qu’il soit rendu plus aigu. En effet, dans la version faible, les personnes naissent dans un état de corruption dont elles ne sont pas responsables. Cependant, cet état les rend davantage susceptibles de commettre des péchés, et elles sont ensuite tenues responsables de ces péchés. S’agit-il d’un progrès du point de vue de la justice ? N’est-il pas injuste de tenir une personne pour responsable des actes qu’elle commet, alors qu’elle les commet – du moins en partie – parce qu’elle a été placée dans une situation qui la pousse à les commettre ? La responsabilité du péché n’incombe-t-elle pas au moins en partie à celui qui a mis la personne dans cette situation7 ? Ne se retrouve-t-on pas devant cette situation paradoxale que la chute devient en quelque sorte une circonstance atténuante du péché ? Finalement, ce n’est que dans le cas où le péché originel ne signifie pas seulement la transmission des conséquences du premier péché, mais de la culpabilité de ce péché lui-même, que les êtres humains pourraient être légitimement tenus pour responsables de leurs péchés.
Ainsi l’équilibre pascalien demeure-t-il : la version forte du péché originel est plus plausible du point de vue de ses conséquences et de sa valeur anthropologique que la version faible, mais elle moins plausible conceptuellement, parce qu’elle est incompréhensible. Ce manque de plausibilité tient essentiellement à la difficulté de concevoir le transfert de culpabilité d’un individu à un autre. Si donc, l’on pouvait faire tomber cet obstacle et montrer qu’un tel transfert est pensable sous certaines conditions théoriques, on n’aurait certes pas encore montré que la doctrine forte du péché originel est vraie, mais l’on aurait fait un pas en montrant qu’elle n’est pas impossible, comme Pascal le pense. C’est ce pas que je me propose de faire dans cet article. Ne resterait alors que la question empirique de savoir si le transfert a effectivement lieu dans l’humanité réelle, et comment8.
Il semble difficile de nier le lien analytique entre la culpabilité d’une personne à l’égard d’une action, et le fait que l’on puisse lui attribuer cette action à elle, et non à quelqu’un d’autre. Pour défendre la possibilité du transfert de culpabilité, il est donc certainement plus prometteur, plutôt que de contester ce lien, de chercher à complexifier l’appréhension immédiate de l’identité personnelle. Pour ce faire, je propose ici un détour apparent, par l’un des auteurs les plus importants pour la réflexion sur l’identité personnelle, à savoir John Locke. Il se trouve que ce contemporain de Pascal n’a pas seulement introduit en philosophie le problème de l’identité personnelle dans les termes suivant lesquels il se discute encore aujourd’hui, mais il s’est aussi exprimé directement sur le péché originel. Or le lien entre ces deux aspects de sa pensée, s’il est parfois fait de manière formelle, n’est pas souvent réfléchi en détail. Il est pourtant réel, et s’en apercevoir permet d’obtenir quelques indications quant à la direction vers où chercher une théorie de l’identité personnelle compatible avec la version forte du péché originel.
Si la pensée de John Locke est importante dans l’histoire de la réflexion sur l’identité personnelle, c’est qu’il a le premier, dans un célèbre chapitre de son Essai sur l’entendement humain9, cherché à distinguer très nettement cette identité de toute identité substantielle, en la fondant sur ce qu’il appelle la conscience. On n’est pas une seule et même personne parce que l’on est une seule et même substance (corps ou âme), mais parce que l’on a une même conscience10. Par conséquent, les actions attribuables à la personne sont celles qui peuvent être attribuées non à une substance (un individu humain, corps et/ou âme), mais à une conscience. Évidemment la grande difficulté est ensuite de savoir ce que signifie exactement la notion de conscience. Ce n’est pas chose facile. Le terme même utilisé par Locke, celui de consciousness, est si peu usité à son époque que les traducteurs français ont le plus grand mal à la rendre : conscienciosité pour Leibniz, con-science pour Coste... Locke n’en donne aucune définition très précise, sinon celle-ci : « la perception de ce qui passe dans l’esprit d’un homme11 ». Cela peut comprendre la mémoire, la réflexion, mais également ce que l’on appellerait aujourd’hui le flux de la pensée. Le mot de perception, toutefois, semble engager plus qu’une simple sensation, déjà une première réflexion sur ces sensations c’est-à-dire une forme d’activité et non la pure réceptivité d’un sens interne. Peu importe ici12. Ce qui compte, c’est bien la différence entre la fondation de l’identité personnelle sur la conscience, et toute identité substantielle, fondée sur la mêmeté d’une chose matérielle ou spirituelle.
Cette différence entre l’identité des substances et l’identité des personnes a des conséquences relativement contre-intuitives. En particulier, elle aboutit à une distinction entre individu et personne qui peut sembler extrêmement tranchée. D’abord parce que tout l’individu n’est pas la personne. Autrement dit, si la personne est identifiée par sa conscience, et que ne peuvent lui être attribuées que les actions dont elle est consciente, alors toutes les actions d’un individu ne sont pas nécessairement attribuables à la même personne. Ainsi, la folie ou l’ivresse sont des situations où, si la personne n’a pas la responsabilité des actions commises par l’individu, c’est que littéralement ce n’est pas elle qui les commet – dans l’exacte mesure où elles ne sont pas commises avec la même conscience. Plus intéressant encore est le cas inverse : celui, non pas des absences de la conscience, mais de ses débordements. Si l’on était conscient d’avoir commis des actions que l’on n’a pas commises (en tant qu’individu, corps et âme dans ce monde-ci), devrait-on en être tenu responsable ? La réponse de Locke est aussi claire qu’étonnante :
Si j’avais la même conscience d’avoir vu l’arche et le déluge de Noé, que celle que j’ai d’avoir vu déborder la Tamise l’hiver dernier, ou que je suis en train d’écrire, je ne pourrais pas plus douter de ce que moi qui suis en train d’écrire, qui ai vu la Tamise déborder l’hiver dernier, et qui ai vu l’inondation lors du Déluge, suis le même soi [self] – mettez ce soi dans la substance que vous voulez – que de ce que moi qui écris ceci suis le même moi-même [the same myself] maintenant que j’écris (que je consiste entièrement dans la même substance, matérielle ou immatérielle, ou non), que celui que j’étais hier13.
C’est dire qu’il n’y a pas à proprement parler de faux souvenirs : si j’ai vraiment conscience d’avoir vécu un événement, même si je (ma substance individuelle) n’étais pas réellement présent lors de l’événement en question, ce vécu peut bien m’être attribué à moi personnellement. Aussi loin que déborde la conscience s’étend l’identité personnelle, et si j’avais vu le déluge exactement comme Noé l’a vu, le vécu même de Noé serait aussi le mien.
C’est ainsi que ressurgit la doctrine du péché originel. Il est frappant que l’exemple de Locke, tiré de la Genèse, soit celui de Noé – et non d’Adam. Il suffirait toutefois d’opérer la substitution pour que le texte décrive un mécanisme possible de transmission du premier péché. Je pourrais être pécheur en Adam, c’est-à-dire coupable du péché d’Adam, sans n’avoir jamais, en tant qu’individu, commis ce péché ou un autre. Il suffirait que j’aie conscience d’avoir commis ce premier péché pour que la responsabilité puisse effectivement m’en être attribuée. Ainsi, la fondation de l’identité personnelle résout-elle facilement le problème du transfert de culpabilité en changeant la définition habituelle de la personne et en la distinguant de celle de l’individu. Il n’y a d’ailleurs pas, stricto sensu, de transfert de culpabilité : la culpabilité est bien la mienne uniquement et immédiatement, en tant que personne c’est-à-dire en tant que j’en ai conscience. Elle n’est pas transférée d’une personne à l’autre ou d’un individu à l’autre. En revanche, il y a une culpabilité partagée entre consciences. Dans cette théorie, en effet, rien n’empêche qu’un même vécu ou une même action puissent être attribués à différentes consciences et donc différentes personnes. Rien ne l’empêche et même, cela semble presque une conséquence naturelle du découplage opéré entre le niveau de la substance (individu) et celui de la conscience (personne). Une fois ce découplage opéré, plus rien ne s’oppose à ce que la responsabilité de certaines actions puisse être attribuée à des personnes qui, en tant qu’individus, ne les ont pas commises. Il est même plausible que cela arrive effectivement, dans la mesure où les faux souvenirs et les fausses attributions d’action sont des phénomènes connus et étudiés.
On objectera peut-être qu’il s’agit d’une lecture abusive, Locke lui-même n’ayant pas considéré cette doctrine comme un moyen de donner une explication du péché originel ou du moins de son mécanisme central, le transfert de culpabilité. C’est vrai, mais la raison pour laquelle il ne l’a pas fait apporte une confirmation paradoxale de mon hypothèse.
La théorie lockéenne de l’identité personnelle a été très souvent critiquée, et ce dès le 18e siècle. L’un des arguments les plus souvent utilisés a précisément été la question des faux souvenirs. Plus récemment, Antony Flew14 a cherché à montrer qu’il s’agissait là de la plus grande faiblesse de la théorie de Locke et a voulu y voir la preuve que sa distinction entre individu et personne n’était pas tenable. L’existence de faux souvenirs, écrit-il, et de personnes qui sont sincèrement conscientes d’avoir participé à la bataille de Waterloo, ne fait pas qu’elles y aient effectivement participé. Cela va de soi, et cela semble à Flew un argument suffisamment fort pour rejeter la théorie. Flew considère d’ailleurs que Locke lui-même a perçu la faiblesse de son argumentation et l’impossibilité d’éviter ses conséquences absurdes en raison de l’existence des faux souvenirs. Il aurait perçu cette faiblesse, et la marque de cette lucidité serait que Locke aurait cherché à l’éviter par un artifice théorique grossier consistant à faire intervenir Dieu directement pour colmater ce trou béant dans la cohérence de sa pensée et empêcher les conséquences de l’existence des faux souvenirs :
Cette possibilité [celle des faux souvenirs, entraînant l’attribution des actions d’un individu à une personne qui apparemment n’est pas cet individu], aussi longtemps que nous n’aurons pas une vue plus claire de la nature des substances pensantes, nous n’aurons pas de meilleur moyen de l’exclure que d’invoquer la bonté de Dieu […].
À s’en tenir là, Flew aurait raison de voir dans cet appel à la bonté de Dieu un artifice et un aveu de faiblesse. Une sorte de confession par Locke de l’insuffisance de sa propre théorie, qui ne tiendrait finalement que par l’appel à la bonté de Dieu. Cette lecture oublie cependant la suite immédiate du texte :
[…] dans la mesure où c’est le bonheur ou le malheur de l’une de ses créatures qui est en jeu, il ne commettra pas la même fatale erreur qu’elles en transférant de l’une à l’autre cette conscience qui qui emporte avec elle la récompense et le châtiment15.
Autrement dit, si Locke en appelle à la bonté de Dieu, c’est précisément sur la question qui nous intéresse : non pas celle des faux souvenirs en général, mais celle du transfert de culpabilité. Or, s’il s’oppose résolument à ce transfert, ce n’est pas comme Flew au nom du sens commun, et de l’évidence que si je n’ai pas participé effectivement à la bataille de Waterloo, ma conscience éventuelle de ma participation ne la rend pas pour autant effective16. Ce n’est pas pour cette raison que Locke introduit la bonté de Dieu dans son raisonnement, mais pour une autre, tout à fait différente. C’est parce qu’il rejette explicitement la doctrine du péché originel, et que c’est donc le transfert de culpabilité qu’il veut éviter, pas les faux-souvenirs en général et le débordement de la conscience personnelle hors de l’individualité. Ce rejet explicite du péché originel, Locke l’exprime en particulier dans un texte qui rappelle celui de Pascal et qui date exactement de l’époque de la rédaction du chapitre de l’Essai consacré à l’identité personnelle :
Comment serait-il compatible avec la justice et la bonté de Dieu que la postérité d’Adam soit punie pour son péché ; que l’innocent soit puni pour le coupable ?17
On y retrouve la bonté de Dieu. Une seule et même bonté de Dieu dans les deux textes. Dans cet opuscule de Locke consacré à un commentaire littéral du Nouveau Testament, elle guide l’exégèse de Paul et c’est en son nom que Locke récuse la doctrine du péché originel, avec le transfert de culpabilité qu’elle implique. Elle fait finalement adopter à Locke ce que j’ai appelé la version faible du péché originel. Locke insiste bien sur le fait que ce qui se transmet à la descendance d’Adam n’est pas le péché lui-même, ni même à proprement parler la punition du péché (ce qui serait injuste), mais seulement les conséquences de la punition, ce qui en soi n’entraîne, d’après lui, aucune injustice. Dans l’Essai, la bonté de Dieu garantit que les faux souvenirs n’induisent pas qu’une personne puisse être punie (ou récompensée) pour des actions qu’elle est consciente d’avoir commises, mais qu’elle n’a pas commises effectivement c’est-à-dire en tant que substance individuelle. C’est une seule et même chose ! Contrairement à ce que pense Flew, Locke ne fait pas appel à Dieu parce que sa théorie de l’identité personnelle serait insuffisante en elle-même, à cause du problème des faux souvenirs. Autrement dit, la fondation de l’identité personnelle sur la conscience, accompagnée du problème des faux souvenirs, ne pose pas en elle-même de difficulté philosophique pour Locke. En revanche, les faux souvenirs posent un problème quant à leurs conséquences théologiques : ils rendent possible le péché originel. Ce n’est donc pas pour garantir la cohérence philosophique de sa théorie que Locke fait intervenir Dieu dans l’Essai, mais pour en éviter une conséquence théologique : la plausibilité de la doctrine du péché originel, qui peut désormais se comprendre le plus simplement du monde comme le « [transfert] de l’une à l’autre [de ses créatures de] cette conscience qui emporte avec elle la récompense et le châtiment »18. La manœuvre argumentative de Locke dans l’Essai, l’introduction de la bonté divine, prouve donc a contrario la force de sa théorie de l’identité personnelle pour expliquer la possibilité du transfert de culpabilité. Dans la perspective de cette explication, sa théorie est pour ainsi dire trop efficace. Il n’a d’autre choix, à cause de ses engagements théologiques contre le péché originel, que d’abandonner l’argumentation philosophique et d’en appeler à Dieu pour garantir que le transfert de culpabilité n’ait pas lieu et que Dieu nous préserve du péché originel. Ainsi se trouve à mon avis levé l’obstacle de l’intelligibilité de cette doctrine, et notamment de son noyau central, le transfert de culpabilité. À condition bien sûr d’accepter une théorie lockéenne de l’identité personnelle.
Notre difficulté initiale était celle-ci : il y a des raisons de vouloir défendre la doctrine « forte » du péché originel, c’est-à-dire celle qui implique un transfert de culpabilité, parce que sa version faible n’est pas tellement moins injuste, et surtout parce que cette version est celle qui permet de mieux conserver la dimension anthropologique de la doctrine et en particulier le caractère indéracinable du mal dans l’action humaine. Malgré ces raisons de vouloir la défendre, la doctrine se heurte à une difficulté : l’idée d’une culpabilité transmissible semble inconcevable. Or, c’est précisément ce que la doctrine lockéenne de l’identité personnelle permet de concevoir. Très exactement, elle permet de concevoir un partage plutôt qu’un transfert de culpabilité. Partage entre deux personnes distinctes (Adam et moi), en raison du fait qu’un même événement individuel (le péché de l’individu Adam), peut m’être attribué dans la seule mesure où je suis conscient de l’avoir commis. Elle permet donc d’échapper à la fois à l’objection du manque d’intelligibilité de la doctrine, et de son injustice – je ne suis responsable que d’actions qui me sont personnellement attribuées (bien que je ne les ai pas nécessairement commises en tant qu’individu).
Il reste cependant la question de savoir si cette distinction entre personne et individu, au centre de la théorie de Locke, ne manque pas elle-même trop de crédibilité pour permettre véritablement de rendre concevable la version forte de la doctrine du péché originel. Il est vrai qu’elle peut heurter le sens commun – c’est d’ailleurs tout le sens de l’argument de Flew. L’une des manières de répondre à cette objection pourrait être de montrer que cette distinction, certes contre-intuitive, trouve des origines dans le christianisme et, en particulier, dans la théologie trinitaire et la christologie. Dans la théologie trinitaire, Dieu en tant que nature est distingué du Père, du Fils et de l’Esprit, qui sont trois personnes. Bien que certains théologiens aient identifié cette distinction entre nature et personne à celle entre genre et individu, cette identification est problématique à plusieurs titres. En effet, si les trois personnes de la Trinité constituaient trois individus de la même espèce, le christianisme serait un tri-théisme (trois dieux partageant la même essence divine). Inversement, la Trinité elle-même ne peut-elle être dite un individu ? En outre, suivant la théologie issue du concile de Chalcédoine, l’identité de Jésus en tant qu’individu (sa nature humaine, qui n’existe qu’en tant qu’individuelle) doit être d’une certaine manière distinguée de son identité en tant que personne. Sans quoi, il y aurait deux personnes en Jésus-Christ : la personne du Fils et l’individu Jésus-Christ. Je ne veux certes pas dire que l’individu lockéen corresponde trait pour trait à l’οὐσία ancienne. De telles équivalences exactes n’arrivent jamais à un tel intervalle dans l’histoire de la pensée, tout comme d’ailleurs nos concepts théologiques actuels de nature ou de personne ne correspondent pas exactement à l’οὐσία ou à l’hypostase anciennes. En revanche, il me semble difficile de nier que cette distinction chrétienne ancienne conduise à une compréhension quelque peu complexe de l’identité, et rende nos catégories communes inaptes à la saisir19. Par conséquent, s’il est vrai que la distinction entre individu et personne, en floutant les limites de l’identité individuelle, éloigne la compréhension de l’identité, et de son lien à la responsabilité, de la compréhension commune, cela ne me semble pas pouvoir être une objection pour les chrétiens, dans la mesure où cet éloignement lui-même ne fait que reproduire un mouvement de la théologie chrétienne. La solidarité dans le mal que cette théorie introduit entre les personnes ne rejoint-elle pas, d’ailleurs, une intuition fondamentale du christianisme, à savoir que la chute comme le salut ne sont pas des affaires individuelles, mais d’emblée collectives, sans que pour autant ce collectif soit indifférencié ?
Par des fils innombrables, par des fils invisibles, par des fils mystérieux, infiniment, éternellement mystérieux, tout est lié à tout, vous êtes liés tous ; et à tout ; et réciproquement, mutuellement ; et ce sont des enchevêtrements, des entrecroisements sans fin. Voilà, voilà ce que c’est que votre communion20.
Et en effet, si la culpabilité pour les actions mauvaises d’un individu peut être partagée par plusieurs personnes, alors il n’y a pas de raison de penser que la responsabilité pour les actions qui entraînent non pas châtiment, mais récompense puisse également être partagée. Ce qui permettrait d’expliquer par le même mécanisme la chute et le salut.
Entendons-nous : tout cela ne prouve pas que la doctrine forte du péché originel soit vraie. Ce n’était pas la question. Cela lève seulement un obstacle conceptuel à son intelligibilité, peut-être le principal. Déterminer si cette doctrine est non seulement intelligible, mais plausible ou même vraie, impliquerait deux étapes supplémentaires au moins. D’abord, affiner conceptuellement la notion de conscience. Ensuite, déterminer empiriquement si, de fait, il existe, dans les consciences humaines de manière plus ou moins latente, la conscience d’avoir commis une faute à laquelle on n’a pas individuellement participé. Il ne me semble pas que cette idée manque entièrement de plausibilité psychologique, mais évidemment, en faire la démonstration dépasserait de très loin le cadre de cet article.