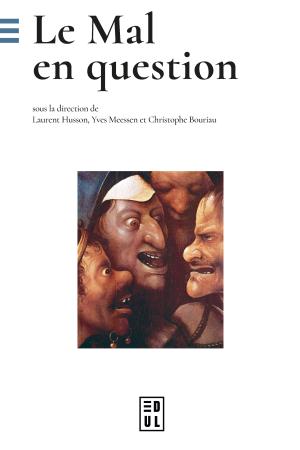
Je regrette Dieu […]. La chimie, frère, la chimie ! Mille excuses, votre Révérence, écartez-vous un peu, c’est la chimie qui passe.
Dimitri Karamazov
La célèbre implication « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » fait de l’athée un amoral complet, c’est-à-dire un homme qui pense avoir des droits à tout ce qu’il désire et qui n’a de limites que celles de son impuissance physique ou intellectuelle, ou celles que forment des pouvoirs qui s’opposent à ses désirs, pouvoirs naturels (la pesanteur pour Icare, le vent contraire pour un cycliste, la force ou les désirs d’autrui) ou culturels (le droit, le gendarme, le juge, la prison). La conscience de ces limites (de ces contre-pouvoirs) détermine un programme de conquête : lutter contre les limites par le progrès indéfini de l’humanité. Ce progrès ne doit pas même, si l’on tient à une vraie cohérence, être une obligation, sous peine de réintroduire la morale sous la forme d’un humanisme. Il n’y a que très peu de penseurs qui aient tenu strictement cette position. Max Stirner en est un exemple, pour qui l’homme n’est appelé à rien et ne fait que faire ce qu’il peut1. Le progrès a ainsi une signification : émanciper l’individu en diminuant les pouvoirs qui le freinent, qu’ils soient naturels ou institutionnels. Technique puissante et liberté juridique la plus grande possible forment les deux directions de ce progressisme. Et beaucoup considèrent, ou ont considéré, que Dieu était le frein majeur de l’émancipation, un frein inventé dans et à cause d’un sentiment pitoyable d’insécurité.
La thèse de l’amoralité de l’athée a fait l’objet de nombreuses discussions, en particulier depuis Pierre Bayle2, et il serait fastidieux de résumer les tentatives soit de nier cette thèse (« non ! les athées ne sont pas amoraux »), soit de prendre la défense de la morale en réintroduisant une nécessité de croire en l’existence de Dieu (« oui ! raison même d’imposer politiquement la croyance en Dieu »). Cette défense déiste de la morale est le cas de Rousseau, de Robespierre ou de Kant (sous la forme atténuée d’un simple postulat, puisque seule une vie posthume indéfinie laisse un peu d’espoir d’être à la hauteur du devoir). Pour les athées moralistes, ou moralisateurs, « engagés », plusieurs ont tenté de faire une apologie d’un humanisme sans Dieu, voire d’une étrange responsabilité devant tous les hommes (Sartre). Le seul intérêt de ces discussions est de faire connaître l’idée que certains se font de Dieu ou, simplement, ce qu’ils mettent sous ce nom. La peur de l’absence de frein du cynique ou la peur du plus fort suscitent le refuge dans un Dieu sur-veillant, tout-puissant, cet « œil qui est dans la tombe » même3, un Dieu-policier à qui personne n’échappera. Même un régime aussi policier (traquant et tuant les suspects) que celui de Robespierre (fidèle à la religion civile de Rousseau) imposera un culte de l’Être suprême et la croyance en l’immortalité de l’âme, pour tenir en respect le citoyen. Car si un contrat social est imaginé pour fonder un ordre juridique, il faut encore lui fournir un appui qui le sacralise. Différents serments prêtés sur des textes religieux à l’occasion des témoignages ou des prises de fonction montrent que la société d’athées de P. Bayle n’est pas si évidente aux yeux mêmes de nos contemporains.
Nous n’entrerons pas dans ces discussions. Nous nous limiterons au romancier qui a rendu cette implication célèbre : Dostoïevski. Elle a un sens particulier chez cet auteur, un sens inséparable d’une querelle célèbre, l’opposition entre les partisans de l’Occident et ceux de l’âme russe, les occidentalistes et les slavophiles. C’est dans son dernier roman, Les Frères Karamazov (1879), que l’on trouve en effet cette formule. Plus précisément encore, nous tenterons d’expliquer ce que veut dire cette implication pour Dimitri Karamazov, dans un chapitre en particulier : « L’hymne et le secret » (chapitre 4 du livre 11). Car il est le personnage qui porte le plus d’arguments en faveur de cette thèse, alors même qu’elle lui est inspirée de façon différente par son demi-frère Ivan et par un athée socialiste, futur journaliste : Rakitine.
Après avoir tenté d’exposer l’argumentation du personnage qui soutient, ou plutôt qui craint la vérité de cette implication, nous tenterons de distinguer plusieurs idées différentes de « Dieu », en particulier celles qui voient s’opposer la Puissance et l’Ordre. La question suit d’ailleurs la critique dostoïevskienne de l’Occident. Car la vindicte de Dimitri Karamazov contre les « Bernard », selon l’antonomase de notre première partie, pose un problème : comment l’empire de la causalité expérimentaliste (exclusivement matérielle et efficiente, selon un vocabulaire plus ancien) peut-il laisser une place à l’éthique ? Et quelle idée de Dieu réconciliera une autre causalité avec la possibilité d’une morale ? Celle d’un Dieu-Puissance ou celle d’un Dieu-Ordre ?
Sous un titre mystérieux, le chapitre « L’hymne et le secret » est un chef d’œuvre, un exemple de ce que Dostoïevski réussissait le mieux en tant qu’artiste : la mise en scène théâtrale de situations et de dialogues. Pour les situations, elles méritent ce que Karl Jaspers a pu nommer des situations-limites, créatrices d’oppositions si violentes que les personnages se rendent capables d’excès tels qu’ils ne sont plus eux-mêmes et peuvent proclamer ce qu’ils ne pensent pas réellement. Jeu, bouffonnerie, grandiloquence, posture… c’est un chaos, une tempête sous un crâne qui agitent un personnage dans sa crise, un point de tension extrême. Dans un mélange habile de dévoilement et d’affectation, les personnages montrent et cachent, sont authentiques et faux. Le romancier reste maître de ces contradictions et les utilise pour mieux ouvrir ses propres perspectives.
Rappelons la situation : le roman raconte une énigme policière et un procès. Il s’agit de l’assassinat de Karamazov et du procès d’un de ses fils. Karamazov a quatre fils, Dimitri (l’accusé), de sa première épouse, Ivan et Alexis de la seconde, et un enfant naturel, Smerdiakov, qui est le véritable assassin. C’est l’innocent Dimitri qui est jugé et condamné. Innocent mais d’un certain point de vue coupable (qui ne l’est pas chez Dostoïevski ?) car, comme Smerdiakov et Ivan, il a souhaité la mort du père et envisagé de le tuer. Le roman développe une énigme policière puis judiciaire et une question de responsabilité morale qui dépasse les actes commis et concerne leur intentionnalité. L’un des personnages centraux du roman est un staretz controversé qui s’est converti à la suite d’un frère mourant qui faisait de la culpabilité universelle le dogme capital de sa religion.
Le chapitre que nous abordons raconte la visite que rend Alexis à son frère Dimitri, dans sa prison, à la veille du procès. Alexis (croyant, moine novice) pense son frère innocent, alors que d’autres visiteurs (les athées : le « journaliste » Rakitine et le second frère, Ivan) le croient coupable. On pourrait dire que Dimitri se confesse à Alexis en chantant un hymne et en dévoilant un secret, qui sont dans la plus complète opposition. L’hymne est un chant d’amour pur, celui de l’innocent condamné qui trouve dans l’enfer souterrain qui l’attend un élan vers Dieu et vers toute l’humanité, qui n’attend rien en retour, contra spem in spe. Amour pur qu’il faut comprendre à l’instar de la célèbre querelle théologique qui a opposé en leur temps Bossuet et Fénelon. Mais la conversion présente aussi les symptômes inquiétants d’une folie, si habilement notée par le romancier, par le truchement d’Alexis, que l’on peut répéter après Freud que « l’analyste ne peut malheureusement que déposer les armes devant le problème du créateur »4. Dieu prend pour Dimitri le sens de « celui qui donne la joie », sens voisin de ce que dit saint François en réponse au disciple qui l’interroge sur la « joie parfaite », celle qu’on rencontre dans le dénuement complet, celle qui ne dépend de rien, de rien qui s’obtienne en tout cas. Dimitri trouve une vocation : chanter sa foi dans l’univers du bagne, sauver les forçats, ses futurs compagnons souterrains.
Vocation, posture ou folie ? C’est le secret qui suivra qui justifie cette question : il s’agit du projet d’évasion organisé par celui qui dans le roman a « toute sa tête », l’athée Ivan, froid, habile, cynique et terriblement intelligent, mais qui perdra la raison et peut-être la vie, ne pouvant plus supporter sa propre intention parricide. Évasion hautement symbolique : l’exil américain, fuir vers le lieu pourtant méprisé, détesté des slavophiles auxquels Dostoïevski s’est rallié, l’Occident. « Je la déteste déjà cette Amérique ! qu’ils soient là-bas des techniciens hors-ligne ou tout ce qu’on voudra, que le diable les emporte […] J’aime la Russie Alexéi, j’aime le Dieu russe, tout vaurien que je suis »5. Cet Occident est le lieu du « travail libre dans un État libre » et s’y enfuir c’est trahir évidemment la conversion de l’innocent christique, dont le châtiment injuste devait lui permettre de rédimer les pécheurs. Le secret dit le contraire de l’hymne, comme l’Occident dit le contraire de la Russie.
C’est pourquoi la formule « si Dieu n’existe pas, tout est permis » doit se comprendre dans un contexte de tension extrême entre occidentalistes et slavophiles où le parti pris désormais par Dostoïevski pour les slavophiles est manifeste, quand bien même tout son art évite la lourdeur d’une littérature engagée et donne sa part à l’incertitude, au chaos, à l’insincérité, à tout ce théâtre karamazovien de la fausseté humaine. Peu de temps après avoir achevé ce livre, la dernière conférence de l'auteur, son discours sur Pouchkine (1880)6, confirme la double allégeance slavophile, de la mission de la Russie, celle de sauver le monde, et de son privilège : le don d’universalité, car seule l’âme russe, comme Pouchkine est censé le montrer, est capable d’avoir une compréhension intime, empathique, de tous les peuples. Dire « si Dieu n’existe pas… », c’est simplement dire l’Occident, et dire l’Occident c’est, pour Dostoïevski, dire la décadence, voire la décomposition malgré (ou par ?) le progrès à la fois technique, scientifique, administratif et politique.
C’est pourquoi Freud ne se trompe pas quand il ne résiste pas à laisser voir sa détestation de Dostoïevski, comme homme. Si nous avons évoqué l’éloge qu’il fait de l’écrivain et de son roman (« le plus imposant qui ait jamais été écrit »), il ajoute à propos du « moraliste » : « ce qu’il y a [chez lui] de plus aisément attaquable ». Deux superlatifs opposés : autant le romancier est génial, autant le moraliste est nuisible. Dans un paragraphe surprenant, il dira que « l’avenir de l’humanité lui devra peu de choses ». Pourquoi ? D’abord parce que le moralisme de Dostoïevski est aux yeux (peut-être étroitement essentialistes ?) de Freud un moralisme russe, la capacité propre aux Russes de battre leur coulpe de façon théâtrale, donc de s’accuser après. Alors que pour Freud, la moralité consiste à s’empêcher avant. Et surtout, Dostoïevski, selon Freud, a trahi « l’intérêt pratique de l’humanité » : savoir renoncer et non pas s’accuser dans des repentirs qui ne sont que des permissions de faillir à nouveau. Par-là, il a manqué à sa tâche d’éducateur et d’émancipateur, d’homme de progrès, en devenant par une sorte de nationalisme russe fanatique à la fois tsariste et chrétien orthodoxe. Tout le texte de Freud vise à expliquer cette fâcheuse évolution (aux yeux de Freud) en posant un diagnostic sur l’épilepsie psychique et non organique de Dostoïevski, et en diagnostiquant une névrose due à l’intention parricide et à une forme d’homosexualité. Beaucoup ont souligné l’étonnante faiblesse de ce texte freudien, mais il est révélateur de l’opposition, de ce qui est en question dans la détestation par les Russes (slavophiles) de l’Occident, et, s’il faut ne retenir que l’animosité freudienne, réciproquement. L’intérêt pratique (la morale ?) de l’humanité serait mieux servi par une société d’athées, car elle comprendrait avec une simple conscience pragmatique la nécessité du renoncement, des limites à imposer aux pulsions.
Dimitri dit à Alexis qu’il est « perdu ». Heureuse ambivalence ou équivocité du terme : alors qu’Alexis comprend qu’un prisonnier à la veille de son procès a perdu tout espoir, Dimitri va lui expliquer que sa perte est plutôt celle de la vertu d’espérance au sens où il craint que la grâce qui l’a touché ne le quitte, et cela sous l’influence des propos de Rakitine et d’Ivan. Par eux c’est l’idéologie scientiste de l’Europe qui parle. C’est pourquoi, pour Dimitri, l’Occidental est un « Bernard ». C’est en effet l’antonomase qu’il utilise et répète dans le dernier tiers du roman. Qu’est-ce qu’un Bernard ? C’est un Occidental ou un Russe occidentaliste, un athée, matérialiste, qui croit que les lois de la physique et de la chimie s’imposent partout, y compris dans la physiologie, dans le fonctionnement de la pensée et dans le comportement des hommes. Uniformité achevée de la connaissance, qu’il s’agisse de l’inerte, du vivant, de la société, de la morale ou du droit. Un scientiste typique du 19e siècle, mécaniciste, déterministe. Ce Bernard est aussi un critique de la vie sociale, un socialiste prêt à excuser les délits dans la mesure où ils sont des effets inévitables des conditions de vie de ceux qui les ont (nécessairement) commis, de purs effets du milieu. C’est ce Bernard qui justifie (si le mot « justifier » a encore un sens ici) que tout est permis, au sens où tout est conditionné de telle sorte que tout est nécessaire. Bernard à cause de Claude Bernard, l’homme de l'Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, dont Bergson a pu comparer le génie à celui du Descartes du Discours de la méthode7. Bien sûr, Dostoïevski est un romancier et non un philosophe et il laisse voir l’ignorance de son personnage qui confond ce Bernard avec un chimiste peut-être allemand prénommé Karl… ou Carl. Mais dans ce tableau d’un chaos de pseudo-connaissances, de connaissances du deuxième degré, on ne laisse pas d’être étonné par une conscience assez précise de ce qui est en jeu. Dimitri bafouille l’exemple de la physiologie du cerveau, de sa réduction physicaliste (comme on dira aujourd’hui) à des impulsions électriques, à des ondes aux effets de proche en proche qui s’épanouiraient, si l’on ose dire, selon une émergence incompréhensible, en « pensées », en désirs, en intentions. « La pensée vient ensuite… parce que j’ai des fibres, et nullement parce que j’ai une âme et que je suis créé à l’image de Dieu »8. La négation de Dieu est solidaire de l’homme devenu machine, fonctionnant. La méthode cartésienne réservée à la matière, au corps, envahit désormais l’esprit via une nouvelle physiologie du cerveau.
Le Claude Bernard de Dimitri n’est qu’une rumeur, un portrait-charge de l’Européen moderne… Il n’est pas, bien sûr, question de Claude Bernard, le nôtre, le vrai, celui de Bergson. Ce Claude Bernard est d’ailleurs ou complexe ou indécis, car à la fois il fonde la conduite empiriste ou expérimentale sur une réduction de tous les faits de physiologie à des événements physiques et chimiques déterminés strictement par leurs conditions, et, cependant, il laisse ouverte la question morphogénétique d’une direction donnée à la formation des systèmes complexes, des organismes, par une Idée organisatrice. Anti-vitaliste contre le vitalisme simpliste de forces non physiques (non spatio-temporelles) mais aussi, et pourtant, organiciste tant il était saisi, en physiologiste, par l’impossibilité que les parties se disposent les unes pour les autres dans l’ignorance d’un tout qui rende raison de ces réciprocités. Nous n’oserons pas dire que Bergson est trop généreux avec Claude Bernard, et sans doute le Bernard de l’antonomase de Dostoïevski est simpliste. Mais jusqu’à quel point ? N’est-ce pas le réductionnisme qui l’emporte chez Claude Bernard ? Selon Bergson :
Non seulement le physiologiste doit prendre en considération cette idée organisatrice [idée par qui pensée ?] dans l’étude qu’il institue des phénomènes de la vie : il doit encore se rappeler, d’après Claude Bernard, que les faits dont il s’occupe ont pour théâtre un organisme déjà construit, et que la construction de cet organisme, ou comme il dit la “création”, est une opération d’ordre tout différent9.
Bergson voit que si l’on suit cette direction, on peut finir par restaurer le vitalisme que Claude Bernard a combattu. La différence relevée ici entre la construction et la destruction (ou l’usure de tout fonctionnement, son entropie croissante), « entre la machine et ce qui se passe en elle », mérite notre attention. On ne peut penser la morphogenèse et le fonctionnement de la même façon. Mais dans les phénomènes de la vie, la démarcation est-elle évidente ? Par exemple, le caractère omnipotent d’une cellule est-il réservé aux cellules embryonnaires ? Le cerveau ne garde-t-il pas quelque chose de l’équipotentialité ? C’est dans l’organisme actuel et pas seulement dans l’organisme en formation qu’il faut savoir ce qui relève d’un traitement mécaniste et ce qui relève d’un autre traitement qu’on ne peut dire vitaliste tant ce terme est discrédité, mais peut-être « panpsychiste ». Il reste que dans la science vulgarisée et dans les conceptions transhumanistes dominantes, la physiologie est réduite à un fonctionnement qu’on suppose imitable en tout point par des machines. La loi d’inertie a envahi le domaine vital. Parallèlement, l’humain cesse d’être exceptionnel. C’est pourquoi, concernant la culture dominante de l’Occident, Dostoïevski n’a pas tort de dire qu’un Bernard fait de tout homme un simple effet des conditions qui lui sont imposées, donc une victime de son milieu.
Peut-on aimer l’humanité sans Dieu ? Le versant « social » sinon socialiste de l’athée est un humanisme qui a pour objet « l’extension des droits civiques et empêcher la hausse du prix de la viande » (Rakitine). Mais pour Dimitri Karamazov, il faut, pour que ce type d’actions existe, que d’abord chacun attribue une valeur (évitons le cliché de la « dignité ») à la personne humaine. Si l’homme est ce que les Bernard en disent, il est pure transition de causes et d’effets qui sont en dehors de lui ; il n’a aucune intériorité vraie. D’où le soupçon de Dimitri à l’égard de cette philanthropie : « Toi-même, ne croyant pas en Dieu, tu hausserais le prix de la viande, le cas échéant, et tu gagnerais un rouble sur un kopeck ». L’humaniste athée serait un usurier sans limites. Ou seulement limité par tous les autres usuriers.
De façon paradoxale, la fameuse revendication d’autonomie de la morale se retourne en hétéronomie complète. Morale dite indépendante de toute métaphysique, de toute affirmation ou croyance sur la vie bonne, morale que chacun se donne en toute liberté (rationnelle sans doute…). Cette morale est en fait pétrie, façonnée de toutes les limitations reçues des autres, sauf à obtenir leur consentement : judiciarisation grandissante des relations humaines. Est permis ce que l’on me permet. Cette limitation est en réalité la contrepartie de la pensée déterministe et matérialiste. Enfant trouvé métaphysique, sans dette à l’égard du Ciel, l’individu est criblé de dettes, enfermé dans un système d’autorisations qu’on aura beau maquiller en contrat social pour lui donner un aspect sacré, mais qui ne peut qu’être aussi extérieur à lui que la direction du mouvement d’un projectile lui est donnée de l’extérieur. Il suffit de considérer les conséquences éthiques du darwinisme : une règle morale n’y est rien d’autre que le comportement qui a permis la survie du groupe qui l’a adoptée. Comme un organe est objet de sélection, de même des actes. La morale n’est rien d’autre, sous la forme d’habitudes, qu’un organe de survie d’un groupe, essentiellement fondé sur le renoncement à des pulsions, une dette pour survivre. Rien n’est mieux, ni visé comme tel. La pression du milieu fait tout. Et l’action sur le milieu est aussi un effet de cette pression.
Il n’est donc pas insensé de soutenir que « si Dieu n’existe pas, tout est permis », si la non-existence de Dieu signifie une extension universelle du mécanisme (dans toutes ses variations). Si tout repose sur une pluie d’atomes aux combinaisons si diverses que l’état du monde n’est que la dernière configuration, de quoi en effet se réjouir ? De quel succès ? Mais la pensée scientiste des Bernard affecte-t-elle réellement les comportements ? La peur de Dimitri d’être « perdu », de voir son état de grâce le fuir, et cet homme nouveau qui renaît en lui disparaître, cet état d’anxiété extrême est-il un moment de crise (romantique, baudelairienne) éphémère ? Moment pseudo-prophétique, exaltation maladive, comme le note Alexis (le croyant) ? Analogue en somme à cette curieuse alarme littéraire du roman gothique de Mary Shelley : Frankenstein ? Rappelons que la « créature » du savant est celle d’un autre Bernard : une mode court en ce début du 19e siècle, la réduction de l’origine du vivant à une impulsion électrique, dans le cadre archaïque d’une adhésion à la génération spontanée. Coudre des morceaux de cadavre, les exposer à un courant électrique, voilà la méthode pour fabriquer des hommes ! Enfin de l’inerte au spontané ! L’éclair de génie de Mary Shelley contre l’électricité savante !
C’est à ce courant de pensée qu’appartient Dostoïevski. Comme Shelley, comme Baudelaire, il reprend, selon une formule de Philippe Muray, le 19e siècle à contre-sens, mais avec une accentuation nationaliste et populiste orthodoxe : l’âme russe et sa mission universelle. De 1880 à nos jours, ne retrouve-t-on pas des échos de ces anciens débats. Une certaine slavophilie actuelle a renoué avec Dostoïevski. Sur ce sujet, le livre de Iegor Gran Z comme zombie est éloquent, notamment le chapitre : « Pouchkine et son complexe »10. Les transhumanistes enthousiastes, les greffeurs trans-spécifiques en tout genre, les indifférentialistes de la cause animale ne seraient-ils pas aux yeux de Dostoïevski ces Occidentaux en décomposition ?
Résumons ce premier aspect : la formule « si Dieu n’existe pas… » a un sens particulier dans un chapitre de l’œuvre dostoïevskienne, « L’hymne et le secret ». Le même personnage soutient dans la plus parfaite contradiction un chant d’amour pur à Dieu comme maître de la joie, un chant franciscain ou baudelairien qui solidarise l’admiration du monde avec la reconnaissance en ce monde du génie divin de son créateur. Pas de joie sans cette admiration et pas d’admiration pour de simples effets mécaniques de causes. On se souvient de l’espoir d’un Pierre de Bérulle que la science cartésienne reporterait l’admiration vers le concepteur et le créateur de ce mécanisme. Depuis, selon le mot de Pierre-Simon de Laplace (pourtant nullement athée lui-même), Dieu est une hypothèse superflue. Mais l’admiration ne peut plus être reportée sur rien. L’hymne est devenu impossible. La solution serait la fuite vers… l’Occident. Contradictoirement, Dimitri s’y prépare aussi, laissant penser que sa conversion à la mission unique de l’âme russe est encore une posture grandiloquente. Mais il rêve aussi d’un retour après son exil, comme s’il annonçait le dernier parcours d’un Soljénitsyne.
Ce roman, comme tout roman, propose une expérience de pensée, sans doute violente. Soyons pour quelques instants un Bernard, ce chimiste déterministe selon Dimitri. Oublions le vrai physiologiste et son « idée organisatrice ». Plaçons-nous sous une pluie d’atomes. Et tentons de penser que nous pensons. Non au sens cartésien, mais au sens d’un travail sensé, de recherche du vrai, selon donc des normes, dans l’appréhension de se tromper, sans droit donc à l’erreur. Nous ne manquerons pas de nous sentir, de nous savoir « incongru ».
Une morale émancipée de tout fondement religieux semble s’imposer avec l’empire de la causalité expérimentale. En éliminant de la connaissance les causes formelles et finales, le monopole de la causalité observable et expérimentable débouche sur la conception d’un monde uniquement formé de mécanismes. Dans ce monde dont les dimensions sont réduites à l’espace-temps, une autre substitution semble nécessaire, celle de la contrainte ou de la menace judiciaire à des notions désormais désuètes comme celles d’obligation et de devoir. La morale ne serait-elle qu’une superstition liée à des causalités archaïques ? Si l'on ajoute à la menace judiciaire l’alerte hygiénique, n’assiste-t-on pas au remplacement de la morale par un exosquelette social renforcé ? Déjà, Bayle imaginait que la possibilité des sociétés athées s’accompagnerait de plus de sévérités. La puissance en particulier du regard des autres y jouerait un grand rôle, anticipation du « big brother is watching you », ce big brother remplaçant le big eye hugolien. Le dernier argument de la permissivité reste : de quoi êtes-vous privé par l’autorisation de tel comportement ? Il n’est plus question de partager des valeurs, des consensus par recoupement, mais de cohabitation non conflictuelle. On voit d’ailleurs que cette perspective conçoit l’éthique (ou la morale, nous ne distinguons pas) d’une part selon une appréhension subjective d’un état de plaisir et, d’autre part, selon une appréhension d’adulte. Aucune considération sur l’influence d’une génération sur la suivante, sur la fragilité des consentements ne semble affecter cette unique règle pour interdire ou autoriser : quelle gêne pour autrui ? Le sens de la liberté selon John-Stuart Mill (ce qui ne nuit pas à un autre) est indifférent à la temporalité de la vie sociale et ne concerne que des adultes c’est-à-dire des individus « achevés » ou se disant comme tels sans réplique possible. Sans compter que tout l’appareil de tenue juridique repose aussi sur des conventions d’âge qui n’ont pas de fondement rationnel certain et autorise un doute à la façon de Montaigne : majorité à 15 ans, 18 ans ? Interruption volontaire de grossesse permise à combien de mois de grossesse ? Vérité en deçà, erreur au-delà ?
En apparence, le déisme comme religion naturelle semble rendre la morale autonome, puisque la conscience de chacun trouve en elle-même (« instinct divin, céleste et immortelle voix ») les règles sobres de la conduite humaine. On pourrait croire qu’ainsi la morale ne dépend pas d’une injonction, d’un ordre divin accepté sans raison. Mais l’économie d’une révélation et d’une autorité cléricale n’évite pas la nécessité pour Rousseau et Robespierre d’une religion civique avec des dogmes durement sanctionnés si le citoyen ne les admet pas et, à l’occasion, ne les célèbre pas. Dans la religion civile, la morale dépend de l’existence de Dieu parce que la morale n’est possible que si les actes qu’elle dénonce sont sanctionnés et si ceux qu’elle prescrit sont récompensés. C’est encore la sanction et la récompense qui tiennent en respect le citoyen.
Les moralistes déistes semblent ne rien comprendre à la révolution chrétienne de l’idée de Dieu, pour laquelle on peut soutenir à la fois « si Dieu n’existe pas, tout est permis » et « c’est parce que Dieu existe que tout est permis » (au sens augustinien d’ama et fac quod vis). C’est la raison pour laquelle le passage le plus célèbre du roman de Dostoïevski est « la légende du Grand Inquisiteur », celle d’un autre procès, fait à Jésus, d’avoir résisté aux trois tentations diaboliques, celles de la puissance (en orthodoxe, l’auteur fait le procès du catholicisme qui n’a pas résisté, selon lui, à ces tentations). Nous verrons que « tout est permis » suppose une réforme même de l’idée de puissance.
Nous admettons ici une hypothèse historiciste d’un progrès de la conscience religieuse. Selon cette hypothèse11, le divin correspond d’abord à une puissance remarquable. Si l’homme est dominé par la peur et le désir, tout ce qui lui permet d’échapper à la première et de satisfaire le second, devient son maître. Éthique, religion et technique se confondent dans ce qui s’accorde avec la puissance, la reconnaît, s’allie avec elle, s’y soumet pour en bénéficier. Dieu se détache de la seule puissance intra-mondaine (ce qui a le mana et qui est tabou) en devenant un interlocuteur, c’est-à-dire aussi une volonté. Le monde sacral est peut-être moins enchanté que complice ou ennemi, d’emblée dans une relation politique. Bien agir c’est d’abord avoir Dieu « de son côté », ou ne pas l’avoir comme adversaire. Toute vertu est un art d’éviter une puissance néfaste et un art d’obtenir l’appui d’une puissance favorable. L’éthique ne semble pas, alors, se détacher d’une superstition : quand Chaplin boxeur agite une patte de lapin, il n’est pas différent d’un homme honnête qui rend une monnaie juste à un aveugle, si ce dernier geste tient encore d’une forme de magie.
En apparence cynique, ce propos est d’une grande banalité dans l’histoire de la philosophie : l’anneau de Gygès en est une illustration. Son intérêt est de placer en vis-à-vis le « tout est permis » de l’athée (il suffit d’être assez malin pour ne pas se faire prendre) et la vertu dépendante de l’existence de Dieu, si Dieu est la Puissance. On accordera qu’il n’y a aucune supériorité de cette vertu sur le calcul cynique. Les deux (l’athée et le croyant) sont dominés par le souci de la puissance. Y compris les « faibles », voire plus encore les faibles, qui par ressentiment ont un supplément de vengeance à combler.
Dieu comme puissance est ce qui court-circuite le chemin laborieux de la causalité. C’est la raison capitale de l’antinomie Bernard/Morale. En effet, le scientisme impose une causalité nécessaire, alors que la puissance de Dieu permet l’économie de cette nécessité, du travail et de l’effort, et aussi du pur hasard. Sauf à penser que les rituels sont un travail. Au fond, le Dieu puissant est le Dieu des superstitieux qui attendent une sorte de complicité de destin, et peuvent lier dans un pseudo enchaînement de causalité tout et n’importe quoi. La critique par Simone Weil de la providence et la place qu’elle accorde au travail s’opposent de façon cohérente à cette puissance12. L’évangile de Matthieu dit aussi que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes13. De même la légende du Grand Inquisiteur centre le christianisme sur le refus par le Christ des pouvoirs14, les trois tentations du Diable.
C’est pourquoi nous risquerons l’idée que Dimitri s’est émancipé d’une idée de Dieu comme puissance pour un sentiment océanique de perfection, un « Dieu de la joie » :
La vie est pleine, la vie déborde même sous terre ! […] la soif de vivre s’est emparée de moi, précisément dans ces murs dégradés ! […] je me crois en état de surmonter toutes les souffrances, pourvu que je puisse me dire à chaque instant : je suis !15
De même, il ne réduit pas la vertu au comportement qui permet des relations sans heurts, sans conflits, entre les hommes, une parfaite sociabilité : justice (à chacun son dû), tempérance (limiter sa part, son ambition, ne pas être avide), courage (être solidaire et tenir son poste dans le danger), véracité (que l’on puisse compter sur son témoignage). La vertu est la diffraction circonstanciée d’un accord avec ce qui est.
Au lieu de cette vertu comme socialité et de la superstition morale, Dimitri tient à la possibilité de faire un hymne. C’est-à-dire un chant joyeux.
Il semble que le christianisme enseigne un refus de la puissance ou une telle purification de celle-ci que Dieu n’y est plus ni un surveillant, un policier infaillible, un juge, un espoir d’éternité ni un allié, un seigneur qui favorise. C’est le sens du refus christique du pouvoir et celui de l’amoralisme de Dieu, indifférent aux justes et aux injustes. Purification, car la puissance se déplace de son rapport avec les désirs et les peurs, se désubjective, perd le sentiment de puissance comme le ressentiment de l’impuissance, pour s’oublier dans un sens de la réussite, c’est-à-dire d’un ajustement parfait au sens d’une action dans ses circonstances concrètes. De cette perspective morale réaliste et objective, Platon et Aristote restent les meilleurs interprètes. Les discussions sur la généalogie de la morale comme ruse des faibles contre les forts ne mettent pas en question le sens de la force. Car il se peut que la vertu (et pas seulement la fortitudo, mais toute vertu) soit un cas primaire de force. Toute action selon des normes, c’est-à-dire des essences en tant qu’elles guident une réalisation concrète, est une vraie puissance. Pouvoir obtenir des effets physiques désirés, échapper à des effets physiques craints ne forment pas une vraie puissance. Produire des effets n’est pas identique à être efficace.
La vie morale ne cherche pas à passer au-dessus des lois physico-chimiques, mais elle relativise l’efficace de ces lois en les jugeant à l’aune de normes et d’un monde de valeurs. Dieu est donc ce monde de valeurs, un champ axiologique, plutôt un ordre qu’un être et surtout pas un être qui permettrait de passer outre l’effort, en étant soumis, préféré, choisi, élu. On voit que Mitia Karamazov rejoint, si son idée de Dieu est bien celle-là, non seulement le Dieu de l’amour pur selon Fénelon, mais aussi l’idée de Dieu des mystiques rhénans, celle de Maître Eckhart priant Dieu de nous délivrer de Dieu et faisant une exégèse paradoxale de « L’insensé dit dans son cœur : “il n’y a pas de Dieu” » (Ps, 14 : 1). Dans l’inscience (pour laquelle il n’est plus d’objet dans l’acte de connaître), dire « Dieu n’est pas », ce n’est pas nier quelque chose de lui, mais affirmer qu’il n’est pas un étant, même suprême. Il est ce par quoi la joie est possible, dit Mitia. Si la joie est ce qui accompagne tout acte parfait, il est ce qui rend la perfection d’un acte possible.
C’est parce que Dieu « n’existe pas » que tout est sinon permis, du moins possible. Car comme norme des normes, champ axiologique, il permet toute réussite. Encore faut-il, pour accepter cet argument, accepter aussi que la liberté ne soit pas la propriété d’un être mais d’un acte, et que tout acte aspire à être réussi. Les vertus comme dispositions acquises rendent l’acte susceptible de cette réussite. Encore faut-il accepter aussi que la vie humaine soit une morphogenèse continuée, que l’action soit une formation, que l’homme soit néoténique non seulement dans ses premiers instants mais peut-être pendant tout le cours de l’existence.
Ce Dieu n’est alors sans Providence que parce qu’il finance continûment tous les êtres. La ruse du laboureur de La Fontaine illustre cette Providence impersonnelle : « Travaillez, prenez de la peine ; c’est le fonds qui manque le moins ». Le conflit entre l’athée et le croyant devient plus clair si on l’interprète comme un conflit sur le sens de ce travail. Pour l’athée, il est une insertion dans le courant efficace des lois physiques, qui permet de devenir « comme maître et possesseur » ; pour le croyant, tout travail est une participation à un monde d’essences normant l’activité, et tous les vrais agissants sont co-créateurs du monde.