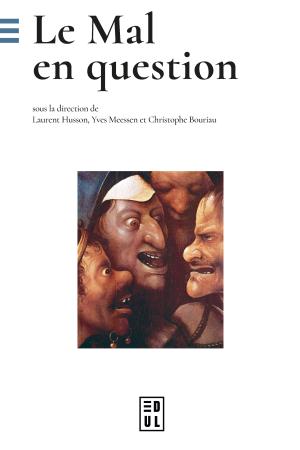
Une large part de la philosophie contemporaine de la religion porte sur ce qui est désigné comme « le problème du mal ». Comment la douleur, la méchanceté et toutes les calamités affligeant notre pauvre monde pourraient-elles advenir dans un monde créé et gouverné par Dieu, tel que le décrit le théisme classique ? Pour répondre à cette question, certains sont conduits à contester au moins l’une de ces trois affirmations : Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, Dieu est bon. Peut-être même conviendrait-il d’adopter finalement un tout autre concept de Dieu, qui n’ait plus rien à voir avec ces attributs traditionnels. Prendre au sérieux le problème du mal obligerait ainsi à une révision radicale de la théologie chrétienne traditionnelle. Mais le problème du mal peut aussi conduire à rendre peu vraisemblable l’existence même de Dieu. Ce problème serait ainsi le cheval de Troie introduit par l’athée dans le théisme pour précipiter sa défaite.
Ce n’est pas ce que pensent Richard Swinburne, Alvin Plantinga et Peter van Inwagen, sommités de la philosophie analytique de la religion. Pourtant, ils ont intensément examiné le problème du mal. Plantinga dit même que, s’agissant de l’existence de Dieu, « l’objection de facto peut-être la plus importante serait l’argument de la souffrance et du mal »1. Mais tous les trois proposent des solutions. À la différence de John Mackie ou William Rowe, des maîtres eux aussi de la philosophie analytique de la religion, et dont les articles au sujet du mal se trouvent dans tous les recueils destinés à y initier les étudiants2. Que les philosophes analytiques soient ou non d’accord sur les solutions au dit « problème du mal », ils n’en ont pas moins, dans leur majorité, pris ce problème très au sérieux.
Remarquons qu’une bonne raison pour cela est que le problème du mal ne peut être purement théorique, réservé aux seuls philosophes et théologiens – comme l’est, par exemple, celui de la simplicité divine. Des juifs, des chrétiens et des musulmans « ordinaires », dans leur vie religieuse, font face à cette redoutable objection du mal. C’est le mal dans le monde, et quelquefois quelque chose de terrible survenu dans sa vie personnelle ou celle d’un proche, qui a pu conduire tel ou tel à perdre la foi et à abandonner la pratique religieuse. On entend souvent cela : « Après la mort de ma mère ou de la fille du voisin, tellement injuste, j’ai arrêté de croire ». Quel sens y a-t-il à vouer un culte à un Dieu tout-puissant, omniscient et bon, mais qui finalement ne fait rien pour réduire ou éliminer la souffrance humaine ? Comment la mort d’un enfant innocent, parfois dans d’abominables souffrances, n’atteindrait-elle presque inévitablement la croyance religieuse ? (« Mon Dieu, mais pourquoi ? – et donc tu n’existes pas ».) Ainsi il y aurait indubitablement un problème du mal, et si sérieux qu’on ne peut pas le laisser aux seuls philosophes.
Et puis, il y a Auschwitz. Où était Dieu ? Dans son célèbre article sur « Le concept de Dieu après Auschwitz » (1987), Hans Jonas demande ainsi comment il est possible que Dieu soit resté silencieux lors de la Shoah. Des philosophes plutôt continentaux proposent alors de dire que Dieu lui aussi souffre de tout ce mal répandu dans le monde. Dieu n’est préservé du scandale que si les maux horribles du 20e siècle manifestent un retrait du Transcendant. Et des théologiens contemporains ont ainsi proposé la vision d’un Dieu prostré, souffrant, dépassé par le mal. Ce qui certes signifie qu’il n’est pas cet être tout-puissant et omniscient décrit par le théisme traditionnel. Auschwitz nous contraindrait à reconsidérer la métaphysique obsolète du théisme tout-puissant et omniscient : Dieu est faible. C’est le Dieu kénotique : « Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes » (Phil, 2 : 7). Les philosophes et théologiens de la religion ont eux aussi pris le problème du mal très au sérieux.
À cet égard, Herbert McCabe et Brian Davies, dont je vais examiner ici les réflexions au sujet du mal, se distinguent nettement. Tous les deux ancrent leur réflexion dans la pensée de Thomas d’Aquin. Pour Davies, « si Thomas a raison, alors le problème du mal n’est pas du tout sérieux, mais résulte plutôt d’une façon confuse de penser Dieu »3. Mais comment est-il possible que ce que les philosophes continentaux et analytiques tiennent pour une question fondamentale puisse n’être pas un problème sérieux ? Pour répondre à cette question, il faut en poser une autre : « Dieu est-il un agent moral ? ». Davies dit que « la question, autrefois et encore aujourd’hui, semble être de savoir si Dieu agit moralement ou non, avec “agir moralement” signifiant : agir moralement comme il se doit pour une personne dont l’action satisfait à des devoirs moraux, à des obligations et lois morales »4. Pour la plupart des philosophes et théologiens contemporains, qu’ils soient donc analytiques ou continentaux, il est en effet acquis que Dieu est un agent moral et même l’agent moral parfait. Le problème du mal pourrait être reformulé comme celui de l’incompatibilité de Dieu en tant qu’agent moral et de l’évidence du mal dans le monde.
Mais Dieu est-il un agent moral ? La réponse négative va reposer sur le diagnostic d’un certain anthropomorphisme qui s’est imposé dans la philosophie moderne et contemporaine s’agissant de comprendre l’action divine. Cet anthropomorphisme résulte d’un présupposé métaphysique : Dieu serait une personne. Le théisme se veut personnaliste. Or, McCabe et Davies ne partagent pas cette conception, ni avec les philosophes analytiques, amis ou ennemis du christianisme, et pas plus avec les philosophes continentaux qui souvent la présupposent, même sans clairement l’affirmer. Comme le dit Davies :
… bien que la formule « Dieu est une personne » soit traitée comme un axiome par la plupart des philosophes de la religion dans le monde anglo-américain, il n’est en rien traditionnel, excepté dans le contexte des discussions au sujet de la doctrine de la Trinité (laquelle certainement n’affirme pas que Dieu est trois personnes en une). Pour ce que j’ai pu découvrir, « Dieu est une personne » apparaît pour la première fois en anglais au XVIIe siècle, et cette formule se trouve dans le rejet unitarien de la doctrine de la Trinité (un certain John Biddle fut accusé d’hérésie en 1644 pour avoir dit que « Dieu est une personne ») ; c’est bien ce que je dis : ce n’est pas une formule traditionnelle5.
Si McCabe et Davies sont raison, le problème du mal ne témoigne d’aucune faiblesse spéculative du théisme traditionnel, à la différence de ce qui est souvent dit. À l’inverse, le problème du mal témoigne de la faiblesse métaphysique d’un théisme personnaliste qui tend à s’imposer. Et même, à certains égards, c’est cette conception de Dieu comme personne qui a produit ce qui pourrait être simplement le prétendu « problème du mal ». Qu’il y ait du mal répandu dans le monde, aucun doute, mais cela ne veut pas dire que, pour un théiste, il y a un « problème du mal ».
Dans un article intitulé « Evil » (1981), McCabe examine les accusations faisant de Dieu l’auteur du mal. Il peut s’agir du « mal souffert », résultant de l’ordre créé des choses (un tremblement de terre), ou du « mal fait », résultant de l’initiative humaine (un assassinat). Si Dieu est la cause de tout, alors l’initiative humaine mauvaise elle-même et les actions humaines en résultant dépendent de lui ; au moins Dieu ne les empêche pas. Ce qui rendrait coupable le Dieu omnipotent et omniscient du mal en général – et coupable par omission aussi des péchés humains ; car, autoriser le péché n’est-il pas, d’une certaine façon, en être coupable ? L’athée peut dès lors ricaner. Toute cette doctrine du théisme classique est simplement dépourvue de sens si ce Dieu tenu pour tout-puissant est sinon un pousse-au-crime du moins co-responsable du mal fait.
À l’encontre de cette conception qui conduit aisément à l’athéisme, McCabe affirme que « Dieu fait advenir tout ce qui est bon, et il ne fait directement advenir rien qui soit mauvais ; si cela peut être montré, c’est une défense suffisante de Dieu, semble-t-il, même s’il y a alors bien des choses que nous ne comprenons pas »6. Mais justement, cela peut-il être montré ? McCabe dit que « la méchanceté est tout à fait réelle, même si ce n’est pas le nom d’une substance comme du lait ou même le nom d’une qualité comme d’être rouge »7. Dans la lignée thomiste, le mal est à comprendre comme une privation ou un défaut, l’absence d’une qualité ou d’une forme normalement requise par la nature d’une chose. McCabe indique que « puisque la méchanceté est un défaut, elle est toujours un parasite du bien »8. Il resterait cependant à expliquer pourquoi un Dieu bon, et dont l’œuvre créatrice – dans laquelle nous, êtres humains, faillibles et pécheurs, sommes compris – est nécessairement bonne, laisserait une telle privation (défaut, manque) advenir. Et surtout comment Dieu peut laisser cette privation se manifester sans être lui aussi moralement coupable d’un tel mal. Comment montrer que cette théorie du mal comme privation du bien ne conduit pas à minimiser la réalité du mal dans les choses créées, entamant finalement la moralité de Dieu ?
« Le mal moral est une imperfection dans l’activité de cette sorte d’êtres qui gouvernent leurs opérations »9, dit McCabe dans God and Evil in the Theology of St Thomas Aquinas. Seule une forme humaine de vie peut être moralement bonne ou mauvaise – si nous laissons de côté le cas de la forme de vie angélique. Le pot de fleurs tombant d’une fenêtre sur la tête d’un passant ou le lion dévorant une gazelle (lui infligeant la pire douleur) ne peuvent pas être moralement bons ou mauvais. Et Dieu ? Affirmerait-on qu’il « gouverne ses opérations », à la façon dont un homme le fait, ou qu’il ne les gouverne pas toujours comme il faudrait, tout comme les hommes ? Pouvons-nous comparer ce qu’il fait avec ce qu’il aurait dû faire ? (Que nous connaissons, bien sûr, éclairés comme nous sommes.) Mais, premièrement, McCabe remarque que pour un être dont la perfection n’est pas distincte de son essence, cela n’a pas de sens de dire qu'il est mauvais. (Tout défaut est impossible quand l’essence et l’être ne sont pas distingués – être, c’est être parfait.) Deuxièmement, comme ce qui est mauvais est une privation dans la chose créée, le défaut de moralité ne peut pas concerner le créateur de toutes choses, seulement un être humain (ou un ange). Ce n’est pas que le créateur est nécessairement bienveillant et aimant à la façon dont certains êtres humains peuvent l’être et même doivent l’être. Comme le dit McCabe, « c’est un non-sens blasphématoire de dire que Dieu est mauvais, et c’est tout aussi inapproprié de dire qu’il est moralement bon »10. La bonté de Dieu n’est pas morale – elle ne tient pas à ce qu’il fasse comme il faut, ou qu’il s’efforce de faire au mieux ou, plus absurde encore, qu’il suive à la lettre (peut-être, allons-y carrément, autant qu’il lui est possible) ses propres commandements !
À la lecture des Psaumes, une objection semble pourtant s’imposer contre ce qui vient d’être dit : « Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité » (Ps, 103 : 8). Que Dieu soit un être moral n’est-il pas une évidence biblique, que ce soit pour un juif ou un chrétien ? Dans The Kindness of God, Janet Soskice dit que la Bible décrit quelquefois « un Dieu qui cajole, punit, apaise, prévient et aime ; et dans notre expérience, ce sont des êtres humains qui avant tout font ces choses »11. Mais elle précise que cela est dit métaphoriquement. Et ainsi, il n’est pas impliqué que Dieu soit moralement bon et mauvais comme nous pouvons l’être. Il n’est pas impliqué non plus que Dieu puisse être l’objet d’un jugement moral, pour le justifier ou le condamner. Ainsi, ce statut métaphorique de la description de Dieu comme agent moral exclut qu’elle soit présupposée dans la formulation du problème du mal. « Dieu est lent à la colère et plein de fidélité », et nous connaissons aussi des êtres humains qui le sont. Nous pourrions dire qu’il l’est encore mieux ou parfaitement, la description n’en reste pas moins métaphorique ! Autrement dit, elle ne dit pas comment est Dieu, mais elle offre une formulation qui peut avoir son importance pour nous, sans constituer une description littérale.
Dans un contexte, ce que nous voulons ou non, ce que nous faisons ou non, peut être moralement significatif ; du fait de ce que nous sommes, de notre nature, il est bon ou mauvais pour nous de le vouloir ou non, de faire ou non ce que nous voulons et faisons. Pour Dieu, quel sens cela aurait-il ? Les êtres humains vivent dans un contexte moral, Dieu non. Il n’est même pas dans un quelconque contexte ; car seules les choses de ce monde sont dans un contexte, non pas le créateur de toutes choses. Dès lors, louer ou blâmer Dieu pour ce qu’il veut ou ne veut pas, pour ce qu’il fait et ne fait pas, est absurde. « Il n’y a rien qui soit naturel pour Dieu de faire, et rien qui ne le soit pas »12, dit McCabe. Ainsi, rien qui soit moral pour Dieu de faire ni rien qui soit immoral. La moralité nous concerne nous, pas Lui.
Prétendre juger de la moralité de Dieu est une erreur de catégorie13. En disant que Dieu est un agent moral, ce n’est pas tant que nous utiliserions une mauvaise catégorie – comme nous le ferions par exemple en disant que le nombre 3 est en pleine forme aujourd’hui. Quand Dieu est considéré comme un agent moral, l’erreur de catégorie consiste à penser en termes de catégorie, et non pas seulement à en utiliser une qui soit inappropriée. Quand nous décrivons Dieu et l’action divine, ou que nous prétendons le faire, nous ne pouvons pas utiliser une catégorie applicable aussi à d’autres êtres. Certes, nous n’avons pas d’autre catégorie à notre disposition. On peut objecter alors que nous ne pouvons pas faire autrement sinon d’utiliser des catégories. La réponse est que de notre incapacité de renoncer aux catégories habituelles pour parler de Dieu ne permet pas de conclure quoi que ce soit au sujet de la nature de Dieu. Particulièrement, cela ne doit pas entraîner la supposition qu’il est un agent moral parfait. Quand Richard Swinburne, par exemple, dit qu’« un théiste soutient normalement que Dieu est par nature moralement parfaitement bon »14, il fait cette erreur de catégorie. Car cela supposerait que nous prétendrions connaître la nature morale de Dieu ; et aussi que nous exigions de lui qu’il agisse selon la nature morale que nous lui attribuons. Mais comme le dit McCabe, pour ce qui est de Dieu, nous « ne pouvons avoir des devoirs ou une façon de vivre, […] une fonction, […] une place dans un ordre quelconque »15. L’idée que nous avons de Dieu ne peut pas être pour lui la raison qu’il aurait de faire quelque chose. Ce ne peut être qu’une façon tout à fait humaine de parler de Dieu (et pour une grande part elle est métaphorique). Dieu n’a pas de bonnes ou de mauvaises raisons de faire ou ne pas faire, de faire ainsi ou autrement, car « il est la raison de ce qu’il fait »16, dit McCabe.
En ce sens, le problème du mal ne porte pas sur Dieu et le mal, contrairement à ce que croient ceux qui le prennent au sérieux ; c’est plutôt un problème au sujet de la description de l’action divine et du concept de Dieu telle qu’elle apparaît dans la formulation du problème. Le problème du mal ne concerne pas Dieu, à bien y réfléchir, mais la façon dont nous parlons de lui. C’est un réel problème au sujet du langage religieux et non un sérieux problème au sujet de Dieu. Nous sommes certes enclins à parler de Dieu dans des termes que nous appliquons à une personne humaine (et pas seulement, à des animaux non humains aussi), et à penser à l’action de Dieu en termes de nos actions. Il y a un « vertige que nous ressentons à contempler ce monde de douleur et de misère au pouvoir d’un Dieu infiniment bon et puissant »17. Mais plutôt que de reconnaître que Dieu est un mystère pour nous, nous nous cramponnons à une description d’un agent moral comme nous devrions être, mais meilleur que nous et même parfait. Nous essayons d’exonérer Dieu d’une possible faute morale ; ou au contraire nous sommes ironiques (et athées) parce que nous n’y parvenons pas. Thomas d'Aquin quant à lui réalisait bien le risque que le langage religieux nous fait courir. « C’est par le silence que Dieu est respecté – ce qui ne signifie pas que nous ne puissions rien penser ou dire du tout à son sujet, mais que nous devons réaliser qu’il transcende toujours tout ce que nous pensons et disons de lui », disait-il18.
La bonté de Dieu ne consiste pas en sa bonne moralité, celle que vous pourriez attribuer à la voisine, par exemple, en observant ses actions. Imaginons que son comportement soit le sujet d’interprétations divergentes. Certains diraient qu’elle bat ses enfants et donc qu’elle est une mauvaise mère. D’autres diraient que ses enfants méritent bien les fessées qu’elle leur donne et qu’ils doivent apprendre ainsi à se comporter comme il faut. La question serait de savoir, à partir de son comportement, si elle est une bonne mère, et comment elle l’est : fait-elle un mal pour un bien ? Le problème du mal ressemble à cela – et il consiste finalement à demander : « Mais enfin, qu’est-ce qu’il fait ce Dieu supposé être bon ? », comme on le demande d’une mère qui bat ses enfants. Or, la bonté de Dieu ne signifie pas que Dieu est un agent moral ; il n’y a rien qui puisse aller vers le meilleur ou le pire en Dieu, rien qui soit en puissance, comme disent les scolastiques. Une personne pourrait avoir fait quelque chose d’autre que ce qu’elle a fait, quelque chose qui soit meilleur ou pire : il y a ainsi d’autres moyens d’éduquer ses enfants que de les battre, mais on peut aussi les battre plus. Comme membres d'un service social, nous pourrions prétendre conseiller des parents abusifs pour qu'ils soient de meilleurs parents. Mais cela aurait-il un sens d’avoir un service social pour Dieu, enquêtant sur ses agissements, comme certains philosophes et théologiens semblent se sentir tenus de le faire ? Pourrait-on disculper Dieu du mal dans le monde ? Pourrait-on, au besoin, l’aider un peu à s’expliquer, sous la forme d’une théodicée – et surtout après Auschwitz ?
Thomas dit que « puisque Dieu est la première cause efficiente de toutes choses, il est manifeste que l’aspect de bien lui appartient et que toutes choses doivent tendre vers lui »19. Il dit aussi que « si Dieu n’est pas dans le même genre que les autres bonnes choses, ce n’est pas qu’il soit dans un autre genre, mais il est en dehors de tout genre et il est le principe de tout genre ; et donc, il est comparé aux autres par excès, et c’est une telle comparaison que l’expression “souverainement bon” implique »20. C’est précisément parce que Dieu est comparé par excès aux autres êtres rationnels, qu’il s’agisse d’anges ou d’hommes, qu’il n’a pas cette moralité que nous nous efforçons d’avoir. Ainsi, l’idée même de moralité divine est absurde.
Selon McCabe, « quand nous nous demandons si Dieu est bon, nous sommes enclins à penser ainsi : Dieu est une sorte de personne ; et donc la question de savoir si Dieu est bon consiste à demander s’il est une bonne personne, si nous pouvons lui attribuer les caractéristiques des gens qui sont bons » 21. Dans une grande mesure, le problème du mal se pose à ceux qui ne résistent pas à cet anthropomorphisme.
Swinburne dit que « l’affirmation théiste, selon laquelle Dieu est par nature moralement et parfaitement bon, doit être comprise comme disant que Dieu est tel qu’il fait toujours ce qui est […] probablement la meilleure action morale ou la meilleure sorte d’action (quand il y en a une), qu’il fait une action moralement meilleure ou une sorte d’action meilleure quand il y en a une, et qu’il ne fait aucune action qui est probablement une action moralement mauvaise »22. Soyons donc rassurés : Dieu se comporte comme il faut ! Il serait évident que « si Dieu ne faisait pas toujours ce qui, pour lui, est probablement le meilleur (quand il y a un meilleur), sans aussi qu’il ait jamais fait une mauvaise action, il serait moins que parfait »23. Dieu est ainsi compris par Swinburne comme une personne morale au plus haut degré (éminemment). Un théologien préférant parler d’un Dieu bon parce que faible, voire submergé par le mal dans le monde, et compassionné, proposerait une autre description anthropomorphique que celle de Swinburne. Mais cela ne change pas beaucoup de choses sur le fond. L’un comme l’autre, Swinburne et le théologien du Dieu faible savent, apparemment, en quoi consiste pour Dieu d’être une personne morale, même s’ils n’en ont pas la même description. Pour l’un la perfection, pour l’autre une faiblesse appropriée.
Cela fait une différence avec McCabe. Lui est extrêmement suspicieux au sujet de notre description de l’action divine sur le modèle de l’action humaine, seulement meilleure que la nôtre ou avec toute la faiblesse requise par la bonté. Parce que, comme on le voit, cela revient dans les deux cas à aligner le discours au sujet de la bonté divine sur ce qui est possible pour nous et peut être dit à notre sujet. La plupart de ceux pour lesquels le problème du mal est sérieux, particulièrement dans la philosophie analytique de la religion, sont aussi ceux qui disent (ou supposent) que Dieu est une personne (Swinburne, Plantinga, Hasker, les Théistes ouverts24, etc.). La différence entre un être humain et une personne divine est que Dieu n’a pas les limitations des personnes non divines. Cette approche est caractéristique du personnalisme théiste25.
Si je préfère parler de « personnalisme théiste » que de « théisme personnaliste », c’est que cette conception part de la notion de personne pour parler de Dieu. Il y aurait deux sortes de personnes : Dieu (ou les personnes divines dans un Dieu tri-personnel) et les êtres humains. Dieu serait un membre de cette catégorie élargie de personne comprise comme un être ayant un esprit. L’esprit humain est lié de façon contingente à un corps ; mais tel n’est pas le cas de la personne divine. Ce qui est important pour le personnaliste théiste est que Dieu étant une personne sans les limitations des êtres humains, il se comporte (et il doit se comporter) comme une personne moralement décente. La thèse sous-jacente est que Dieu change et éventuellement souffre. Également, pour sa justification morale, on doit montrer que Dieu est bon comme l’est une personne, selon les mêmes exigences. Pour certains philosophes26, s’il était par exemple un « Dieu caché », il désespèrerait ses créatures et les ferait souffrir ; il ne pourrait pas être bon. C’est de nouveau une version du problème du mal. Dieu se doit d’être attentif à ce qui arrive aux personnes à la façon d’un bon père humain.
Mais rejeter le personnalisme théiste ne donne pas de solution à l’objection déjà invoquée : si nous voulons décrire une action divine, comment pouvons-nous faire autrement que d’utiliser ces termes d’intention, de volonté, de désir, qui caractérisent une personne, divine ou humaine ? Dieu est donc une personne. La réponse faite à cette objection peut alors être complétée. Nous parlons de Dieu par analogie. L’usage analogique des termes intention, volonté et désir au sujet de Dieu est inévitable. Mais il ne nous autorise pas à affirmer que Dieu est une personne. Cet usage analogique conduit plutôt à dire que Dieu n’est pas une personne parce que le sens donné à ces termes n’est pas univoque, mais analogique. Dieu pense, certes, mais pas comme nous ; il veut, mais pas comme nous. L’analogie explique l’usage des mêmes termes au sujet d’un être qui n’est pas nous, en particulier n’est pas une personne.
Notre vocabulaire psychologique caractérise une forme de vie dans la communauté humaine. Certes nous disons qu’un chien veut quelque chose ou désire faire une promenade. C’est que pour caractériser son comportement nous sommes tentés de parler des animaux non humains comme nous parlons des êtres humains. Cela a un sens, parce que nous avons bien des choses en commun avec les animaux27. L’usage d’un vocabulaire est ainsi étendu à des êtres autres que les hommes. Mais avec Dieu, cet élargissement est encore plus incertain parce que cette extension par comparaison n’est pas possible. Il n’y a pas de langage approprié à la description de ce que Dieu fait ! Les Grecs pouvaient décrire leurs dieux et leurs actions, parce qu’il y avait une communauté incluant des humains et des dieux : les humains et les dieux pouvaient même avoir avec les dieux (et déesses) des relations sexuelles ; les deux sortes d’êtres pouvaient se disputer, collaborer, se tromper, etc. Mais le Dieu chrétien, celui sans lequel il n’y aurait rien, n’est pas un être parmi les autres dans une communauté élargie à des animaux et à des dieux. Nous pouvons intelligiblement dire que ce que Dieu fait n’est pas sans raison, que ce n’est pas involontaire, que Dieu pense et veut ; cependant, parler de cette façon n’est pas indiquer les raisons de Dieu et décrire ses volontés comme s’il était une personne humaine sans nos limitations humaines (et pas plus sans des limitations angéliques).
Si ce qui vient juste d’être dit contre l’idée que Dieu est un agent moral est correct, alors on pourrait être tenté d’adopter une autre attitude que McCabe décrit ainsi :
Dieu transcende tout pouvoir humain et toute pensée humaine, et on ne devrait pas s’attendre à être capable de le comprendre, lui et ses œuvres. Toute tentative en ce sens, celle d’examiner le mystère par les seules méthodes humaines d’analyse, est impie, et sa folie se montre en ce qu’elle est absurde et qu’elle se contredit elle-même. La théologie chrétienne reconnaît que toutes les actions de Dieu dans sa création sont absurdes en ce sens, mais par le don de la foi le théologien est à même d’accepter cette absurdité et de transcender ce qui n’est guère que sa simple rationalité28.
Le « don de la foi » suspendrait la recherche d’une solution au problème du mal en renonçant à donner des raisons que Dieu aurait d’autoriser le mal. C’est en particulier une solution au « problème existentiel du mal » (il peut aussi être dit « pratique » ou « émotionnel ») ; nous y ferions face quand nous sommes confrontés à un mal terrible dans nos vies ou dans les vies des autres, particulièrement chez nos parents, dans notre famille ou chez nos amis proches. Cette solution est « quiétiste »29 : nous devrions renoncer à toute élaboration théorique au sujet de Dieu, et aussi au sujet du mal.
Une attitude de cette sorte peut prendre au moins deux formes. L’une, inspirée par Wittgenstein, se trouve dans la pensée de Dewi Z. Phillips30. Nous ne pouvons parvenir à des solutions concernant des problèmes métaphysiques ou théologiques, et parmi eux le problème du mal : dès lors, la théologie rationnelle, à la façon d’Anselme de Canterbury ou de Thomas d’Aquin, quand Dieu est pensé comme l’Être, est simplement confuse. Mieux vaut l’abandonner. Nous ne pouvons rien dire au sujet de Dieu pour de bonnes raisons, et donc pas même que « Dieu est bon ». Quand cela est dit, ce n’est pas pour affirmer que Dieu a un certain attribut, celui d’être bon : la « grammaire de Dieu » n’est pas descriptive, au sens où le serait une théorie scientifique (si tant est que nous devions même dans ce cas le prétendre). Cette grammaire est pratique : elle concerne ce que nous faisons et comment nous vivons en parlant de Dieu. Nous ne décrivons pas une réalité transcendante. Nous sommes dans une forme de vie, voire une certaine pratique. Dès lors, nous devons être détachés – quiets – au sujet du problème théorique du mal, même si nous ne sommes pas détachés au sujet des maux concrets.
L’autre forme de cette attitude, ou qui en est proche, est héritée de Heidegger et se place sous l’influence de la théologie phénoménologique de Jean-Luc Marion31. C’est la forme continentale de cette attitude. Ce n’est pas un quiétisme pratique, mais un quiétisme phénoménologique. Rien ne serait signifiant dans notre relation à Dieu sinon la foi comprise comme une expérience phénoménale (celle de « saturation » de la signification, selon Marion). Alors toutes les raisons que nous pourrions donner pour garantir la moralité de Dieu malgré le mal (ou pour montrer que le mal résulte, en un sens, de sa justice) doivent être rejetées. Parce qu’elles limitent Dieu, en faisant de lui un objet de nos intellects. Elles sont onto-théologiques.
L’attitude qu’il s’agit ici de caractériser, par référence à Phillips et à Marion, ferait ainsi passer du « problème du mal » à un rejet de la théologie rationnelle que nous trouvons chez Thomas. Celui qui rejette le problème du mal serait conduit à renoncer à la théologie rationnelle (traditionnelle).
Toutefois, le rejet par McCabe et Davies de la conception personnaliste de Dieu (répandue dans la philosophie analytique de la religion) ne conduit pas à renoncer aux problématiques classiques de la théologie rationnelle. Ce n’est pas le rejet de ce qui est désigné, négativement, comme onto-théologique. Le titre donné au livre de McCabe, Faith within Reason [La Foi dans la raison], dit suffisamment qu’un adieu à la théorie ou même à la raison n’est pas du tout ce qu’il propose. McCabe pense avec Thomas que nous pouvons expliquer pourquoi Dieu est présent dans tout ce qui existe et dans tout ce que nous faisons – Dieu est ce sans quoi rien ne serait – et aussi pourquoi Dieu n’est en rien responsable du mal et n’a pas à être absous d’un mal qu’il n’aurait pas pu ou su prévenir. Pourtant, parler intelligiblement de la réalité de Dieu et de l’action de Dieu ne revient pas à dire ce qu’est Dieu, mais ce qu’il n’est pas. Et aussi pourquoi il n’est pas comme une créature, pas même en beaucoup mieux.
Ainsi, McCabe et Davies ne se font pas les avocats d’un quiétisme, qu’il soit pratique (à la Phillips) ou phénoménologique (à la Marion). Certainement, nous pouvons échouer à comprendre pourquoi Dieu permet le mal. Quoi qu’il en soit, dit McCabe, « le problème du mal n’est pas une question au sujet de ce que nous sommes prêts à autoriser Dieu à faire […], c’est une question au sujet de ce que notre langage nous autorise à dire »32. Nous ne pouvons pas dire pourquoi Dieu agit d’une façon ou d’une autre, comme nous pourrions le dire au sujet d’une personne humaine. Une description négative de Dieu (ce qui veut dire une description de ce qu’il n’est pas) pourrait simplement « nous apporter une sorte de compréhension des actions de Dieu dans le monde – une compréhension suffisante au moins pour que nous soyons capables de dire que le plan de Dieu ne revient pas à une absurdité »33, même si la « reconnaissance de l’action de Dieu n’enlève rien au mystère de ce monde »34. McCabe dit aussi :
De la même façon que, à mon sens, les Quinque Viæ [dans la Somme théologique de saint Thomas] ne cherchent pas à expliquer comment le monde vient à être par l’invocation de Dieu, la théorie du mal de saint Thomas, que j’ai décrite [dans God and Evil], ne cherche pas à expliquer le mal dans le monde. Quand nous parlons de Dieu, nous ne résolvons pas une énigme ; nous attirons l’attention sur un mystère35.
Il est possible d’attirer l’attention sur un mystère sans encourager le quiétisme ni jeter le discrédit sur la théologie rationnelle. Il s’agit alors de comprendre ce qui peut être intelligiblement dit au sujet de Dieu ; c’est aussi remarquer qu’à cet égard les Mystères de la tradition chrétienne sont éclairants.
McCabe est très attentif au langage théologique. Il fut le coéditeur des deux questions de la Somme théologique expressément dévolues à la façondont nous parlons de Dieu36. Il dit aussi :
Les actions de Dieu à l’égard de ses créatures ne transcendent pas absolument la compréhension des théologiens, parce qu’ils sont des gens de foi, et la foi ne consent pas à l’absurde, mais accepte ce qui nous est obscur et caché du fait de la faiblesse de nos esprits. La foi n’est pas l’abdication de toute connaissance ; elle reste dans l’ordre de la connaissance […]. C’est pour cette raison que la foi nous apporte une sorte de compréhension des actions de Dieu dans le monde, au moins est-elle suffisante pour que nous puissions dire que le plan de Dieu n’est pas une absurdité37.
Le « mystère de la foi » (1 Tim, 3 : 9) ne s’oppose pas à la raison, ce n’est pas un appel à une expérience éthérée nous transportant au-delà ce qui peut se dire – à la différence de ce que prétend la conception moderne des états mystiques comme expérience de l’absolu. Il y a une façon de comprendre l’action divine qui ne fait pas de lui une super-personne, qui ne cherche pas à expliquer comment Dieu agit en termes de notre manière d’agir. Néanmoins, à la différence d’un quiétiste, on ne renonce pas à dire qu’il y a des affirmations vraies au sujet de Dieu (et donc aussi des affirmations fausses). Une description négative est encore une description. L’apophatisme n’est pas l’aphasie. Nous disons beaucoup de Dieu et prétendons savoir de lui quelque chose quand nous disons ce qu’il n’est pas. Comme le dit Denys Turner :
Thomas pense que la raison elle-même, au moyen de ses propres capacités de preuve, sort de sa zone de confort et entre dans le mystère du divin, qui se situe entièrement au-delà de ses propres limites. C’est ainsi que les instincts apophatiques bibliques de l’Exode et du Livre d’Isaïe convergent avec le résultat d’un argument rationnel au sujet de l’unique mystère de Dieu38.
Il est souvent dit dans la Bible que Dieu aime sa création. Néanmoins, « ce que nous ne pouvons pas faire, c’est penser à Dieu comme se donnant lui-même à aimer à une créature »39, dit McCabe – d’un amour de la même sorte que celui entre deux êtres humains, et qui suppose une certaine égalité. Nous aurions tort de lui attribuer cet état mental de ceux qui s’aiment. Le Mystère de la Foi est alors le Mystère de Dieu, et il consiste, par exemple, à donner un sens à cette affirmation « Dieu nous aime », même si nous sommes incapables de donner une théorie de cet amour, au sens d’une justification ou d’une explication.
Davies demande : « Maintenant, qu’est-ce que pourrait précisément signifier qu’en parlant de Dieu nous devions être attentifs de ne pas lui attribuer quelque chose qui est essentiellement de l’ordre du créé, quelque chose qui ne puisse être vrai de ce qui est invoqué pour que, simplement, il y ait un univers »40 ? Victor White, qui (comme Régent des Études dans le couvent des Blackfriars à Oxford) influença McCabe, disait :
La position de saint Thomas diffère de celle des agnostiques modernes en ceci : alors que l’agnosticisme dit simplement : « nous ne savons pas et l’univers est une énigme mystérieuse », un thomiste dit : « nous ne savons pas quelle est la réponse, mais nous savons qu’il y a un mystère derrière tout cela que nous ne connaissons pas, et s’il n’y en avait pas, il n’y aurait même pas d’énigme ». Cet Inconnu, nous l’appelons Dieu. S’il n’y avait pas de Dieu, il n’y aurait pas d’univers qui soit mystérieux, et personne pour être mystifié41.
En disant que « Dieu est amour », nous savons, ou devrions savoir, que nous ne parlons pas de ce qui serait en question en parlant de l’amour de Roméo pour Juliette, d’un père pour ses enfants, de la souris pour le fromage. Quand nous disons que Dieu est bon, nous ne parlons pas de cette sorte de bonté morale, attribuée par exemple à Jean Valjean, dans Les Misérables de Victor Hugo : après que Valjean a volé l’évêque Myriel, le forçat devient cet homme honnête que l’ecclésiastique, et Dieu par sa voix, lui demandait d’être. Quand nous disons que « Dieu est amour », nous ne savons pas comment est Dieu, s’il est comme une bonne personne morale par exemple, mais nous savons comment Dieu n’est pas. Et c’est ainsi que nous savons réellement quelque chose au sujet de Dieu !
Si quelqu’un d’entre nous est dans une situation où il peut prévenir quelque chose de mauvais qu'il sait devoir arriver, et qu’il n’a pas de doute que son intervention ne rendra pas les choses pires, il est vraisemblable qu’il serait immoral pour lui de ne rien faire. Mais si Dieu est la réponse à la question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, nous n’avons pas de réponse à la question de savoir comment un Dieu tout-puissant, omniscient et parfaitement bon est possible. Dieu est « inconnu » même si nous pouvons affirmer de lui ce que les théistes traditionnels en disent. Selon McCabe, pour saint Thomas, quand nous parlons de Dieu, nous ne savons pas ce dont nous parlons, mais « nous avons recours au langage à partir du contexte familier dans lequel nous le comprenons et l’utilisons pour aller, au-delà de ce que nous comprenons, jusqu’au mystère qui environne et soutient le monde que nous comprenons partiellement »42. Il ajoute que « pour saint Thomas, la métaphore est le cœur du langage religieux, mais en elle-même elle ne peut être suffisante », mais aussi « qu’elle doit être soutenue par des assertions analogiques non métaphoriques comme celle que Dieu existe, que Dieu est bon, qu’il est aimant, que Dieu est la cause créatrice du monde et qui fait qu’il continue d’être »43.
Dès lors, avoir des doutes au sujet du sérieux du problème du mal ne revient pas à renoncer à la théologie rationnelle ou à aligner la philosophie de la religion sur une phénoménologie de l’expérience religieuse. Comme le dit Thomas, « l’esprit se trouve être plus parfaitement en possession de la connaissance de Dieu quand il est reconnu que son essence est au-dessus de tout ce que l’esprit est capable d’appréhender dans cette vie »44. Savoir que Dieu est inconnu n’est pas ne rien connaître : le Mystère de Dieu, si manifeste dans la question du mal, est une lumière. Et que Dieu soit bon n’est pas incompatible avec l’existence du mal si cette bonté n’est pas identifiée à une moralité humaine sans défauts.
Mais Jésus n’est-il pas la réalisation même d’une moralité parfaite que nous imitons ? L’objection revient de nouveau, cette fois sous cette forme : la critique de l’anthropomorphisme théologique ne doit pas conduire à abandonner l’idée de Dieu comme agent moral en la personne de Jésus.
Cependant, je doute encore que l’objection à la perspective de McCabe et de Davies soit correcte en étant cette fois réorientée vers Jésus. Derechef, la réponse à cette objection va consister en une réflexion sur le langage de la foi. Selon McCabe :
Le fait que Jésus était humain signifie qu’il y a tout un registre de prédicats tels que « avait faim », « était amusé ou « était torturé », susceptibles à juste titre d’être rattachés au sujet « Jésus » pour faire des propositions littérales ordinaires pouvant être vraies ou fausses. Je veux dire qu’il nous est possible d’appliquer à juste titre ces prédicats à Jésus, alors que nous ne pourrions les appliquer à un bonbon au caramel ou à une étoile. De la même façon, le fait que Jésus soit divin nous autorise à parler de lui dans un autre registre de prédicats, tels que « est créateur », « est le fils éternel de Dieu », « est omnipotent », etc. La doctrine traditionnelle de l’incarnation est simplement que les deux registres de prédicats s’appliquent à cette même personne [de la Trinité] à laquelle le terme sujet « Jésus » fait référence45.
Comme McCabe le dit aussi, tout cela devient sérieux, sans en rien être contradictoire, dès que nous acceptons la doctrine des deux natures pour parler de Jésus-Christ comme un homme, et de Jésus-Christ comme Dieu. Ces deux natures « ne sont pas dans le même univers (et même le divin n’occupe aucun univers), elles ne s’excluent pas l’une l’autre à la façon dont deux natures créées le feraient »46. À la différence de ce que disait Ernest Renan : il affirmait que Jésus n’est pas le fils de Dieu, mais l’exemple le plus parfait de la moralité humaine. Il disait que « Jésus reste pour l’humanité un principe inépuisable de renaissances morales »47. Renan a fait de nombreux émules ; et sa thèse est même devenue une sorte d’évidence des sciences humaines et sociales. Sa conception morale du Christ est typique d’un athéisme moderne qui prétend se délivrer du mythe du Dieu incarné pour ne retenir que la construction morale d’une religion de l’humanité. Pour être moralement exemplaire, Jésus doit représenter le meilleur de l’humanité, et non pas être « Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu » (Symbole de Nicée-Constantinople).
Pour se défaire de cette objection, il est utile de citer Denys Turner :
Dieu et ce qui est créé – donc, Dieu et la créature humaine – ne peuvent se situer dans des relations d’exclusion mutuelle parce que le Créateur et la créature ne peuvent s’exclure mutuellement. Ou, pour le dire autrement, pour Thomas la transcendance de Dieu est si absolue que s’agissant de Dieu et de toute créature, toute possibilité d’exclusion entre eux est exclue. C’est précisément à cause et en dépit de l’absoluité de la différence entre le Créateur et la créature, qu’est concevable la possibilité de cette immanence qu’est l’incarnation, la présence du divin et de l’humain dans l’unique personne du Christ48.
Il ne peut pas y avoir de contradiction entre être pleinement Dieu et être pleinement humain, comme il pourrait y en avoir entre être soi-même (Roger Pouivet) et simultanément être quelqu’un d’autre (par exemple, mon propre père dont je porte à la fois le nom et le prénom). Ainsi, la parfaite moralité humaine de Jésus ne doit pas plus nous faire dire que Dieu est un être moral ; pas plus que nous ne serions tentés de dire que si Jésus mange ou est torturé, Dieu mange ou est torturé. Oui, Jésus mange et est torturé, et il est Dieu. Les deux natures, divine et humaine, sont une dans l’union hypostatique de la seconde personne de la Trinité, et elles sont distinctes, comme le sont le créateur et la créature. C’est dans une conception qui réduit le Christ au statut d’une créature que Dieu devient un être moral. Certainement, il est mystérieux que la même personne puisse être vraiment divine et vraiment humaine. Nous n’avons pas d’explication. Mais ce n’est pas contradictoire de dire que Jésus-Christ réalise pleinement l’exigence morale humaine, et que Dieu n’est pas un agent moral, au sens où un homme l’est.
Selon Davies, « Thomas maintient que nous avons deux façons de parler du Christ, et une seule que nous comprenons (puisque nous ne savons pas ce que Dieu est) »49. Pour éviter toute hérésie anti-chalcédonienne, il convient de ne pas confondre les deux. Les deux natures du Christ ne sont pas « différents aspects de la nature d’une chose »50. Comme être humain, le Christ est un être moral, mais il peut difficilement l’être en tant que Dieu. Pour être moral, vous devez être humain – et vraisemblablement, être humain dans une certaine situation sociale, avec d’autres êtres de la même sorte que vous.
Citons cette fois Thomas d'Aquin :
Quand on dit : « Le Christ, en tant qu’homme, est une personne », si on l’entend du suppôt, il est évident que le Christ, selon qu’il est homme, est une personne, parce que le suppôt de la nature humaine n’est rien autre chose que la personne du Fils de Dieu. Si on l’entend de la nature, on peut le comprendre de deux manières. 1. On peut comprendre qu’il convient à la nature humaine d’être dans une personne, et c’est vrai encore de la sorte. Car tout ce qui est subsistant dans une nature humaine est une personne. 2. On peut entendre qu’il est dû à la nature humaine dans le Christ une personnalité propre résultant des principes de cette nature51.
Pour Davies, Thomas « veut dire que la nature humaine du Christ ne définit pas son existence au sens qu’il y a une existence du Christ selon son humanité et une autre selon sa divinité »52. Dieu est donc un être moral si le Christ est un être moral, mais cela ne signifie pas que le Christ n’est moral que pour autant que la nature humaine définisse son existence, parce que le Christ est une unique existence, divine et humaine. Ainsi, nous ne devons pas penser le Dieu incarné à partir de ce qui est possible pour les personnes humaines. Une nouvelle nature, qui est humaine, ne signifie pas un nouvel être personnel pour le Dieu incarné, « mais seulement une nouvelle relation à l’être personnel préexistant à la nature humaine »53. Les conditions de la moralité humaine ne se réalisent pas en Dieu même quand le Christ s’incarne !
Le problème du mal impose à Dieu la sorte de demande éthique qui est supposée constituer la norme essentielle de la moralité, cette sorte d’attention aux autres que tout mal fait, semble-t-il, mettre en question. Comment Dieu peut-il être moralement bon s’il y a tant de mal ? Mais cette exigence morale s’imposant à Dieu, comme j’ai essayé de le montrer, est absurde. La formule de Wittgenstein est bien connue : « La philosophie est la lutte contre l’ensorcellement de notre entendement par les moyens de notre langage »54. Selon McCabe et Davies, le problème du mal est en fait lié à certaines présuppositions inscrites dans le langage dans lequel nous parlons de Dieu. Comme le dit Davies :
« Dieu » est un mot que les gens comprennent de différentes façons. C’est un terme analogique, pourrait-on dire : un terme que des gens utilisent sans vouloir toujours dire la même chose, sans pourtant signifier toujours quelque chose d’entièrement différent. Mais ils l’utilisent souvent différemment, montrant en cela qu’ils ont différents concepts de Dieu55.