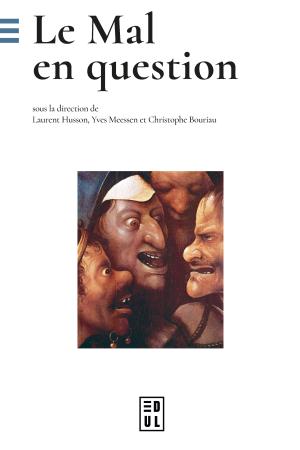
Article traduit de l'allemand par Samson Takpé
Celui qui se penche sur la question du rapport entre le mal et la liberté découvre rapidement qu’elle revêt une importance particulière dans le cadre du problème de la théodicée. En effet, l’enjeu est de savoir à qui le mal – au moins au sens du mal moral – doit être en définitive attribué. Il semble que deux alternatives s’offrent à nous : si l’homme est libre, on peut dire qu’il est aussi l’auteur du mal et qu’il peut en être tenu pour responsable ; s’il n’est pas libre, il n’est pas responsable et il faut déterminer si le mal ne doit pas être imputé à une autre instance : Dieu ou la nature qu’il a créée. Mais alors il faut clarifier comment un Dieu qui apparaît directement ou indirectement comme l’auteur du mal peut encore être considéré comme porteur des qualités que les grandes religions monothéistes lui attribuent traditionnellement.
Il est bien connu que selon la conception chrétienne – tout comme selon la conception juive et islamique – Dieu est tout-puissant, parfaitement bon et omniscient. C’est précisément cette doctrine qui est largement problématisée dans la philosophie du début des temps modernes, et ce, face aux maux du monde. Parmi ceux-ci figure d’abord tout ce qui est source de souffrance pour l’homme, c’est-à-dire la pauvreté, la cruauté, la faim, la maladie, les catastrophes naturelles, l’injustice et l’oppression politiques et sociales, et enfin la mort. Il est évident qu’une partie considérable de ces maux est due au comportement humain, c’est-à-dire qu’ils appartiennent au domaine du mal moral ou de la malice.
Deux événements historiques jouent un rôle important dans le débat sur la théodicée : la guerre de Trente Ans, au cours de laquelle le Saint-Empire romain germanique a perdu la moitié de sa population, ainsi que le tremblement de terre qui a frappé Lisbonne en 1755, tuant 60 000 personnes en très peu de temps. Face à ces catastrophes, il n’est pas étonnant que de nombreux philosophes commencent à se demander comment les maux du monde peuvent être conciliés avec l’idée d’un Dieu à la fois tout-puissant et parfaitement bon. On conçoit aisément l’adoption d’une des alternatives suivantes : Dieu veut empêcher les malheurs mais ne le peut pas, de sorte qu’il n’est pas tout-puissant, ou bien il peut les empêcher mais ne le veut pas, de sorte qu’il n’est pas entièrement bon. On ne peut s’empêcher de soupçonner que les maux du monde soient une raison de nier à Dieu l’une ou l’autre des deux qualités qui constituent, pour ainsi dire, son essence. Dans la philosophie des temps modernes, il existe une série de tentatives pour remédier à cette difficulté. Elles visent à défendre Dieu contre le reproche avancé. Par une expression qui remonte aux étymons grecs θεός (Dieu) et δίκη (droit, justice), une telle justification de Dieu face aux malheurs du monde est généralement appelée « théodicée ».
Manifestement, deux conditions doivent être remplies pour que le problème de la théodicée puisse se poser : la première, que Dieu existe et la seconde, qu’il existe au singulier. S’il n’y avait pas d’être divin, il serait inutile de se casser la tête sur ses caractéristiques. Pour un athée, les maux du monde ne posent aucun problème, du moins dans la mesure où il n’existe pas de Dieu auquel il faudrait demander des comptes. De même, pour les adeptes d’une religion qui suppose l’existence de plusieurs dieux, la question de la justification d’un Dieu unique, tout-puissant et parfaitement bon, ne se pose pas. Et dans les conceptions dualistes, telles qu’on les trouve par exemple dans la gnose, le manichéisme ou la religion iranienne de Zarathoustra, on attribue à un dieu bon les aspects positifs du réel et à un mauvais dieu les aspects négatifs. Si l’on part du principe qu’il existe un nombre encore plus important de dieux, la difficulté peut être évitée de la même manière, et cela vaut également pour la conception d’un dieu ambivalent, qui combine en lui le bien et le mal. Il semble que les religions comme celles que nous avons décrites ont l’avantage d’être d’emblée en accord avec l’état du monde.
On ne peut s’empêcher de se demander pourquoi le monothéisme s’est malgré tout imposé dans une grande partie du monde. Peut-être est-ce dû au fait que l’hypothèse d’un Dieu tout-puissant et parfaitement bon est pour les hommes plus attractive, parce que ce Dieu promet un plus haut degré de salut que les autres dieux. Certes, ce salut aurait lieu dans l’au-delà, mais il serait à même de compenser les malheurs du monde et de donner ainsi un sens à la réalité empirique. L’on peut toutefois douter que le simple attrait d’une religion suffise à lui conférer une force de conviction. Ce qui importe, ce sont plutôt les arguments qui militent en faveur ou en défaveur de la conception selon laquelle Dieu est à la fois tout-puissant et parfaitement bon.
Le premier écrit important consacré au problème de la théodicée est de Leibniz et s’intitule Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal (1710)1. Leibniz est – avec Descartes et Spinoza – l’un des principaux représentants du rationalisme, qui a marqué de manière décisive la philosophie de l’Europe continentale au 17e siècle et une partie considérable du 18e siècle. Ce qui caractérise les rationalistes, c’est qu’ils croient que la raison pure, détachée de l’expérience, est en mesure de fournir une connaissance du contenu de la réalité. Plus encore, cette connaissance est – selon les rationalistes – d’une certitude qui peut rivaliser avec celle de la logique ou des mathématiques.
Comme nous l’avons indiqué, le problème de la théodicée présuppose l’existence d’un être divin, que Leibniz, en tant que rationaliste, tente de démontrer par les moyens de la raison pure. Leibniz présente certes plusieurs preuves de l’existence de Dieu, mais l’argument décisif est l’argument ontologique, parce qu’il s’appuie sur la raison pure, c’est-à-dire qu’il se passe de l’expérience. Dans sa version la plus achevée, cet argument se présente comme suit :
Quelque chose dont l’existence fait partie de l’essence existe nécessairement ;
Dieu est quelque chose dont l’existence fait partie de son essence ;
Donc Dieu existe nécessairement2.
Parce que Leibniz voit en Dieu le créateur du monde, il lui attribue un intellect, une volonté et un pouvoir. Selon lui, en effet, Dieu a besoin d’un intellect pour connaître les mondes possibles qui se donnent à réaliser, d’une volonté pour se décider pour l’un d’entre eux, et enfin d’un pouvoir pour amener ce monde à l’existence. Leibniz est convaincu que Dieu est un être parfait, ce qui signifie pour lui qu’il en va de même des trois facultés mentionnées. C’est pourquoi il considère Dieu comme tout-puissant, parfaitement bon et parfaitement sage3. Il est alors évident que Dieu est guidé par le principe du meilleur, qui est l’une des formes du principe de raison suffisante. Selon ce principe du meilleur, il est dans l’essence de Dieu de faire constamment ce qui est le mieux. En appliquant ce principe à la création du monde, il en résulte que Dieu ne peut pas ne pas réaliser le meilleur des nombreux mondes qui existent dans sa pensée. Partant, on peut dire que Dieu – selon le principe du meilleur – crée le meilleur des mondes possibles. C’est précisément cette idée qui constitue le pivot de la tentative de Leibniz pour justifier Dieu face aux maux du monde.
Leibniz distingue trois types de maux, le mal métaphysique, le mal moral et le mal physique. En ce qui concerne le premier, ce mal consiste en ce que le monde, dans sa finitude, est moins bon que son Créateur infini. Dans ce sens métaphysique, il appartient à l’essence du monde d’être un mal. La finitude du monde est la condition ontologique préalable du mal moral et du mal physique. Toutefois, ceux-ci ne sont pas nécessaires, mais seulement accidentels.
Leibniz assimile le mal moral au péché. Il est évident qu’il existe un lien étroit entre le péché d’une part et la liberté humaine d’autre part. Si l’homme est libre d’accomplir ou de ne pas accomplir une action, on peut lui demander des comptes, sinon, cela n’aurait guère de sens. Plus encore, si le mal moral peut être imputé à l’homme, il semble que Dieu n’entre plus en ligne de compte comme auteur du mal. Toutefois, si l’on admet conformément au principe de raison suffisante que tout ce qui arrive est provoqué par une cause, il n’est pas facile de comprendre que l’homme soit en mesure d’agir librement. Et la liberté ne peut pas non plus être conciliée d’emblée avec le fait que Dieu est omniscient, qu’il sait d’avance la suite de toutes nos actions. Pour résoudre cette difficulté, Leibniz distingue deux types de nécessité, qu’il qualifie respectivement de nécessité absolue et de nécessité hypothétique. Tandis que la première forme de nécessité se réfère à des états de choses dont le contraire ne peut absolument pas être le cas, comme il s’en trouve par exemple dans la logique ou les mathématiques, la seconde revient à dire que même les événements contingents, ceux qui peuvent être autrement qu’ils sont, ont à leur origine une cause qui les provoque. Pour l’agir humain, cela signifie que l’action est déterminée par des tendances correspondantes. Si cet agir relève uniquement de la nécessité hypothétique, et non de la nécessité absolue, cela suffit à Leibniz pour considérer l’homme comme libre du point de vue moral.
Cependant, l’on pourrait toujours objecter que Dieu semble tolérer le mal moral que, cependant, il n’accomplit pas. Cela signifie que soit il n’est pas capable, soit il ne veut pas l’empêcher, de sorte qu’il faut lui dénier ou bien la toute-puissance, ou bien la toute-bonté. Le philosophe français des Lumières Pierre Bayle qui, par une série de notes dans son Dictionnaire historique et critique (1695-97), a donné l’impulsion pour que Leibniz rédige la Théodicée, affûte cette objection de la manière suivante :
Il ne peut donc convenir à l’être infiniment bon de donner aux créatures un libre arbitre dont l’application, comme il le sait très certainement, les rend malheureuses. S’il leur donne donc ce libre arbitre, il y joint la faculté d’en faire toujours un bon usage, et ne permet pas qu’elles négligent d’utiliser cette faculté en quelque occasion que ce soit : et s’il n’y avait aucun moyen de déterminer le bon usage de son libre arbitre, il leur aurait plutôt enlevé cette faculté que d’assister à ce qu’elle leur fait faire de malheureux4.
Leibniz réplique que Dieu ne se soucie pas du tout de savoir si l’homme est heureux ou malheureux, s’il pèche ou non, mais que sa préoccupation est le monde dans son ensemble, et qu’il l’a organisé selon le principe du meilleur. En d’autres termes, il serait certes possible à Dieu de créer un monde sans mal moral, mais ce monde ne serait pas le meilleur. Si l’on suit cette argumentation, l’on doit également admettre que Dieu a voulu le mal moral. Cependant, Leibniz atténue la rigueur de cette conséquence en faisant la distinction entre une volonté anticipatrice et une volonté subséquente. Tandis que la première se rapporte à chaque bien particulier – par exemple au bonheur de l’homme –, la seconde concerne, selon le principe du meilleur, le monde dans son ensemble. Par conséquent, Dieu ne consentirait au mal moral ou ne le tolérerait que par volonté subséquente, mais pas par volonté anticipatrice. Au vu de ces considérations, la question se pose de savoir dans quelle mesure un monde caractérisé par le mal moral est effectivement préférable à un monde qui en serait exempt. Mais Leibniz estime qu’il serait erroné de vouloir démontrer ce point en détail. Il se contente d’évoquer le principe du meilleur et se replie sur le fait que l’homme n’est pas légitimement en mesure d’investiguer plus avant.
Leibniz justifie le mal physique par plusieurs considérations. Il fait d’abord valoir que le bien prédomine dans le monde. Si le mal physique survient malgré tout, il doit être compris en partie comme une punition pour le mal moral, et en partie comme un moyen de réaliser un plus grand bien. Même les peines éternelles de l’enfer ne représentent pour Leibniz aucune difficulté dans la mesure où elles résultent de l’endurcissement éternel des pécheurs. Décisif est en effet le principe du meilleur, auquel Leibniz recourt également pour rendre le mal physique compréhensible. De fait, le principe du meilleur rend les autres arguments superflus. Car s’il est établi a priori que Dieu a créé le meilleur des mondes possibles, il n’est plus besoin de raisons a posteriori pour disculper Dieu. Ainsi, le principe du meilleur ouvre la possibilité de concilier n’importe quel état de la réalité empirique avec l’existence d’un Dieu tout-puissant et tout bon.
Pour peu que l’on y regarde de plus près, on constate cependant que le principe du meilleur n’est approprié pour défendre Dieu contre l’accusation de permettre le mal moral que si l’existence d’un être divin peut être prouvée par les moyens de la raison pure. En revanche, si son existence est problématique, il n’est pas pertinent de lui attribuer les propriétés nécessaires, comme celle selon laquelle il est dans sa nature de toujours faire le mieux.
Contrairement à Leibniz, Kant ne croit plus que la raison pure suffise pour parvenir à une connaissance du contenu de la réalité. Selon lui, il faut encore y ajouter l’expérience, qui est une synthèse de l’intuition sensible et du concept. Si l’on applique cette compréhension aux objets de la métaphysique traditionnelle, c’est-à-dire l’âme, le cosmos dans son ensemble et Dieu, on constate qu’ils ne peuvent pas être connus théoriquement, faute d’intuition. Dans la perspective de la philosophie théorique de Kant, les affirmations qui se rapportent à ces objets ne sont ni vraies ni fausses, mais dénuées de sens.
S’il en est ainsi, il n’est pas surprenant que Kant rejette les preuves de l’existence de Dieu formulées par la métaphysique occidentale, donc également l’argument ontologique. L’objection décisive présuppose qu’il existe différents types de prédicats : ceux qui expriment ce qui appartient à l’essence d’une chose (les prédicats réels, ou prédicats de la res), ceux qui relient un concept de sujet à un concept de prédicat (prédicats logiques), et ceux qui se rapportent à l’existence des objets. Alors qu’un jugement dans lequel un prédicat réel est attribué à un objet est analytiquement vrai ou faux, un jugement sur son existence ne peut être que synthétiquement vrai, c’est-à-dire basé sur l’intuition de cet objet. Ainsi, il y aurait une contradiction dans l’affirmation qu’un triangle n’a pas trois angles, mais pas dans l’affirmation que Dieu n’existe pas. Pour juger de l’existence d’un objet, il faut aller au-delà de son concept et interroger une autre instance, l’expérience. Or, comme Dieu ne constitue pas un objet d’expérience et qu’il n’existe pas d’autre instance qui permette d’accéder objectivement à son existence éventuelle, on ne peut rien dire de son existence.
L’on pourrait maintenant objecter que, même si l’existence d’un être divin n’était pas établie, il serait possible de défendre le principe du meilleur sous une forme atténuée. Cela reviendrait à affirmer que Dieu, si il existe réellement, ne peut faire que le mieux. Si l’on jette un œil sur le raisonnement de Leibniz attribuant à Dieu cette qualité, on constate qu’il suppose d’abord que Dieu possède un intellect, une volonté et un pouvoir, et qu’il le caractérise comme un être parfait, pour finalement conclure que Dieu ne peut s’empêcher de toujours faire le mieux. Or, les prémisses de cette conclusion ne sont nullement convaincantes. Il est bien possible que telle soit la nature de Dieu, mais cela ne peut certainement pas être prouvé de façon contraignante. On a plutôt l’impression que Leibniz a succombé à un anthropomorphisme, à une projection en Dieu des facultés humaines. Dès lors, le principe du meilleur n’est pas soutenable, même sous sa forme atténuée. Il n’exprime qu’une caractéristique possible, mais pas réelle ou nécessaire, d’un être divin dont l’existence reste de toute façon problématique.
Comme nous l’avons déjà expliqué, Leibniz se sert précisément du principe du meilleur pour rejeter l’objection soulevée par Bayle selon laquelle on ne comprend pas comment un Dieu tout-puissant aurait pu faire à l’homme le don d’une liberté qui lui permettrait purement et simplement d’enfanter le mal dans le monde. Si la preuve de ce principe s’est avérée fragile, il semble que l’aporie suivante se présente : soit l’homme n’est pas libre et il n’entre pas en ligne de compte comme auteur du mal, soit il est libre et il peut décider d’agir moralement bien ou mal, mais sa liberté comme cause du mal n’est pas imputable à lui-même, mais à Dieu. Un Dieu de toute bonté devrait effectivement empêcher un mal qu’il peut empêcher. S’il ne le veut pas, il n’est pas parfaitement bon, et s’il le veut sans le pouvoir, il n’est pas tout-puissant. Le mal moral est ainsi un phénomène qui fragilise fortement les perspectives visant à défendre, par des motifs purement rationnels, la conception théiste d’un Dieu tout-puissant et parfaitement bon.
S’il est désormais établi qu’un recours à la liberté humaine n’est guère approprié pour défendre Dieu contre le reproche de permettre le malheur ou le mal moral, nous n’avons pas encore élucidé comment la liberté doit être comprise pour rendre l’homme responsable de ses actes. Si l’on se tourne à nouveau vers Leibniz, on constate tout d’abord qu’il adopte une position déterministe. Nous avons indiqué que Leibniz énonce le principe de raison suffisante, selon lequel tout ce qui arrive est provoqué par une cause. Pour l’agir humain, cela signifie qu’il est déterminé au même titre que tous les événements de la nature. Ainsi, Leibniz souligne avec fermeté : « Chez l’homme comme partout ailleurs, tout est donc certain et déterminé à l’avance, et l’âme humaine est une sorte d’automate spirituel »5.
La question est de savoir comment cela s’accorde avec la tentative d’imputer le mal moral à la liberté de l’homme. Leibniz introduit deux distinctions pour atteindre ce but : d’une part, il distingue la liberté d’action et la liberté de volonté, et d’autre part, comme on l’a vu, la nécessité hypothétique et la nécessité absolue. Pour ce qui est de la première distinction, elle revient à dire que l’homme est libre d’agir comme il le souhaite dans certaines circonstances. C’est précisément le cas lorsqu’aucun obstacle extérieur ne s’oppose à sa volonté. Leibniz reconnaît à l’homme ce type de liberté, à savoir la liberté d’action. Bien sûr, le fait que l’homme puisse faire ce qu’il veut ne signifie nullement qu’il dispose aussi du libre arbitre. Celui-ci consiste en ce que l’homme peut déterminer ce qu’il veut. C’est précisément ce que Leibniz conteste :
On ne peut donc pas vraiment dire du vouloir lui-même qu’il est un objet du libre arbitre. En termes exacts, nous voulons agir et non pas vouloir, sinon nous pourrions continuer à dire que nous voulons avoir la volonté de vouloir et ainsi de suite in infinitum6.
En conséquence, il est tout à fait possible que l’homme agisse au sens de la liberté d’action sans contrainte extérieure, mais tout en étant déterminé par ses penchants – donc de l’intérieur. Mais si l’homme n’a pas d’influence sur ses penchants, s’il est simplement déterminé par eux, il semble difficile de le rendre responsable de ses actes – et donc du mal moral. C’est dans ce sens que Kant fait valoir contre Leibniz :
[S]i la liberté de notre volonté n’était autre que cette dernière (s’il s’agissait d’une liberté psychologique et comparative, et non pas d’une liberté transcendantale, c’est-à-dire absolue sous tout rapport), elle ne vaudrait au fond rien de mieux que la liberté d’un tournebroche qui, une fois élevé, exécute lui aussi de lui-même ses mouvements7.
Cependant, il reste encore à Leibniz la possibilité de relativiser la détermination de l’agir humain par les inclinations qui constituent sa volonté. Il y parvient en faisant la différence entre une nécessité hypothétique et une nécessité absolue. Alors que la seconde se rencontre dans des états de choses dont le contraire ne peut absolument pas être le cas, par exemple en logique ou en mathématiques, la première concerne les événements contingents qui sont déterminés par des causes. Assurément, la détermination d’événements empiriques tels que les actions humaines n’est pas nécessaire au sens strict du terme, comme c’est le cas pour les faits logiques ou mathématiques qui ne peuvent être autres qu’ils ne sont. Cependant, Leibniz fait un pas de plus en expliquant que l’homme est en définitive libre, malgré la détermination de ses actions par ses inclinations :
Il y a donc une liberté de l’accidentel ou une liberté fondée sur l’indifférence, où l’on entend par indifférence l’absence de contrainte pour telle ou telle décision ; mais il n’y a jamais d’équilibre indifférent, c’est-à-dire d’état où les conditions sont complètement égales de part et d’autre, et où il n’y a pas d’inclination plus forte pour l’un des côtés. Une infinité de mouvements, grands et petits, en nous et hors de nous, agissent sur nous, la plupart du temps sans que nous nous en rendions compte. J’ai déjà signalé que lorsque nous sortons d’une pièce, il y a des raisons qui nous poussent à poser un pied précis en avant, sans que l’on y prenne garde8.
Il est évident que la distinction entre nécessité hypothétique et nécessité absolue est inapte à fournir un refuge à la liberté de l’homme. Pour qualifier un événement de déterminé, personne n’exigera sérieusement qu’il se produise avec une nécessité absolue. La nécessité des événements empiriques consiste dans le fait qu’ils se déroulent selon les lois de la nature, et ces événements sont nécessaires mais si la validité de ces lois est simplement hypothétique. C’est pourquoi il semble inapproprié de qualifier les événements empiriques de libres au motif qu’ils ne sont pas absolument nécessaires, mais hypothétiquement seulement. Leibniz invoque un degré de nécessité que l’on ne peut reconnaître aux événements empiriques si l’on veut garantir la possibilité de leur liberté, du moins si l’on veut assurer la liberté des actions humaines.
En résumé, Leibniz tente d’une part de doter l’homme de liberté afin de l’accuser du mal moral, mais d’autre part, il ne fournit pas une conception convaincante de la liberté humaine. La simple liberté d’action au sens où il la définit ne suffit pas pour rendre l’homme responsable du mal. Sa tentative de briser le déterminisme de l’agir humain en ne lui attribuant pas une nécessité absolue, mais une nécessité hypothétique seulement, ne sauve pas la liberté. Ainsi, Leibniz adopte une position qui ne favorise guère son projet de justifier Dieu face aux maux du monde.
Pour finir, il convient d’aborder deux questions qui sont restées jusque-là sans réponse. La première est de savoir si l’homme est réellement libre ou non. Même si tout porte à croire que, quelle que soit la réponse à cette question, Dieu est responsable du mal, la question de la liberté est trop importante, également pour des raisons d’ordre éthique, pour être simplement évacuée. Si l’on jette un œil sur la littérature faisant autorité en la matière, on peut constater que les nombreuses tentatives pour défendre ou réfuter la thèse de la liberté humaine avec des arguments théoriques sont vouées à l’échec. En effet, pour montrer que tous les événements sont déterminés, deux conditions devraient être remplies : premièrement, tous les événements devraient être connus et, deuxièmement, il faudrait apporter la preuve que chacun d’entre eux est effectivement provoqué par un autre selon une loi causale. Or, cela n’est manifestement pas possible. Ceci est dû, d’une part, au fait que le nombre des événements est infini et, d’autre part, au fait que les lois causales ne sont valables que de façon hypothétique. Même si un événement pouvait s’expliquer de manière causale, cela n’impliquerait pas qu’il soit réellement déterminé. Pour affirmer cela, il faudrait que la loi causale selon laquelle il se produit ait un degré de certitude plus élevé qu’une simple hypothèse. D’autre part, il est tout aussi inapproprié de souligner, en faveur de la liberté humaine, qu’il existe des actions qui ne peuvent pas être expliquées de manière causale. Le fait qu’il n’existe pas d’explication de ce type pour un événement à un moment donné n’exclut nullement la possibilité que l’explication soit fournie ultérieurement. Or cela signifie qu’une réalité déterminée est en fin de compte tout aussi pensable qu’une réalité indéterminée, sans qu’il soit possible d’apporter une preuve rigoureuse en faveur de l’une ou de l’autre alternative9.
Néanmoins, il semble que l’indéterminisme soit plus convaincant que le déterminisme. Cela tient tout d’abord au fait qu’il implique une hypothèse plus faible – et donc plus facile à justifier. Alors que le déterminisme affirme que tous les événements sont déterminés par des lois causales, l’indéterminisme peut se contenter d’affirmer que ce ne sont pas tous les événements, mais seulement quelques-uns qui possèdent cette propriété. Qui plus est, on n’est nullement obligé de considérer le comportement humain comme libre dans son ensemble, on peut considérer qu’il l’est seulement en partie. Bien que cette position – considérée théoriquement – ne constitue qu’une possibilité, il existe un certain nombre de raisons pratiques qui la rendent très plausible. Outre le fait que la plupart des hommes se considèrent comme des êtres libres et se comportent en conséquence, il existe des domaines du comportement humain qui ne peuvent guère être appréhendés de manière adéquate sans l’hypothèse de la liberté.
En effet, si l’on se penche sur le phénomène de la connaissance, on s’aperçoit qu’il est fondamentalement marqué par la condition de la liberté. Si quelqu’un fait une déclaration cognitivement pertinente et vraie, cela signifie qu’il s’est convaincu par des motifs que le fait affirmé est effectif, et qu’il porte le jugement correspondant par consentement libre – et non par contrainte. En cas de contrainte en revanche, le jugement ne pourrait être pris plus au sérieux que l’opinion d’une personne sous l’influence de drogues ou d’une grave maladie psychique – une personne qui n’a donc aucune possibilité de juger autrement qu’elle ne le fait. Il est évident que des processus tels que l’argumentation et la persuasion dépendent également du prérequis de la liberté. Si l’on supposait que l’homme est déterminé, ce serait une vaine entreprise d’essayer de convaincre quelqu’un d’approuver un jugement vrai. En effet, la personne qu’il s’agirait de convaincre serait constituée de telle sorte qu’en elle, la manière de juger dans les diverses circonstances serait déjà déterminée. De plus, la personne qui prendrait l’initiative d’une tentative de persuasion serait elle aussi déterminée à défendre une certaine opinion. En d’autres termes, l’échange d’arguments visant à convaincre l’autre serait un processus déterminé par des causes telles que les deux participants seraient respectivement manipulés par ces dernières. Sans le présupposé de la liberté, toute tentative d’atteindre une compréhension adéquate du comportement cognitif de l’être humain est donc vouée à l’échec10.
Il en va de même pour le phénomène de l’agir moral. Si l’on confronte les hommes aux normes éthiques, on suppose qu’ils sont libres de se les approprier et de les respecter ou de les rejeter. Si en revanche l’on renonce à cette hypothèse, les normes éthiques ne sont plus qu’un moyen de dressage social destiné à conditionner les hommes à un certain comportement socialement souhaitable par la promesse d’une récompense et d’une punition. Il est alors également erroné de rendre quelqu’un moralement responsable de son agir, puisqu’il n’est pas en son pouvoir de le déterminer lui-même. L’établissement et l’imposition de normes seraient à leur tour entièrement régis par des causes dans le cadre d’un déterminisme poussé à son terme. Il n’est pas nécessaire d’expliquer les conséquences qui en résulteraient pour la validité des normes éthiques. L’on peut donc en résumé décrire le déterminisme comme un position « au-delà de la liberté et de la dignité11 ». Aussi, il n’est pas étonnant que la grande majorité des déterministes ne tiennent à leur doctrine qu’en théorie, mais pas dans leur propre vie pratique.
Après avoir observé que la liberté de l’homme est démontrable, certes pas au sens strict, mais comme hypothèse très plausible sans laquelle il est impossible de comprendre correctement le comportement cognitif et moral de l’homme, il convient d’aborder une deuxième question laissée de côté jusqu’à présent : l’existence et les caractéristiques d’un être divin ont été examinées par les ressources de la raison, et au cours de cette entreprise, les chances de justifier Dieu face aux maux du monde se sont avérées faibles. On peut maintenant supposer qu’il en irait autrement si, au lieu de faire appel à la raison, on misait sur la foi pour défendre Dieu. À première vue, les maux du monde sont une bonne raison de rejeter la croyance en un Dieu tout-puissant et parfaitement bon. Mais celui qui se laisse porter par la foi sans buter contre l’écart entre les supposées qualités de son Dieu et la réalité empirique sera également en mesure de concilier les maux dont il souffre avec la toute-puissance et la toute bonté de son Dieu. L’on pourrait se rabattre ici sur le fait qu’un Dieu qui autorise le mal est certes incompréhensible, mais au moins possible. Même un athée résolu comme Schopenhauer considère cette solution comme cohérente :
Car qu’un être tout-puissant et en même temps tout sage crée un monde tourmenté, on peut toujours le penser, même si nous n’en connaissons pas la raison : c’est pourquoi, même si on lui attribue également la qualité de bonté suprême, l’impénétrabilité de son décret devient l’échappatoire par laquelle une telle doctrine se soustrait encore au reproche d’absurdité12.
Quant à savoir s’il est préférable de croire en un Dieu certes tout-puissant et parfaitement bon mais incompréhensible, ou d’y renoncer, ce qui peut déboucher aussi bien sur une vision dualiste du monde que sur l’agnosticisme ou même l’athéisme, c’est une décision que chacun doit finalement prendre lui-même. Il ne semble pas tout à fait inapproprié de s’en tenir à cet égard à Fichte, qui déclare dans sa Nouvelle présentation de la doctrine de la science :
Quelle philosophie choisir, cela dépend donc du genre d’homme que l’on est : car un système philosophique n’est pas un mobilier de ménage dont on peut se débarrasser ou que l’on peut adopter comme il nous plaît, mais il est animé par l’âme de celui qui le fait sien13.