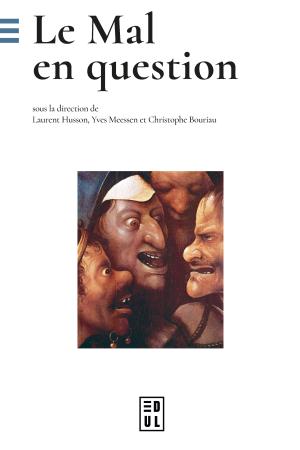
Ce texte est la version modifiée d’une communication lors du colloque « Au bord de l’abîme : Dieu et le mal », organisé par Emmanuel Falque à l’Institut catholique de Paris (10 mai 2016).
Dès que nous abordons la question du mal, notre raison vacille. Ce n’est pas seulement la chose même qui échappe à notre intention, mais c’est plutôt l’intentionnalité elle-même qui est mise à mal. Si tant est que la conscience soit toujours « conscience de quelque chose », alors il faut bien dire que, dans le cas du mal, ce rapport lui-même est perturbé. À l’instar de Kierkegaard, pour qui l’angoisse se présente comme « vertige de la liberté »1, on peut dire que le mal n’a pas véritablement d’objet. Et si celui qui le commet est attiré vers un objet qu’il convoite, c’est en tant qu’il se présente pour lui sous l’aspect d’un bien. Mais la description de ce bien ne nous dit rien du mal sinon en le replaçant dans les circonstances qui le montrent sous un jour désirable. Le mal est donc davantage dans la « manière », dans la façon de faire, que dans « quelque chose ». Le mal se situe dans une tournure, ou plutôt un détournement de la bonté. D’où la difficulté à le localiser en tant que tel. Pourquoi ne pas simplement dire que le mal est un cas limite de la phénoménalité ?
Pour aborder cette frontière phénoménologique, nous proposons un déroulement en cinq étapes : une manifestation du mal par ses effets ; une phénoménologie de l’acte mauvais ; l’heuristique d’une fissure de l’ego ; de l’impossibilité nécessaire de sortir du désespoir ; la révélation d’une issue dans le combat de l’ego pour son propre achèvement.
La méthode appliquée ici est celle d’une phénoménologie expérimentale « en première personne »2. Plus exactement, on tentera d’articuler la première personne du singulier (je) et la première personne du pluriel (nous) en prenant en compte la troisième personne, le tiers (il). Cette méthode est requise pour tenter de se replacer là où la vie s’éprouve dans sa donation effective. On suivra le conseil de Husserl : « Que chacun réalise pour soi ce dont il s’agit au contact d’une intuition vivante »3.
Le mal échappe à toute saisie conceptuelle. Les tentatives de théodicée échouent dans des conjectures où le mal est justifié par une maximisation du bien4. Se revendiquer d’un vouloir divin pour accepter la misère ou la guerre, ou tout autres maux, est un véritable désastre. Cela revient à considérer Dieu comme une cause, non seulement consentante mais plus encore effective, du moindre mal. La théodicée enchaîne Dieu à une logique de la justification, ouvrant ainsi la porte à son procès. Mais, précisément, le problème n’est pas ici d’abord théologique, mais logique tout court. Plutôt que vouloir l’expliquer (erklären), l’option ici choisie consiste à tenter d’élucider (aufklären) la manière dont il se manifeste. Passer du « pourquoi » au « comment », c’est faire droit à l’approche phénoménologique5.
Lorsque nous cherchons à cerner le mal, à le circonscrire, nous constatons qu’il ne se laisse ni localiser, ni quantifier. Bien sûr, il sera toujours possible de viser les effets à travers lesquels il se manifeste : une personne effondrée par l’annonce d’une séparation, une dispute violente, un corps défiguré par les coups ou rongé par la maladie, une maison ravagée par un incendie, une ville détruite sous les bombardements, ou, pour faire écho à des faits encore récents, toute une population meurtrie par les attaques terroristes. À partir de ces quelques exemples, et quel que soit l’allongement de la liste, nous serons en mesure de noter une constante dans la diversité des effets du mal. À chaque fois, indépendamment de ses circonstances et de son intensité, le phénomène du mal se traduit par la destruction de quelque chose. Il est précisément visible par le fait qu’il se phénoménalise par une dé-manifestation. Cette dernière prend deux modalités : la déformation et la privation.
Lorsqu’il y a violence et que les choses sont abîmées, on assiste à une déformation : le bâtiment éventré laisse apparaître l’acier tordu au milieu du béton éclaté, la rame de métro explosée expose ses entrailles et les corps déchiquetés… De manière moins spectaculaire mais tout aussi réelle, la relation de connivence qui s’était établie entre partenaires et les rendait radieux fait place à une adversité qui s’affiche jusque dans la crispation des visages. Bref, la beauté harmonieuse se crispe en un masque de laideur : le mal se manifeste par une grimace faite au cosmos. Parfois, la grimace se manifeste sous un autre mode, celui d’une confiscation ou d’une suppression.
Lorsqu’une chose était là et qu’elle est ôtée à celui qui en disposait, on constate une privation : le passant plonge la main dans sa poche et constate le vol de son portefeuille, les vacanciers découvrent leur appartement vide à leur retour. Ou, sous une forme qui provoque une douleur impossible à esquiver dans celui qui reste, c’est l’absence du corps aimé. Soit parce qu’il est parti ailleurs de son plein gré, et alors la torture est de le savoir vivre ailleurs que là où je suis. Ou bien, il est parti par accident, maladie ou vieillesse, en quittant la vie localisable, celle que nous menons vous et moi. Et là aussi celui qui reste est privé de l’autre.
Que ce soit la déformation ou la privation, le mal se manifeste par un effet sous forme de défection, une défectuosité. Cette description phénoménologique rejoint-elle la métaphysique qui qualifie le mal de defectus plutôt que d’effectus6 ? La question est ouverte. Parce qu’il est issu d’un acte directement ou indirectement destructeur, le mal révèle une certaine effectivité7. À l’instar des remous provoqués par le jet d’une pierre dans l’eau, le mal se propage. Un effet néfaste peut en entraîner un autre. Et nul ne sait où l’onde ira échouer. En raison de ce rayonnement, il semble trop court de définir le mal uniquement comme privatio boni8.
Pour statuer sur cette question, le spectateur du mal est démuni. Même en dénichant les motivations d’un acte moral, qui apparaît sous la forme d’un mal physique, il n’entre pas dans son intentionnalité même. Le seul endroit où la question du mal peut être véritablement traitée, finalement, c’est de l’intérieur de l’acte mauvais lui-même. Nul ne connaît l’effectivité d’un acte mauvais que celui qui le commet. Autrement dit, comme l’affirme Jean Nabert, « il faut renoncer à chercher une réponse spéculative à la question du mal »9. C’est seulement en se situant dans ce qu’il nomme « la causalité impure » que nous sommes capables de décrire l’expérience du mal. De ce fait, le mal ne peut être abordé que là où nous sommes, où je suis, déjà accusé(s). Pour tout dire, il n’y a pas de situation où le mal puisse être objectivé. Nous ne sommes pas face au mal, mais déjà investi par lui de toutes parts. Le mal n’est pas un problème qui advient à l’ego. Le mal engage l’ego tout entier dans un combat. Parce que l’ego n’est pas un « je suis » identique à lui-même, mais un projet inachevé, il doit livrer « un combat pour se rendre lui-même vrai »10. Comme nous allons tâcher de le décrire, le mal est précisément ce qui tente de néantiser l’ego.
Le mal que nous commettons (le mal moral distingué du mal physique), pour peu que nous y réfléchissions, nous plonge dans un sentiment de « stupeur »11. C’est trop peu dire que nous constatons un écart entre notre vouloir et notre action. S’il s’agissait de nous retrouver provisoirement, ou par quelque acte singulier, en conflit avec la norme morale, nous n’éprouverions pas ce sentiment d’étrangeté à nous-mêmes qui peut nous envahir jusqu’à la nausée. Unheimlichkeit : ici, c’est véritablement être délogé de soi. Pourquoi ? Lorsque nous revenons réflexivement sur nos actes, nous constatons une complicité, plus persistante que toute tentative de progrès, avec une source insondable d’eau saumâtre. Un abîme se creuse ainsi entre une causalité pure, telle que nous la voudrions idéalement, et celle que nous exerçons effectivement. Cet écart entre représentation (idéale) et effectivité (réelle) est vécu comme une fissure au sein même de notre identité. Nous faisons l’expérience d’une inégalité du moi à son être. Mais d’une inégalité telle qu’elle n’est pas un simple retardement sur une possibilité assurée de son appropriation. Aussi, dans une forme de déchéance de notre liberté, nous voudrions pouvoir nous réclamer d’une nature qui nous dicterait ses lois. Mais, précisément, le fait que notre conscience se sente trahie par les propres activités du moi est déjà la manifestation que nous ne sommes pas soumis à la détermination naturelle. Les « pressions venant d’en bas » ont beau être impérieuses, elles ne sont pas des mécanismes aveugles que je subirais sans reconnaître leur contrariété. Pour comble de ma stupeur, l’alternative entre une liberté sûre d’elle-même et une nature déterminante par ses impulsions m’est refusée. Et c’est bien cela qui me fait mal. Ce que je voudrais pouvoir extirper, comme on enlève des cellules cancéreuses localisées, c’est précisément cette connivence odieuse et horrifiante. Je m’auto-atteste sous un mode défectueux. Je suis défectueux. Voilà ce que « je » ne puis supporter.
Ce qui me fait horreur dans le mal, jusque dans l’acte le plus sadique, c’est que sa salissure m’éclabousse jusque dans mon intimité. D’aucun acte mauvais auquel j’assiste en spectateur, je ne peux me dire que je m’en désolidarise totalement. Le mal que l’autre fait provoque en moi une houle de haine que je ne peux maîtriser. Le mal n’est donc pas seulement là, à l’extérieur de moi, il est déjà au-dedans. Le mal se propage ainsi, s’insinuant à partir du refus qu’il suscite. Nous passons sans nous en rendre compte du mal subi au mal commis. D’abord rumination, il sort en bordées d’injures contre ces fieffés assassins dont je souhaite la mort et l’extermination. Lequel d’entre nous n’a pas déjà mis son imagination en route, se retrouvant avec un bazooka à la main pour faire sauter ces extrémistes ? Où donc alors est la différence entre eux et moi ? Le mal des autres est d’autant plus terrifiant que j’en perçois l’écho en moi. Entre la brute et moi, que je le veuille ou non, une sorte de connivence est déjà là. Ce qu’elle fait, il pourrait arriver que je sois poussé à le faire, parce qu’une certaine connivence nous lie dans cette fragilité de l’action. La défectuosité nous est commune : ici de manière patente, là de manière de latente. Voilà pourquoi je ne peux me satisfaire d’enfoncer celui qui est passé à l’acte et le laisser seul endosser la faute, pour soulager ma culpabilité toujours possible. Il est tellement tentant – et le mal se trouve bien là – de trouver un bouc émissaire auquel je vais faire porter tous les maux12. D’où le mode sacrificiel avec toute sa panoplie de rituels. Cette tendance à objectiver le mal, dans un être bien circonscrit que l’on va immoler, est d’autant plus vicieuse qu’elle comporte un véritable désir de pureté. Mais ce processus d’épuration est illusoire, car il fait fi de la diffusion du mal, de son éparpillement en tous.
La résurgence de mes défauts, que ce soit de simples pensées malignes ou des omissions plus ou moins volontaires, ou bien des actes répréhensibles dont ma conscience m’accuse, me rappelle le lien qui me lie au salaud. Je ne peux éradiquer à mon gré ce qui surgit en moi de pensées mesquines, salaces ou belliqueuses. Je suis donc immédiatement et personnellement concerné par le mal. Je suis cerné avec l’autre dans le mal, même si ses effets se manifestent de manière plus dévastatrice chez lui. Mais, en fait, ce qui me dégoûte, ce n’est pas tant l’autre en lui-même que ma parenté non avouée et non avouable avec lui. Voilà pourquoi je préférerais nettement expurger cette connivence par l’immolation du bouc émissaire. Il faut bien l’avouer : le mal me met à mal dans mon espérance. Ainsi, concernant le mal, non seulement la première question kantienne : « Que puis-je savoir ? » n’est pas de mise, mais peut-être aussi que la seconde : « Que dois-je faire ? » se révèle-t-elle également caduque. Parce que, quoi que je fasse, « toujours et en toutes circonstances », je fais l’expérience d’actes à la causalité impure13. Même s’il ne s’agit que de détails apparemment infimes, mon acte n’est pas entièrement pur. Finalement, constatation faite, ne me reste-t-il pas que la dernière question : « Que m’est-il permis d’espérer ? ».
Bien qu’ils émanent de moi, mes actes mauvais ont cette particularité que je refuse d’en assumer pleinement la paternité. Contrairement à mes actes bons, que je n’ai aucune peine à reconnaître miens, je les vis comme se faisant à la fois par et malgré moi14. Tout homme, quelles que soient ses convictions religieuses, peut ainsi se reconnaître dans cette affirmation de l’apôtre Paul : « si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n’est pas moi qui agis » (Rm, 7 : 20a). Autrement dit, le mal commis suscite en moi ce constat : « je » n’est pas « moi ». Cette désolidarisation envers mes propres actes m’accule à reconnaître une limite dans mon autonomie. Ce qui est en jeu dans le mal, c’est la question de la liberté, plus exactement, de ma liberté. Si je ne mets pas en œuvre ce que je choisis, si du non-vouloir se glisse à mon insu dans mes propres actes, jusqu’à quel point suis-je libre ? Et, par-delà, jusqu’à quel point suis-je encore assuré de pouvoir progresser vers mon propre accomplissement ? Cette fissure entre « je » et « moi » ne peut être colmatée d’aucune manière. Aussi, est-ce mon espérance même qui en reçoit le contrecoup.
L’épreuve du mal commis est une remise en cause radicale de la maîtrise de moi, de la possession de moi-même. Je ne peux m’éprouver comme causa sui, origine substantielle de ma propre activité, alors même que je suis forcé de subir une altérité au sein de mon agir. Je pâtis précisément là où je voudrais jouir de la libre disponibilité de moi-même. Le mal commis m’oblige donc à me voir à distance de moi-même. Un egofissuré, voilà ce que je suis. Non seulement le mal que je commets m’invite à me considérer en quête de ce que je ne suis pas encore, mais plus encore, il m’invite à voir cette quête comme une lutte intestine entre « je » et « moi ». Étrangeté que cette incapacité à m’obéir à moi-même. Étrangeté que cette déviance, ou déficience vis-à-vis de mon devenir. Le mal déjoue ma capacité à me projeter dans mes possibles. Il est une perturbation dans mon propre achèvement. D’où une souffrance inhérente dont je ne peux me débarrasser : je souffre d’être moi15. Je pâtis d’une impossibilité à devenir celui que je souhaite être.
Ce qui dans les manifestations du mal apparaît comme défectuosité et privation ne resurgit-il pas ici au sein de l’action ? Dans l’acte mauvais que je commets, ne suis-je pas privé de ma propre effectivité ? Comment qualifier l’effectivité d’un ego qui affirme : « si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n’est pas moi qui agis » (Rm, 7 : 20) ? Il s’agit d’un « faire » attribuable extérieurement à un « je » sans que ce dernier ne se reconnaisse comme l’auteur de son propre « agir ». Fissure de l’effectivité elle-même. Effectivité fissurée qui provoque le désarroi complet du moi, logiquement censé pouvoir s’identifier à l’action commise. « Effectivement, je ne comprends rien à ce que je fais : ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais » (Rm, 7 : 15). Littéralement : « je ne (re)connais pas ce que je mets en œuvre » (o gar katergazomai ou ginôskô). Dans le cas du mal commis, il n’est pas possible au « je » de se raconter lui-même, à partir de cette action16. Il désapprouve sa propre effectivité jusqu’à haïr son propre agir : « ce que je fais, je le hais ». Cette désapprobation qui se manifeste dans la conscience (Gewissen) est une auto-attestation de la défectuosité de l’acte posé.
La manifestation auto-attestative de ma défectuosité insinue un doute quant à ma capacité à devenir ce que je suis. Philosophiquement, cela signifie que je ne peux aucunement adhérer béatement à la notion d’entéléchie aristotélicienne. Même si je vois clairement que les actes vertueux et l’amitié désintéressée ne sont pas facultatifs à mon bonheur, ne suis-je pas simultanément contraint à observer que certains de mes propres actes m’en éloignent ? Autrement dit, ne suis-je pas moi-même le premier obstacle à l’accomplissement de mon bonheur ? Qu’en est-il alors de ma soi-disant liberté ? Ne suis-je pas d’ores et déjà exposé au fatum ? Si je n’arrive pas à prendre le pas sur cette source immaîtrisable de mes actes, comment ne pas me constituer prisonnier d’un destin implacable ? Le drame de ma vie se commuerait-il en tragédie17 ? L’épreuve du mal fait vaciller l’homme de Charybde en Scylla. Il tombe avec d’autant plus de violence dans un dictat du destin qu’il avait misé plus radicalement sur ses propres forces18. Le mal abîme l’homme dans ce qu’il a de plus noble, sa liberté. La rationalité triomphante et la tragédie ténébreuse sont sœurs jumelles. Elles ont en commun de ne pouvoir considérer un enjeu relationnel au sein du dynamisme de l’action. L’altérité au cœur de l’action y est vécue comme une négativité, d’où l’exclusion réciproque de l’identité et de l’altérité. Là où la raison apparaît comme suffisante pour conduire la volonté vers la bonté, l’altérité est exclue au profit de la seule identité. Là où la raison se découvre dépassée par une force incontrôlable, c’est l’identité qui est exclue au profit de l’altérité.
Me voici acculé à découvrir que mon « moi » est gangréné. Je suis condamné à ne pas pouvoir atteindre la transparence pure que, pourtant, je désire. Le pire, dans ce procès, est que « je » suis à la fois le coupable, la victime et le juge. Le coupable, car les actes mauvais, c’est bien moi qui les commets. La victime, parce que de ces actes, je suis le premier blessé. Le juge, car je ne peux les tolérer moi-même et que ma conscience me condamne. Or, cette assignation à condamnation est terrible, car elle n’est pas provisoire. Il n’y a pas d’issue rationnelle quant à détecter un motif malin qui pourrait être extirpé de manière à exhiber une conscience rendue à sa pureté. C’est l’étoffe même du moi qui est atteinte, dans chacune de ses moindres parcelles. Pour échapper au triangle infernal coupable-victime-juge, afin de ne pas le ressasser sans cesse, le moi cherche refuge sans le subterfuge.
Toutes les descriptions phénoménologiques que nous avons proposées, qu’elles soient extérieures ou intérieures, sont constatables sans la Révélation. En effet, la parole paulinienne de la lettre aux Romains à laquelle nous avons eu recours relate une expérience que tout homme de bonne volonté peut faire. C’est l’expérience même de la conscience qui découvre précisément que sa bonne volonté est mise à mal. Nous désirons maintenant faire un pas de plus en montrant comment la Révélation biblique éclaire cet écart du « je fais » et du « je suis » : le devenir vers ce que je ne suis pas encore. Ce pas, nous n’allons pas le faire de l’extérieur. Toute herméneutique s’adosse à une expérience. Les mots ne font d’ailleurs mouche que si l’ego lecteur se retrouve dans l’expérience décrite faisant ainsi l’épreuve en lui-même de la chose du texte.
Passer du fait de se trouver en faute devant sa conscience à la découverte de son péché, car c’est de cela qu’il s’agit, est une voie libératrice. Kierkegaard a bien montré que le passage de l’éthique au religieux, qui demandait par ailleurs de l’humour par rapport à soi, n’est pas l’enfoncement dans la culpabilité, mais au contraire, sa libération. Grâce au choix de se placer vigoureusement devant la conscience, l’ego avait réussi à quitter l’angoisse liée à sa vie d’esthète. Le voici maintenant, au terme de sa tentative pour sortir victorieux de ses tendances dispersantes, tombé dans le désespoir. Accusé par et en lui-même, il n’a plus de lieu où s’échapper. « Maladie mortelle » : « Le désespéré est un malade à mort. Plus qu’en aucun autre mal, c’est au plus noble de l’être qu’ici le mal s’attaque ; mais l’homme n’en peut mourir »19. Retourner au divertissement est devenu impossible. Dos au mur de son propre ego, l’ego se culpabilise d’être lui-même. L’identification à un ego défectueux, voilà l’horreur d’être soi-même : « Ainsi le supplice reste toujours de ne pouvoir se défaire de soi-même ». À quoi, implacable, Kierkegaard ajoute : « pourquoi s’étonner de cette rigueur, puisque ce moi, notre avoir, notre être, est à la fois la suprême concession infinie de l’Éternité à l’homme et sa créance sur lui ? »20. Si, par bonheur, descendu là dans cet abîme, quoi que ce soit se présentait à moi pour en sortir, je l’accepterais. Or, c’est précisément au cœur de ce gouffre infernal qu’une voie inespérée s’ouvre soudain : mourir complètement au moi propre pour renaître à une vie nouvelle libérée de l’appropriation de soi. Et là, être dans le bonheur de la voie d’un achèvement dès à présent : ouverture de l’Instant. Il ne faut pas croire que cette ouverture advient par une quelconque gymnastique de l’esprit. L’esprit est pris au piège de soi-même. La réflexivité n’est d’aucun secours dans le désespoir. Tenter « la synthèse consciente d’infini et de fini »21 est une bouffonnerie. Autant essayer d’enjamber le mur de la finitude. Allez m’en expliquer le mode d’emploi. Le processus réflexif ne fait qu’empirer les choses, me repliant encore davantage en moi-même, bête traquée dont je suis le traqueur. Il faut qu’un événement brise ce cercle infernal. Et en même temps, il m’est impossible de me le donner à moi-même. Nécessité et impossibilité : voilà le paradoxe. Voilà la croix de l’ego. Il est devant une nouvelle décision. Là où il ne subsiste aucune possibilité humaine, soit il faut se résoudre au désespoir lié à l’absurdité de l’entreprise, soit il faut tout baser sur un nouveau critère : « à Dieu tout est possible »22. Toute la question est alors de vouloir y croire, non plus théoriquement, comme une chose livresque, mais comme la possibilité d’une effectivité. « Mais, n’est-ce pas la formule pour perdre la raison ? La perdre pour gagner Dieu, c’est l’acte même de croire23 ». Ainsi, sous le feu de cette réflexion critique de la raison, comble du désespoir, le moi lutte pour ne pas consentir à cette perte de lui-même. Comme celui qui se trouve à gesticuler dans la boue, il ne fait que s’enfoncer un peu plus :
C’est là le combat de la foi, qui lutte comme une démente pour le possible. Sans lui, en effet, point de salut. Devant un évanouissement, les gens crient : de l’eau ! de l’eau de Cologne ! des gouttes d’Hofmann ! Mais pour quelqu’un qui désespère, on s’écrie : du possible, du possible ! Un possible : et notre désespéré reprend le souffle, il revit, car sans possible, pour ainsi dire, on ne respire pas. Parfois l’ingéniosité des hommes suffit pour en trouver, mais au terme, quand il s’agit de croire, il n’y a qu’un seul remède : à Dieu tout est possible24.
Pour Kierkegaard, c’est de l’intérieur même de la conscience en débat avec elle-même que la décision pour la foi se fait nécessité vitale. Blondel en donnera une version renouvelée avec « l’unique nécessaire »25. S’il est un point où la Révélation peut donner à reconfigurer nos possibles, c’est bien d’indiquer la voie d’une issue dans la situation désespérante où le mal introduit l’homme. Devant l’alternative aporétique : ou bien la liberté sûre d’elle-même et de sa propre conquête, ou bien la soumission à des forces inexorables, la Révélation propose une autre voie. L’épreuve d’une défaillance au cœur de l’agir conduit le protagoniste biblique à reconnaître qu’il s’est retrouvé confronté à des forces destructrices insurmontables, précisément parce qu’il a voulu agir par lui-même. Dans la Bible, celui qui veut être maître de sa destinée, et libre de toute obligation, se retrouve l’esclave d’une situation inextricable, qui le broie inexorablement. C’est donc en refusant l’alliance, qui conditionne sa liberté, que l’homme est réduit à la nécessité. Inversement, c’est en accueillant l’alliance qu’il se retrouve libre d’agir dans une destinée qui élargit son horizon. Ses propres limites humaines (du verbe grec horizein, limiter) sont toujours là, mais elles sont « désactivées » en tant que bornes de son agir26.
Il ne s’agit pas là d’une donnée anecdotique ou accidentelle, mais constitutive de l’expérience qui se dévoile à travers la Bible. Depuis les patriarches jusqu’aux apôtres, tous les croyants sont structurés autour d'un modèle inverse au héros grec. En effet, le protagoniste biblique n’a rien d’un demi-dieu. Il n’est pas victorieux grâce à une force inscrite dans sa nature, en raison de sa naissance semi-divine, mais, au contraire, grâce à une force reçue dans une reconnaissance de sa fragilité humaine. Vocation et aveu d’impuissance vont de pair27. Prenons l’exemple de Gédéon. Lorsque l’ange du Seigneur apparaît à Gédéon et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier ! […] Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madiân. Oui, c’est moi qui t’envoie ». Gédéon lui répond : « Pardon, mon Seigneur, comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus faible en Manassé et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père ». L’ange lui répond : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble » (Jg, 6 : 12-17). Il en va ainsi pour les Prophètes. Cette structure prophétique ne représente pas quelques cas isolés. En fait, elle émerge d’un tissu expérimental qui est précisément régi par le critère de disproportion entre ce qui est à accomplir et la force apparemment disponible. L’ensemble des livres historiques est aussi basé sur ce canevas. L’emblème en est le récit de David contre Goliath (1 Sm, 17 : 1-58). Ici, les traits du combat sont typés dans deux figures antithétiques : le faible qui compte sur Dieu (David) et le fort qui compte sur lui-même (Goliath). Contrairement à ce qui devrait normalement se passer à vue humaine, c’est le faible qui gagne. D’où l’étonnement et l’émerveillement de tous tant l’incapacité de David était évidente : « Tu es incapable d’aller te battre contre ce philistin : tu n’es qu’un gamin et lui un homme de guerre depuis sa jeunesse » (1 Sm, 17 : 33). Cette incapacité se confirme par l’impossibilité de David de porter l’armure de combat. Mais ceci n’est que le revers d’une médaille dont le versant est bien mis en évidence par l’hagiographe. David lui-même s’est engagé, s’est impliqué à ses risques et périls, en faisant confiance d’avance dans le fait que la victoire lui serait accordée : « Toute cette assemblée le saura : ce n’est ni par l’épée ni par la lance que le Seigneur donne la victoire » (1 Sm, 17 : 47). La condition requise du témoignage est la foi du témoin qui se met en branle dans une action dont il sait d’avance qu’il n’a pas les moyens de l’accomplir par sa propre force. Cette disproportion, la démesure entre les moyens disponibles visibles et l’événement qui survient de fait, est l’avènement du sublime. C’est l’excès, l’écart, qui est la manifestation de l’absolu, tant pour le témoin-acteur que pour les témoins-spectateurs. Le test de vérifiabilité est donc une auto-attestation/témoignage par l’épreuve d’un excès de puissance dans la faiblesse. Autrement dit, la victoire contre le mal est le lieu même de la vérification que Dieu agit.
Et pourtant, ce mode opératoire rencontre également un scandale : comment se fait-il que le juste souffre tandis que le malfaiteur jouit, apparemment, d’une vie heureuse ? Cette question, la Bible ne l’élude pas. Le livre de Job en est témoin. Figure universelle du juste souffrant, il doit faire face à toutes les explications rationnelles concernant sa situation. Mais aucune justification, proférée par ces soi-disant amis, ne le convainc. Bien avant qu’ils ne voient le jour, les essais de théodicée sont déjà dénoncés. Face au mal, la seule attitude qui prévaut est de rester dans la confiance en Dieu, fidèle à sa parole. Cela ne veut pas dire que Job se soumet béatement. Personnage haut en couleur, il hurle sa douleur et apostrophe Dieu en lui demandant des comptes : « Prends-tu plaisir à m’accabler, à mépriser la peine de tes mains et à favoriser les intrigues des méchants ? » (Jb, 10 : 3). Job revendique une rétribution à hauteur de sa justice. Protestant de son innocence dans ce qui lui arrive, il passe de la lamentation à l’insolence. Mais c’est justement dans ce dialogue houleux que Dieu finira par montrer un visage étonnant de lui-même que Job n’avait pas reconnu de prime abord28. Un peu comme Élie qui croyait avoir affaire à un Dieu puissant et vengeur, et découvre qu’il ne se manifeste pas dans le fracas mais dans « le murmure d’une brise légère » (1 R, 19 : 12), Job se rend compte d’un paradoxe : le Créateur de toutes choses, lui qui fait lever le soleil chaque matin, délimite les eaux et la surface de la terre, nourrit les animaux sauvages, est aussi celui qui continue à mener les humains dans tout ce qui leur arrive, que ce soit en bonheur ou en malheur. Job confesse : « Je sais que tu peux tout et qu’aucun projet n’échappe à tes prises » (Jb, 42 : 2). Par là, l’auteur du livre de Job n’affirme nullement que Dieu fait advenir le bien et le mal selon son bon plaisir. Il soutient une autre thèse : même si l’homme est aux prises avec l’adversité, Dieu continue à le soutenir. Ce soutien consiste à le maintenir ferme face au mal qui l’assaille. Et c’est d’ailleurs pourquoi, s’adressant à l’un des consolateurs-argumentateurs du juste malheureux, Dieu affirme : « Ma colère flambe contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n’avez pas parlé de moi avec droiture comme l’a fait mon serviteur Job » (Jb, 42 : 7). Réfutation de toute tentative d’explication ou de revendication juridique face au mal, il ne reste que le maintien ferme dans le combat, coûte que coûte. La victoire dans la faiblesse n’est donc pas forcément celle qui débouche sur une heureuse issue à vue humaine. L’hagiographe regarde plus loin : il a en vue une fin heureuse à laquelle l’humanité ne peut accéder sans la destruction de son horizon actuel29.
La toute-puissance de Dieu, contrairement à un préjugé un peu simpliste, n’a rien à voir avec une intervention ex machina. Dieu agit en l’homme pour que, aux prises avec le mal, il ne soit pas atteint lui-même par la malignité. La victoire du combat n’est pas un renversement de situation empirique de type dialectique : celui qui était vaincu devient le vainqueur en renversant son ennemi. La victoire consiste à ne pas être gangréné par le mal, quitte à y perdre la vie. Prolongeant la relecture de Job par Kierkegaard, Vladimir Jankélévitch jette un nouveau regard sur la finale du livre de Job. Plutôt que de parler « le langage d’Aristote », en rétribuant le juste par un bonheur où il retrouve davantage que tout ce qu’il avait perdu, n’aurait-il pas fallu avoir l’audace de laisser le livre sur le paradoxe du salut dans la perte30 ? En contrepoint, Jankélévitch présente la figure de Mazzepa. Dans le poème symphonique de Franz Liszt, l’instant de la défaite est simultanément l’instant de la victoire : « Il tombe et se relève roi ! Mazeppa ne se relève pas ensuite, ni même l’instant d’après, ni même aussitôt, ni même immédiatement ; il se relève en tombant : il ne meurt pas pour renaître, comme Dionysos : il naît en mourant31 ».
Que dire à l’issue de ce petit parcours ? Le mal n’est pas un problème. On ne peut pas l’aborder par l’explication, mais par l’élucidation. Il se manifeste d’emblée par un combat. Or la spécificité de ce combat est qu’il ne se situe pas uniquement sur le plan empirique, mais transcendantal. Le mal tend à anéantir l’homme en le poussant au désespoir, car il le déchire en l’atteignant dans ses conditions de possibilité. Dans ce combat, l’ego est fissuré à l’intime de lui-même. Il est séparé de lui par un attachement excessif dont il ne peut justement pas se défaire. Telle est la croix phénoménologique32. Pour s’acheminer vers l’ego qu’il est déjà sans l’être encore, l’homme n’a d’autre issue que de renoncer à son moi. Perdre pour gagner. C’est la décision de la foi. Or, ce geste insensé s’atteste comme l’acte le plus sensé puisqu’il ouvre un possible là où la situation s’avérait sans issue. Ce schéma est celui de l’homme biblique. L’apôtre est le type même de celui qui reçoit la force dans l’aveu de sa faiblesse. Priant Dieu que lui soit ôtée l’écharde qui le taraude dans sa chair, Paul se voit rétorquer : « Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Ce à quoi, l’apôtre consent : « Aussi mettrai-je ma fierté bien plutôt dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ » (2 Co, 12 : 9).