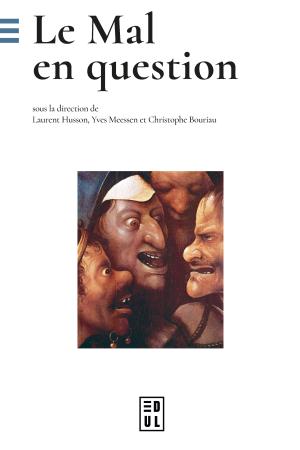
Je ne puis saisir ce que vous appelez mal.
Willem van Blyenbergh à Spinoza, le 16 janvier 1665.
D’ailleurs ce sont toujours les autres qui meurent.
Marcel Duchamp (1887-1968)
Pourquoi le mal ? Avant de se lancer dans des réponses, encore faut-il s’interroger sur la question elle-même, ce qu’elle suppose et présuppose, s’entendre sur le mot. De quoi le mal est-il le nom ? De quels jugements et raisonnements découle-t-il ? Or, on présente souvent la pensée de Spinoza comme une pensée qui nie toute réalité ontologique du mal. Rien de plus vrai (et de plus banal aussi). Il n’y a pas, en effet, de mal au sens absolu du terme. Rien, ni dans la nature des choses ni dans celles des idées, n'offre de quoi asseoir une quelconque réalité du mal. Car, non seulement la question « pourquoi le mal ? » fait le jeu d’une pensée finaliste, source de préjugés, mais la notion elle-même, comme d’autres notions universelles (beau, laid, ordre, désordre…), n’exprime aucune essence. En effet, par réalité et perfection il faut entendre la même chose, toute chose étant en soi parfaite sans défaut ni imperfection. Le fini est positif pour ce qu’il affirme d’existence. Le négatif ne recouvre aucune réalité, et s’il arrive à Spinoza de souscrire à la formule médiévale omnis determinatio est negatio, cela n’est dû qu’à la relation que la chose finie entretient avec ce qui la limite de l’extérieur sans rien entamer de sa positivité. L’erreur non plus n’a aucune réalité dans la chose ni dans l’idée : simple privation de connaissance, aucune idée en tant que telle n’est fausse. La privation ne consistant pas dans l’acte de priver, elle n’est donc rien si ce n’est un manque qui lui vient de la comparaison avec une chose ou une idée plus parfaite. Bref, la question du mal semble être résolue avant même d’avoir été posée, tout ayant été disposé pour qu’on ne puisse plus la poser ainsi.
Voilà pour la doctrine. Tant de positivité qui sature de part en part la pensée spinoziste ne vient pourtant pas à bout du problème du mal. On a beau trouver toutes les raisons pour en nier la réalité, il est plus difficile d’en renier l’expérience, sauf sur le mode du déni. Passer de la question au problème, c’est alors passer de sa considération abstraite au vécu : du mal en général à ce qui fait mal. Deleuze avait déjà fait remarquer que « les lettres sur le mal » – ainsi nommait-il la correspondance avec Blyenbergh – manifestaient une pensée plus complexe et articulée qu’il pouvait sembler à une première lecture. Ces difficultés ne sont sans doute pas spécifiques à Spinoza. Toute pensée eudémoniste trouve dans le problème du mal à la fois sa raison d’être et son obstacle. Le spinozisme n’y fait pas exception.
En témoignent les premiers mots du Traité de l’amendement de l’intellect. Spinoza nous invite à la philosophie par une réflexion qui s’efforce de déloger la question du mal de considérations morales. On se souvient de sa célèbre ouverture :
Après que l’expérience m’eut enseigné que tout ce qui se présente fréquemment dans la vie ordinaire est vain et futile [vana et futilia], voyant que tout ce qui me faisait peur et tout ce pour quoi j’avais peur n’avaient en soi rien de bon [boni] ni de mauvais [ mali], sinon en tant que l’âme [ animus] en était agitée ; je résolus enfin de rechercher s’il y aurait quelque chose qui fut un bien véritable [verum bonum]1.
Vanités des vanités, donc. Quoi de moins original que cet écho de l’Ecclésiaste. Cependant, le désenchantement pour les illusions perdues réserve quelques bénéfices. Sinon d’amorcer un changement, il permet à tout le moins d’interroger les raisons de leur ténacité. Il s’agit moins de renoncer aux ambitions de la philosophie que de rabattre ses prétentions quant à ses réels pouvoirs sur les affects, tout en imprimant un nouvel élan à la réflexion. La référence à la peur et la tonalité épicurienne de ces lignes inaugurales montrent que l’invitation à la philosophie ne précède pas son commencement. Elle est déjà le fruit d’une expérience mûrement réfléchie et aboutit à une position qui peut être qualifiée d’amorale. Bien et mal n’ont pas d’existence en soi, mais ils en ont une relativement à nos désirs. C’est donc à l’aune des inquiétudes de l’animus et de la nature et de « la qualité de l’objet auquel nous adhérons d’amour »2 qu’il faudra repenser le problème du mal. Ce recentrage sur le désir par le désir, compris au sens large comme instance affirmative de toute valeur, ouvre, d’une part, à la déconstruction généalogique de la morale en un sens amoral, et d’autre part, à un projet éthique immanent à la nature même du désir. La valeur, y compris la suprême (verum bonum), ne transcende ainsi pas la cupiditas, elle en procède. Pour le dire avec les mots qui seront de l’Éthique : « l’effort pour se conserver soi-même est le premier et unique fondement de la vertu »3.
Cette perspective orientera la partie IV de l’Éthique. Dès la préface, les notions de bien et de mal sont dites n’indiquer rien d’autre que des manières de penser, des jugements issus du fait que nous confrontons les choses entre elles en les rapportant à nos désirs et à nos modèles. Car une même chose peut être bonne, mauvaise ou indifférente – comme c’est le cas par exemple de la musique, bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l’affligé, ni bonne ni mauvaise pour le sourd – relativement à celui ou celle à qui elle se rapporte. Quoique dépourvus de réalité ontologique, bien et mal ne sont donc pas rien. Ils prennent sens en fonction de ce que chacun juge lui être utile relativement à ses appétits et à ses affects. Aussi, la crise que Spinoza raconte avoir traversée dans le prologue de ce qui est considéré comme son premier traité ne se confond ni avec le pessimisme désabusé de La Rochefoucauld s’échinant à démasquer le régime indépassable de l’amour propre derrière l’hypocrisie sociale, ni avec un subjectivisme nihiliste confronté à la prétendue absence de toute valeur. Spinoza n’est ni un moraliste ni un romantique, il n’est pas davantage un décadent ni un existentialiste avant la lettre. À vouloir la caractériser, sa position est en un sens plus classique. Elle s’apparente plutôt à une forme de scepticisme4 débouchant sur un relativisme des valeurs5, qui n’a cependant rien perdu de sa tension morale.
C’est pourquoi l’absence de mal et de bien en soi n’épuise pas la question de savoir ce qui est bon et mauvais pour soi. Loin de la supprimer, elle ne fait que relancer sa quête. Le vrai bien sera alors ce qui, s’il s’avère atteignable, conviendra le mieux à la nature de mon désir, tout se passant comme si, en raison d’une tension interne au désir lui-même, on ne pouvait jamais tout à fait y renoncer, au risque de demeurer insatisfait si la recherche devait se révéler vaine (hypothèse qui n’est pas écartée). Ce point sera démontré plus tard more geometrico : il est impossible de renoncer totalement à l’idée du verum bonum, car « le désir de vivre bienheureux (cupiditas beate), c’est-à-dire bien, d’agir bien, etc., est l’essence même de l’homme »6. Cette tendance, voire cette tension (comme elle a été aussi traduite), vers la beatitudo est l’effort même qui définit l’essence de l’homme. Il est donc impossible de vouloir la supprimer, sous peine de supprimer le désir lui-même. On peut aussi comprendre que chez les esprits les plus forts, la question de savoir ce qui fait notre bonheur puisse devenir une question de vie ou de mort. Le prologue du Traité de l’amendement de l’intellect montrera les dangers auxquels s’expose la poursuite des biens ordinaires (plaisirs, richesses, honneurs), quand ceux-ci sont recherchés comme s’ils constituaient des biens suprêmes. La méprise quant à leur nature finit par les muer en maux en raison des frustrations pour des promesses de bonheur non tenues. En ligne avec son relativisme de départ, la solution qui se dessinera, au prix d’une crise profonde, ne sera pas celle de s’en abstenir et d’y renoncer à la manière d’un ascète, mais plutôt de considérer les biens ordinaires précisément comme relatifs en vue d’en user non comme des fins en soi, mais comme des instruments au service d’une vie conduite sous le conseil de la raison, c’est-à-dire conformément à ce qui nous est vraiment utile. Dès lors, libido, divitias, honores, les trois biens dont traitait déjà l’Éthique à Nicomaque, ne seront pas plus à considérer comme des maux en soi qu’ils ne furent d’abord considérés illusoirement comme des biens. Ils pourront être bons ou mauvais en fonction de leur usage et relativement au but qu’ils aident à atteindre.
Ce virage amorcé, l’importance accordée au désir permet de faire porter l’accent sur le régime affectif : distraction et suspension de la pensée pour la libido ; pérenne insatisfaction chez qui recherche les richesses pour elles-mêmes ; conformisme et soumission aux opinions et aux valeurs du vulgaire pour qui poursuit les honneurs et le pouvoir par-dessus tout. Ce recentrage sur le désir marque en même temps un écart vis-à-vis de l’anthropologie cartésienne. Que l’homme pense (homo cogitat) n’est jamais qu’une propriété de la chose désirante : c’est parce que je désire (ego cupio) que je pense (ego cogito), non le contraire. Le passage à une nouvelle vie (novum institutum) n’est pas gouverné par une illusoire libre décision, mais il est comme contraint au faîte de la crise par les forces d’une raison attisée par le désir. C’est pourquoi la réflexion sur la valeur relative du bien et du mal conduira à inverser les rapports de dépendance entre jugement et désir selon l’idée que « quand nous nous efforçons à une chose, quand nous la voulons, ou aspirons à elle, ou la désirons, ce n’est jamais parce que nous jugeons qu’elle est bonne, c’est parce que nous nous y efforçons, la voulons, aspirons à elle et la désirons »7.
S’il est vrai que, comme le disait Paul Valéry, « nos jugements nous jugent », c’est parce que nos jugements sont davantage le miroir de nos désirs que des choses qu’ils prétendent juger. Aussi la triade conatus, appetitus, cupiditas aura pour but de faire converger les aspirations morales de la pensée vers une éthique, où la science des affects se pose non seulement en alternative aux Passions de l’âme, mais aussi et surtout comme moyens d’une pratique de libération, certes aussi difficile que rare, mais au moins réaliste. Une éthique destinée à ne pas être relative au moi seul, mais à tous les hommes, à condition que le bonheur qu’elle procure ne souffre d’aucune tristesse et que tous puissent en jouir sans exclusivité ni concurrence, accru à mesure qu’il est plus largement partagé. Cela reviendra à reposer la question de la relativité du bien et du mal en l’élargissant du champ de l’éthique à celui de la politique, qui en constitue comme l’horizon et le prolongement.
Si bien et mal ont si peu de réalité dans les choses, c’est qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’Ens perfectissimus. La redéfinition spinozienne de Dieu à l’aune de sa puissance seule lui ôte en effet tout attribut moral (volonté, bonté, miséricorde, providence…) ainsi que toute soumission à des fins (internes ou externes). Le célèbre appendice de la première partie de l’Éthique se chargera de tracer une généalogie des préjugés relatifs aux notions de bien et de mal à partir de leur cause première, à savoir le jugement finaliste :
Une fois qu’ils se furent persuadés que tout ce qui se fait arrive en vue d’eux, les hommes ne purent que juger principal en toute chose ce qui avait le plus d’utilité pour eux, et estimer le plus excellent tout ce qui les affectait au mieux. D’où vint qu’il leur fallut former ces notions par lesquelles expliquer les natures des choses, à savoir le Bien [Bonum] et Mal [ Malum], l’Ordre, la Confusion, le Chaud, le Froid, la Beauté et la Laideur […]. Et donc tout ce qui contribue à la santé et au culte de Dieu, ils l’ont appelé Bien [ Bonum] ; et ce qui y est contraire, Mal [ Malum]8.
Dieu n’est ni bon ni mauvais. Il recouvre ces propriétés illusoires par l’entremise d’une imagination finaliste et anthropomorphe. Cette critique radicale coupe l’herbe sous le pied à toute théodicée passée et à venir. Dieu n’a pas à être justifié, car agissant par la seule nécessité de sa nature, il n’est pas plus juste qu’il n’est bon. Si pour le philosophe les dieux des religions sont tout aussi vains que futiles, il n’en demeure pas moins que le Traité théologico-politique jugera les Écritures très utiles, voire nécessaires, car pour tous ceux qui n’ont pas la force de la raison pour guider leurs actions, elle a apporté « une très grande consolation »9. Sans quoi « nous douterions du salut de presque tout le monde »10. Personne n’a pu en effet démontrer le fondement de la théologie, à savoir que l’on peut gagner le salut par l’obéissance seule à la loi morale. Si cela devait arriver un jour, serait aussitôt signée la fin de l’indépendance de la théologie, définitivement absorbée par la philosophie. C’est pourquoi Spinoza reconnaît aux Écritures une certitude qui n’est pas plus (mais pas moins non plus) que morale, puisque le philosophe, qui acquiesce sans réserve à son enseignement, n’a aucune raison de douter de sa promesse de salut sans pour autant en avoir une certitude mathématique. La révélation dont portent témoignage les Écritures fut donc aussi nécessaire qu’utile pour ceux qui sont incapables de répondre par les seules forces de l’entendement à la demande de bonheur inscrite dans l’essence humaine et donc à la question du mal.
Toutefois, la raison elle-même n’aurait sans doute jamais pu prendre conscience de son autonomie et de la voie de salut qui lui est réservée, restant à jamais condamnée au scepticisme et au relativisme, si la norme de vérité des mathématiques ne lui avait pas été révélée d’une façon ou d’une autre11. Il n’y a pas d’entrée en philosophie sans un autre modèle de vérité. La géométrie, qui ne se préoccupe guère des fins et qui repose sur la seule puissance de l’entendement, fournit ce modèle ainsi que sa propre garantie de certitude. On peut donc dire que l’humanité connut non une, mais deux révélations : l’une, adressée à l’imagination, dont les Écritures portent témoignage ; l’autre, immanente à la puissance même de l’entendement. La première requiert toujours un signe ; la seconde n’en requiert aucun, si ce n’est la norme de l’idée vraie. La séparation sans subordination de la théologie et de la philosophie, chacune souveraine dans son domaine, est donc bien l’un des apports majeurs du traité de 1670, à condition de ne pas oublier que vera religio et vera philosophia se séparent en s’accordant sur l’enseignement moral (praecepta sive documenta vitae)12. À ceci près, que la première ne concerne que pietas & obedientia, la seconde veritas & sapientia. Deux voies de salut bien distinctes, indépendantes et autonomes, qui se rejoignent cependant dans la pratique pieuse et vertueuse : la première dans la confiance sans autre raison que la croyance et l’obéissance, la seconde conduite par la raison et les seules ressources de l’entendement.
Laissons à présent le Traité théologico-politique, quitte à le retrouver plus tard, et revenons à l’Éthique. Si bien et mal n’ont de sens que relatif, ils ne sont pas rien. Loin de disparaître, les termes bonum, malum vont être redéfinis (plus d’une fois), à commencer par les deux premières définitions de la quatrième partie. Car ils traduisent à ce stade une certaine expérience et avec elle une certaine connaissance. Lesquelles ? En premier lieu, ils indiquent quelque chose relativement à la variation de notre puissance d’agir13 :
La connaissance du bien et du mal n’est rien d’autre qu’un affect de joie ou de tristesse en tant que nous en sommes conscients14.
Nous voici ramenés au vécu. Ce que nous percevons comme nous affectant de joie ou de tristesse, c’est cela même que nous nommons « bien » et « mal ». En effet, cette idée ne diffère guère de l’idée de joie ou de tristesse qui suit nécessairement de ces mêmes affects. Car elle est unie à l’affect de la même façon que l’esprit est uni au corps. Elle ne se distingue donc pas de l’affect si ce n’est par le concept. Les choses commencent à s’éclaircir : ce que nous appelons mal n’est pas autre chose que la conscience même de la tristesse, en vertu de l’union que l’esprit a avec le corps, qui sont une seule et même chose, tantôt considérée sous l’attribut de la pensée, tantôt sous l’attribut de l’étendue. La conscience du mal n’est donc pas autre chose que l’idée de la tristesse, l’idée de l’idée de l’affect étant unie à l’idée de l’affect comme l’idée est unie à l’affect lui-même. Le mal est ainsi reconduit, si l’on peut dire, à sa plus simple expression : la conscience d’avoir mal, c’est-à-dire de se sentir passer à une puissance moindre et d’en être conscient.
Or, la conscience de ce qui fait mal porte un nom, c’est la douleur. Aussi n’est-il pas surprenant de voir la douleur (dolor) définie conjointement à la tristesse (tristitia), l’un des trois affects primordiaux avec le désir (cupiditas) et la joie (laetitia). La douleur se réfère à l’homme quand l’une des parties de son corps est affectée de préférence à d’autres. La mélancolie (melancholia), qui lui est associée, s’en distingue par ce qu’elle est une tristesse qui les concerne toutes de manière égale15. La douleur est plutôt locale, la mélancolie une douleur totale qui affecte le corps dans son ensemble. Ces deux affects ont leurs contraires respectifs : d’un côté, la titillatio, ou « chatouillement », qui s’apparente à un plaisir local ; de l’autre, l’hilaritas, ou « allégresse », qui est un plaisir ou un bien-être diffus dans tout le corps.
Est-ce à dire que la douleur serait le fin mot pour signifier notre expérience du mal ? Souffrir n’est-ce pas d’évidence un mal ? À y regarder de plus près, les textes dissuadent de faire ce raccourci. Une série de distinctions, accompagnées par autant de litotes et adverbes (directe, indirecte, semper), viennent comme nuancer l’apparente symétrie suggérée par le couple laetitia-tristitia. Si la tristesse est « directement mauvaise (directe mala) » et la joie « pas directement mauvaise, mais bonne (directe non mala est, sed bona) »16, la mélancolie, elle, est dite « toujours mauvaise (semper mala) »17. À l’opposé de cette dernière, l’allégresse est « toujours bonne (semper bona) » et « ne peut avoir d’excès (excessum habere nequit) »18. Or, tel n’est pas le cas de la douleur qui, opposée à la titillatio, répond à une autre nature. Le chatouillement, en effet, « peut être excessif et être mauvais (excessum habere potest et mala esse) », alors que la douleur, elle, « peut être bonne (potest esse bonus) dans la mesure où le chatouillement ou joie est mauvais (quatenus titillatio seu laetitia est mala) »19. Voilà qui invite à une certaine prudence quant à qualifier la douleur de mal. En effet, la joie n’est pas directement mauvaise, mais bonne ; toutefois elle peut être indirectement mauvaise. Aussi le caractère positif de la laetitia ne nous met pas à l’abri d’effets indésirables. En somme, il ne suffit pas d’être joyeux pour être heureux. Si bien qu’il faudra apprendre à distinguer entre joie passive et joie active.
Il en va de même pour la tristesse, directement mauvaise, mais qui peut être indirectement bonne. Cela suffit pour nous dissuader de la considérer comme étant toujours mauvaise. À sa manière, la sagesse populaire en témoigne : tout le mal ne vient pas pour nuir. En revanche, ce qui ne peut souffrir d’excès, comme l’allégresse (hilaritas), ne peut jamais être mauvais, ni directement ni indirectement. Elle est donc toujours bonne. Il semble alors que l’on puisse considérer cela pour acquis : l’allégresse est synonyme de bien. Encore que cela ne soit vrai qu’en théorie, car l’hilaritas, se hâte de remarquer Spinoza, « se laisse plus facilement concevoir qu’observer »20. La raison en est que « les affects auxquels nous sommes en proie chaque jour se rapportent pour la plupart à une partie du corps qui est plus affectée que toutes les autres, et ainsi les affects ont, pour la plupart, de l’excès, et fixent l’esprit dans la seule représentation d’un seul objet, de sorte qu’il ne peut penser aux autres »21. Le bien-être du corps qui découle d’un parfait équilibre entre ses parties est donc surtout théorique, et s’il se vérifie, du fait de sa plus ou moins grande précarité, il ne peut qu’être passager. De fait, cela signifie que les affects qui connaissent un excès cachent un mal22.
Qu’en est-il de la douleur ? En tant que tristesse, elle est directement mauvaise. En soi, souffrir n’est pas bon. Mais relativement au chatouillement elle peut être indirectement bonne. Cela suffit à écarter l’idée qu’elle soit toujours mauvaise. À ce titre elle ne peut donc incarner le plus grand mal. En effet, la douleur peut être un mal pour un bien. En revanche, qu’on veuille ou non lui accorder le même statut que l’allégresse, la mélancolie, elle, demeure toujours mauvaise (semper mala). Aussi s’apparente-t-elle à la haine (odium), qui « ne peut jamais être bonne »23. Pour autant que tout ce qui n’est jamais bon soit aussi toujours mauvais, sur ce point au moins on est autorisé à conclure que ce qui est toujours mauvais ne l’est plus seulement relativement à l’objet qui nous affecte, mais par soi. Respectivement à la joie, il en va semblablement pour le rire (risus), sans doute mieux observable que l’allégresse, et que Spinoza tient absolument à distinguer de « la moquerie » (irrisio), qui est une joie mâtinée de haine. Le rire est une « pure joie » (mera laetitia), et, « à condition d’être sans excès », il est per se bonus, « bon par soi »24.
On peut donc sans mélange affirmer que la mélancolie et la haine nous font certainement toujours du mal ; et, avec la même certitude, que le rire, auquel Spinoza associe le jeu (jocus), du bien. C’est pourquoi, pour une vie bonne, « il n’est pas plus convenable d’éteindre la faim et la soif que de chasser la mélancolie »25. En effet, le corps ayant constamment besoin de se restaurer pour recouvrer son équilibre et se conserver, sous peine de dépérir, c'est à l’homme sage « de se refaire et recréer en mangeant et en buvant de bonnes choses modérément, ainsi qu’en usant des parfums, de l’agrément de la verdure, de la parure, de la musique, des jeux et des exercices du corps, des théâtres et autres choses de ce genre, dont chacun peut user sans aucun dommage pour autrui »26.
Pourtant, malgré la faveur accordée au rire et au jeu, plane sur eux encore comme une ombre (sans compter les différentes façons et raisons de rire et de jouer) : le rire, y compris quand il est pour ainsi dire « pur », peut souffrir d’excès. À ce titre il ne peut donc pas être le fin mot de ce qui fait du bien. D’autant que « le Désir qui naît d’une joie ou d’une tristesse qui se rapporte à une ou à quelques parties du Corps, et non à toutes, ne tient pas compte de l’utilité de l’homme tout entier »27. Il ne suffit donc pas de jouir et se réjouir pour connaître la béatitude. Les activités ludiques et rieuses ont beau être bonnes per se, elles ne sont pas le bien in seet per se. Quoiqu’elles conviennent à une vie heureuse, elles en demeurent encore comme des signes.
On a vu la relation tout-partie jouer un rôle qui n’est pas indifférent quant à la définition de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour le corps. En effet « tout ce qui fait que se conserve le rapport de mouvement et de repos qu’ont entre elles les parties du Corps humain est bon ; et mauvais, au contraire, tout ce qui fait que les parties du Corps humain ont entre elles un autre rapport de mouvement et de repos »28. Il en va, en effet, de la vie même du corps, définie par le rapport cinétique qu’entretiennent ses parties. La défaite de ce rapport sanctionne la mort de l’individu. Si la douleur concerne une ou plusieurs parties du corps et la mélancolie toutes à égalité, la mort, elle, concerne leur rapport même. Dolor, melancholia, mors constituent ainsi un climax descendant dans les manières que le corps a d’être affecté dans l’ordre de la passivité. Des divers degrés de tristesse que le corps (et donc l’esprit qui lui est uni) peut endurer, on aboutit ainsi à la mort comme à la limite en deçà de laquelle se tient tout vivant, au-delà de laquelle il laisse place à d’autres vivants et contre laquelle chaque chose résiste pour conserver son être. La mort semble donc la meilleure candidate pour répondre au problème de savoir ce qui est mal. En effet, quoi de pire que la mort ? Quoi de plus mauvais pour le corps que la fin de son pouvoir d’être affecté et d’affecter qui définit la puissance de chaque individu ? Que pourrait-on envisager de moins utile eu égard à la conservation du rapport de mouvement et de repos qu’entretiennent les parties du corps humain ?
Ici encore il convient de ne pas embrasser trop vite un lieu commun. Car nulle chose ne peut être détruite sinon par une cause extérieure ; chaque chose persévère en son être et dure pour un temps indéfini29. Nous ne sommes donc pas mortels par essence, mais par accident, encore que cela suive nécessairement de l’ordre commun de la nature. Malgré la fascination que la mort a pu exercer sur la philosophie, on ne philosophe pas pour Spinoza pour apprendre à mourir. Notre vie n’est pas vouée à la mort, elle n’y tend pas plus que le mouvement au repos. Le nôtre n’est pas un vivre-pour-la-mort, sa fin n’est pas sa finalité. En effet, s’il a bien un terme, tout vivant, comme le mouvement ou le conatus, n’a pas de fin. Chaque chose existe et persiste dans l’existence sans autre fin, sens ou raison que d’exister. On vit pour vivre. Et si notre existence prend effectivement fin un jour, rien de son essence n’est porteuse de sa fin. Pour Spinoza, on vit mieux, plus pleinement, dans la conscience de soi, de Dieu et des choses, que dans la conscience de notre mort – idée qui ne va jamais sans quelque crainte. Tel est le sens et l’effort d’une philosophie qui se pense comme meditatio vitae, entièrement tournée vers l’accroissement de la connaissance et l’amour de la vie.
Dans ces conditions, peut-on encore dire que la mort est un mal, voire le pire des maux ? À lire la proposition 39 d’Éthique IV, tout laisse penser que la mort doit être considérée comme un mal en ce qu’elle menace le vivant de mettre un terme à sa durée, privant ainsi le corps de son pouvoir d’être affecté. Toutefois, à bien y regarder, c’est moins de la mort dont il s’agit ici, que de ce qui la cause. Un poison peut faire que les parties du corps humain assument entre elles un autre rapport de mouvement et de repos. C’est donc le poison qui est nuisible ou mauvais, non la mort. Encore que cela ne soit vrai que relativement : la même substance peut être mortelle pour certains, bénéfique pour d’autres.
Il reste que de toutes les peurs, celle de notre mort – et peut-être davantage encore celle de notre mort sociale – est sans doute parmi les plus puissantes. Nous l’avons tellement en aversion que notre imagination la tolère à peine. C’est pourquoi la peur de mourir balance nécessairement avec l’espoir d’y échapper. Espoir qui, tant que nous sommes soumis à la peur, est sans doute aussi le dernier des affects à mourir, comme en témoigne l'expression « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ».
Il est certain que, si nous pouvons connaître les plus grandes douleurs, notre mort, elle, nous ne pouvons la connaître. Nous lui échappons au moment où elle nous touche, si tant est que ce qui nous défait nous touche encore, puisqu'à proprement parler la mort n’est pas une affection, mais la fin de toute affection. Ce qui nous affecte est ainsi moins la mort que son idée, son imagination. À ce titre, la mort peut paraître aussi indifférente que la musique pour une personne sourde. Tout au plus pouvons-nous imaginer qu’avec elle cesse toute douleur, ce qui peut la rendre en certaines circonstances tant soit peu désirable. Spinoza fait coïncider la mort avec la mutation du rapport cinétique des parties constituant un corps, encore qu’il reste très prudent sur les signes auxquels on reconnaît son passage sur le corps des autres. Aussi faut-il distinguer l’idée abstraite de la mort de l’imagination de notre mort. En effet, attendue ou subite, personne n’est jamais le témoin de sa propre mort. On peut se « sentir mourir », ou, comme on dit non sans métaphore « voir la mort en face », mais on ne peut vivre sa propre mort, car il n’y a pas d’expérience de la cessation du pouvoir d’être affecté du corps. En ce sens, la mort ne fait pas mal. Elle est un passage sans transition. En revanche, la perte ou diminution brutale ou progressive de certaines capacités d’affecter et d’être affecté peut engendrer des tristesses plus grandes que l’idée même de notre mort. Mourir cela n’est rien ; mourir la belle affaire, mais vieillir... chantait Jacques Brel. Encore que le naufrage que certains ont voulu voir dans la vieillesse ne l’est pour Spinoza que comparativement au modèle ou au souvenir d’un état du corps jugé meilleur, mais qui n’appartient pas à l’essence actuelle du corps existant en acte. Tel est le sens de l’exemple de l’homme ayant perdu la vue que Spinoza fait en réponse à Blyenbergh30.
Cet aspect rapproche un tant soit peu la mort de l’admiratio. Définie dans le catalogue des affects de la troisième partie de l’Éthique, juste après les trois affects primordiaux, premier des affects pour Descartes, Spinoza ne considère pas l’admiratio comme un affect. Affectivement neutre, l’admiratio (traduite généralement par « admiration », et mieux encore par « étonnement ») survient, elle aussi, de l’extérieur et ne comporte aucune variation de puissance. Comme la mort, elle surgit par surprise figeant soudainement autant le corps que l’esprit31. Si l’admiratio est définie comme une « distraction de l’Esprit » (Mentis distractio)32 – d’un esprit arrêté soudainement par l’image d’une chose singulière ou nouvelle qui empêche l’enchaînement à d’autres images tant que d’autres causes ne viennent le déterminer à penser à d’autres choses – la mort, elle, pourrait être définie comme une distraction de la vie. L’admiratio s’apparente en effet à une petite mort, avec la différence – non des moindres toutefois – que si l’on revient d’une surprise, il ne semble pas que l’on puisse revenir de la mort33. Le rapprochement doit donc s’arrêter ici, car si l’admiratio est une affection sans affect, la mort n’est pas même une affection. C’est pourquoi l’imagination de notre mort a quelque chose de trompeur et paradoxal puisqu’elle représente à l’esprit l’image de ce qui ne peut pas lui être présent. Elle tend donc à masquer l’essentiel et à nous distraire de notre essence.
Sur le thème de la mort, il y a une sensibilité qui rapproche Spinoza d’Épicure34. La mort du corps sanctionne la dissolution d’un rapport entre ses parties remettant en jeu ce qui définit son individualité. Or, si la connaissance du mal n’est rien d’autre que l’affect de tristesse en tant que nous en sommes conscients, alors de la mort de notre corps il n’y a ni connaissance, ni affect, ni conscience, car pour connaître, être affecté et être conscient, encore faut-il durer et endurer comme vivant. Comme le pensait Épicure, il n’y a pas de sensation de la mort, le trépas par définition ne se vit pas. De ce point de vue, la mort ne saurait constituer un mal. En revanche la peur de mourir en tant qu’affect dont nous sommes conscients est lui, selon Éthique IV, 21, un mal. Quoique, en des circonstances particulièrement adverses, la mort puisse être envisagée comme un moindre mal, et donc relativement comme un bien35, il n’en demeure pas moins que « ceux qui se suicident ont une âme impuissante, et sont vaincus par des causes extérieures qui répugnent à leur nature »36. Ainsi l’idée de notre propre mort, quand elle se présente comme inéluctable ou tend à se confondre avec les plus grandes souffrances, peut sembler moins mauvaise qu’on le penserait en d’autres circonstances. Certes, la tristesse qui coïncide avec la conscience de devoir mourir peut se muer en désespoir. Néanmoins, l’Esprit continuera à l’avoir en aversion dans la mesure où par nature il ne peut que s’efforcer d’imaginer ce qui augmente ou aide la puissance d’agir du Corps et à écarter tout ce qui la diminue ou la menace. C’est donc moins à la mort en tant que telle qu’à la peur de mourir, que Spinoza prête toute son attention.
D’autant que « l’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort »37. Ce n’est donc jamais librement que nous y songeons. L’un des effets de la sagesse est ainsi de nous libérer, sinon de la mort, aussi nécessaire que tout autre événement, des affres que nous procure sa pensée, et ce par la connaissance même de ce qu’est la vraie vie. Il n’y a presque rien à tirer de l’idée de la mort du corps qui puisse tant soit peu contribuer à la sagesse, si ce n’est des connaissances d’ordre médical. Non seulement nous ne pouvons avoir qu’une connaissance inadéquate de la durée de notre corps, mais à strictement parler nous ne connaîtrons jamais notre mort, ni celle de notre corps (bien que celui-ci cessera un jour d’imaginer), moins encore de notre esprit, dont quelque chose demeure après la mort du corps. Nous ne disparaissons pas complètement avec la mort de notre corps, car « l’Esprit humain ne peut pas être absolument détruit avec le Corps ; mais il en subsiste quelque chose qui est éternel »38.
Gilles Deleuze semblait presque vouloir en minimiser les effets sur l’imagination quand il définissait la mort comme « une mauvaise rencontre ». Mauvaise, certes, pour autant qu’elle démolit la relation entre les parties du corps. « Un arrêt de l’arbitre », préférait dire en chantant Jacques Brel. Aussi est-il est raisonnable de la prévenir les dangers de morts pour éviter de la rencontrer, mais non au point de renoncer à vivre et à agir. Il y a mieux à faire que trop songer à cette rencontre sans lendemain. La mort n’est donc pas ce qu’il y a de pire. La craindre au point d’empêcher une saine expression de la vie est plus redoutable. En ce sens, la fantaisie d’une vie après la mort est le signe d’une vie moins active. Il faut en effet avoir commencé par être inquiété par l’idée de notre mort pour pouvoir rêver d’immortalité et ainsi confondre l’éternité qui nous constitue avec cette seconde vie plus imaginaire encore que l’imagination de notre mort.
Si nous ne pouvons connaître notre mort, en revanche, nous connaissons celle des autres. C’est elle qui nous apprend et vient nous rappeler si besoin (car nous avons tendance à l’oublier) que nous sommes mortels. Ce sont encore les autres qui nous apprirent que nous fûmes nés un jour, car cela aussi nous l’ignorions.
En lieu et place des classiques admonitions sépulcrales (hodie mihi,cras tibi, « souviens-toi que tu es poussière »), le visiteur du cimetière monumental de Rouen peut tomber sur l’inscription : « D’ailleurs ce sont toujours les autres qui meurent ». Rire moqueur, paradoxale lapalissade, mot d’esprit s’il en est, l’épitaphe laissée par Marcel Duchamp est comme un dernier pied de nez à la mort. Introduite par l’ambivalente conjonction-adverbe « d’ailleurs », elle semble souffler à celui qui passe : « au fait, toi, vivant parmi les morts, dis-toi que la mort n’est jamais que celle des autres. Son idée ne vit que par ton imagination ». C’est pourquoi, la mort s’oppose moins à la vie qu’à la naissance, car ce qui nous a généré et nous fera périr est toujours du vivant. Naissance et mort ont toutes deux une cause extérieure à ce qui vit et qui, en vie, s’efforce de persévérer dans l’être. Naissance et mort viennent ainsi d’ailleurs, presque de surcroît, comme le dit si bien l’humour duchampien, dont l’esprit continue à vivre suspendu entre ciel et terre au-dessus de sa pierre tombale.
Les difficultés rencontrées dans la définition de ce qui est mal relèvent foncièrement de sa relativité. Cependant, tout en étant son corrélat, le mal ne s’oppose pas symétriquement au bien et il ne saurait être disposé sur le même plan. En effet, nous ne savons avec certitude être un bien ou un mal que ce qui contribue véritablement à comprendre, ou ce qui peut nous empêcher de comprendre39. Mais, si nous ne savions pas que tout ce qui peut nous conduire à comprendre vraiment est bien, nous ne pourrions pas non plus savoir que ce qui nous empêche de comprendre est mal. Or, s’il y a quelque chose que nous pouvons connaître adéquatement, c’est Dieu, qui constitue aussi notre vertu suprême, puisque la vertu absolue de l’Esprit c’est de comprendre et son objet suprême est Dieu40. Aussi tout ce qui contribue véritablement à comprendre Dieu est par définition un bien. Toutefois, si une connaissance adéquate du summum bonum est accessible, il n’y en a guère du mal :
La connaissance du mal est une connaissance inadéquate41.
Bien que s’appuyant sur des propositions qui remontent à la huitième proposition, et plus avant encore dans la troisième et la seconde, ce théorème intervient relativement tard dans le parcours de la quatrième partie. Il est renforcé par son corollaire : « De là suit que si l’Esprit humain n’avait que des idées adéquates, il ne formerait aucune notion du mal »42. Lui fait écho la proposition 68, qui renvoie directement à la 64 : « Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal aussi longtemps qu’ils seraient libres »43.
Ce groupe de propositions peut donner l’impression de vouloir rebattre les cartes. On est en effet inévitablement conduit à porter un regard rétrospectif sur le sens des définitions et des propositions consacrées au mal qui ont précédé. En effet, si une connaissance adéquate du mal est impossible, comment lire les deux premières définitions de la quatrième partie : « Par bien, j’entendrai ce que nous savons avec certitude nous être utile » et « par mal, ce que nous savons avec certitude nous empêcher de posséder un bien » ? Passe encore pour le bien : dans la mesure où je puis produire par les seules forces de la raison de quoi comprendre ce qui m’est vraiment utile, la connaissance du bien m’est accessible par la considération de la seule nature humaine. Il m’est donc possible d’en forger une connaissance adéquate. Mais si du mal nous ne pouvons avoir qu’une connaissance inadéquate, comment pouvons-nous parvenir à une quelconque certitude à son sujet ? Comment être certain que quelque chose nous empêche vraiment de posséder un bien ? Dès lors, que faut-il comprendre au juste par « la vraie connaissance du bien et du mal, en tant que vraie, ne peut réprimer aucun affect » ?
On ne sort pas de la difficulté tant que l’on persiste à placer le bien et le mal sur un même plan. Certes ils sont tous deux relatifs, mais le mal l’est pour ainsi dire deux fois, puisque sa connaissance dépend de celle du bien. De notre bien nous pouvons en effet avoir une connaissance adéquate. Mais non du mal, qui se révèle à nous seulement relativement au bien, précisément comme empêchement. En quel sens alors la connaissance vraie du bien et du mal peut-elle être dite vraie tout en étant inadéquate ? Spinoza semble indiquer ici la certitude imaginative de la morale, qui, bien que vraie, n’en est pas moins impuissante à produire l’action vertueuse autrement que sur le mode de l’obéissance, c’est-à-dire poussée par un affect plus fort, par exemple la crainte du châtiment.
Cela dit, la notion de bien elle-même ne semble pas immune de toute critique. Si nous n’avions que des idées adéquates, c’est-à-dire si nous naissions libres (autrement dit dépourvus d’idées inadéquates), nous ne formerions aucun concept du mal et « par conséquent – ajoute Spinoza – (puisque bien et mal sont des corrélats) du bien non plus »44. Bien que l’hypothèse soit, comme s’empresse de le préciser Spinoza, inconcevable « si ce n’est en prêtant attention à la seule nature humaine (ou plutôt à Dieu en tant qu’il est cause de l’existence de l’homme) »45, elle recouvre pourtant un double intérêt : philosophique d’abord, scripturaire ensuite, car il renvoie directement au récit adamique de la connaissance du bien et du mal. On retrouvera l’interprétation de l’histoire du premier homme au chapitre IV du Traité théologico-politique. Pour se cantonner ici au seul point de vue philosophique, d’un côté, le bien n’est pas un attribut de Dieu, la bonté ne faisant pas partie de son essence ; de l’autre, il est suprêmement bon pour nous de le connaître.
L’appellation de bien suprême qui est conférée à l’idée de Dieu n’a donc de sens qu’eu égard au fait que nous avons avec des idées adéquates aussi des idées inadéquates. Si tel n’était pas le cas, autrement dit si nous n’avions que des idées adéquates, l’esprit ne formerait ni l’idée du bien, ni celle du mal. C’est parce que notre esprit peut avoir une connaissance adéquate de ce qui est bon pour nous, qu’il peut savoir aussi ce qui, relativement à cette connaissance, peut être considéré comme mal, autrement dit, nuisible, préférable ou à éviter. La différence entre bien et mal est donc rendue possible par la présence d’idées inadéquates. Nous savons avec certitude que nous avons des idées inadéquates parce que nous en avons d’adéquates.
Il en va ainsi semblablement pour le bien comme pour le vrai : de même que « le vrai est index de soi et du faux (verum index sui et falsi) », tout autant peut-on dire que le bon est index de soi et du mal (bonum index sui et mali). En effet, c’est grâce à la présence de l’idée adéquate norme de vérité, que je puis comprendre la différence avec les idées inadéquates. De même, c’est l’idée adéquate de Dieu comme bonne à connaître qui implique celle inadéquate du mal comme ce qui empêche d’acquérir d’autres idées adéquates. De même qu’il n’y a pas d’idée adéquate du faux, car il n’y a rien de positif dans les idées inadéquates pour lesquelles on puisse les dire fausses, de même il n’y a rien de positif dans le mal pour qu’il puisse être connu adéquatement.
Il y a donc une grande différence entre l’homme libre de la proposition 67 et l’hypothèse des hommes naissant libres de la proposition 68. Le premier vit sous la seule dictée de la raison, c’est-à-dire qu’il n’est pas conduit par la crainte de la mort, désire directement le bien, désirant agir, vivre et se conserver d’après le fondement qui consiste à rechercher son propre utile. Il ne s’agit donc pas d’une simple hypothèse, mais d’un modèle ou projet de vie réalisable au moins en partie par un esprit qui s’efforce de faire prévaloir des idées adéquates sur les inadéquates. Le second (la proposition est introduite par un « si ») est une pure hypothèse forgée à partir de la seule essence humaine telle qu’elle découle de Dieu en tant qu’il est cause de l’existence de son essence. Si elle est une hypothèse impossible du point de vue de l’existence dans la durée, car il ne peut se faire que l’homme ne soit pas une partie de la nature et qu’il ne soit pas affecté par autre chose (et donc aussi de tristesse), elle n’est pas pour autant absurde, car elle se fonde sur l’existence éternelle de l’essence de l’homme telle qu’elle est contenue en Dieu. Ce qui signifie que, bien qu’il soit impossible d’avoir une idée adéquate du mal (car si nous en avions une, le mal en tant que tel s’évanouirait sous l’effet de l’adéquation de son idée), dans l’exercice du deuxième genre de connaissance46, les notions de mal et de bien redéfinies par la raison demeurent encore utiles, voire indispensables, pour rendre possible le parcours de libération éthique du fait de la présence d’un grand nombre d’idées inadéquates.
C’est pourquoi les deux premières définitions de la quatrième partie doivent être comprises en fonction du projet que se propose l’Éthique. La seconde définition y fait référence renvoyant à « la Préface qui précède, vers la fin », où l’on peut lire en effet : « […] étant donné que nous désirons former une idée de l’homme à titre de modèle (exemplar) de la nature humaine que nous ayons en vue, il nous sera utile de conserver ces mêmes vocables […]. Par bien, j’entendrai (intelligam) dans la suite ce que nous savons avec certitude être un moyen de nous approcher de plus en plus du modèle de nature humaine que nous nous proposons. Et par mal, ce que nous savons avec certitude nous empêcher de reproduire ce même modèle »47. Le verbe intelligam indique bien l’usage à venir qui sera fait des termes pour permettre une stratégie rationnelle de réalisation du novum institutum dont Spinoza parle depuis son premier traité48. Cela se comprend mieux désormais, si l'on inscrit ce futur dans le cadre du projet de l’Éthique, qui consiste à conduire le lecteur par la main, pas à pas, à la béatitude.
Bien et mal ne recouvrent aucune réalité dans les choses. Il n’y a pas de mal en soi, ni de bien en soi. Ils sont relatifs, c’est-à-dire relatifs à un contexte d’idées inadéquates, autrement dit à l’imagination. Toutefois le mal est lui-même relatif au bien, dont la raison peut forger une idée adéquate, nous faisant ainsi connaître en quoi consiste notre suprême vertu.
Dans l’état naturel, chacun décide du bien et du mal selon son tempérament et en ne tenant compte que de sa seule utilité. Et par conséquent, il n’y a de péché, mérite, juste, injuste, mal et bien, que dans l’état civil. Le mal, comme le bien, est toujours relatif à l’imagination. En ce sens, le mal n’est rien d’autre que la conscience de la tristesse (et le bien la conscience de la joie).
Le mal, comme le bien, est relatif également à la raison au sein du projet de réaliser son modèle de vertu, fondé non sur une morale de l’obéissance, mais sur une éthique de la compréhension de notre véritable utilité. Dans cette perspective, il faut relire les deux premières définitions d’Éthique IV, qui reformulent celles de la préface. C’est ainsi que nous pouvons savoir avec certitude, par exemple, que la mélancolie et la haine sont toujours mauvaises. C’est dans ce sens aussi que nous pouvons avoir une vraie connaissance du bien et du mal, mais qui, en tant que vraie, est à elle seule impuissante à contrer les affects. En effet, ce n’est pas parce que nous jugeons une chose mauvaise que nous cesserons de la désirer, mais au contraire parce que nous l’avons en aversion que nous la jugerons mauvaise. C’est pourquoi nous commençons par constater, comme Spinoza raconte en avoir fait l’expérience sur soi, que nous sommes désavoués par nos propres actes, selon le mot de Médée que l’amour pour Jason éloigne de ses devoirs envers le père et la patrie : video meliora proboque, deteriora sequor49. La formalité de la loi est à elle seule impuissante à engendrer l’obéissance. La connaissance d’une vraie morale est à elle seule impuissante à modifier nos agissements tant que d’autres affects nous y contraignent ou que la compréhension de notre véritable utilité ne recouvre une puissance supérieure aux affects jugés mauvais. La quatrième partie de l’Éthique explore les raisons qui nous rendent impuissants face aux affects tout en montrant la voie qui permet de faire progresser la raison.
Les notions de bien et de mal tendent à s’estomper avec l’avancée des idées adéquates, jusqu’à perdre de sens avec l’hypothèse d’un homme pensé sous l’aspect de sa seule essence. En effet, tant que l’Esprit est composé d’idées inadéquates (ce qui est toujours le cas, y compris chez le plus sage des hommes), il sera contraint de faire avec les idées de mal et de bien. Simplement l’homme libre en usera comme d’instruments en vue d’augmenter sa propre puissance ou vertu ; d’où leur redéfinition en un sens pragmatique. Il pourra ainsi diminuer l’emprise des idées inadéquates et des passions qui vont avec, non toutefois jusqu’à les supprimer complètement, car « il ne peut pas se faire que l’homme [le sage comme l’ignorant, encore qu’en mesure différente] ne soit pas une partie de la Nature, et puisse ne pas pâtir d’autres changements que ceux qui peuvent se comprendre par sa seule nature et dont il est cause adéquate »50.
Enfin, avec la connaissance intuitive et l’amour intellectuel de Dieu, les notions de bien et de mal tendent à disparaître. La connaissance du troisième genre nous libère de la loi qui recommande le bien et déconseille le mal, sans toutefois l’invalider ni la contredire. Ce n’est sans doute pas par hasard que les termes de bien et de mal sont presque absents de la cinquième partie de l’Éthique, et notamment des propositions qui traitent de la durée de l’Esprit sans relation au corps. Donnant accès à la compréhension des choses singulières, les choses sont alors comprises singulièrement par leur seule essence, directement à partir des attributs, sans comparaison entre elles ni à l’aide de modèles généraux forgés par l’imagination ou la raison. C’est-à-dire exactement comme Dieu les comprend : par-delà toute idée de bien et de mal.