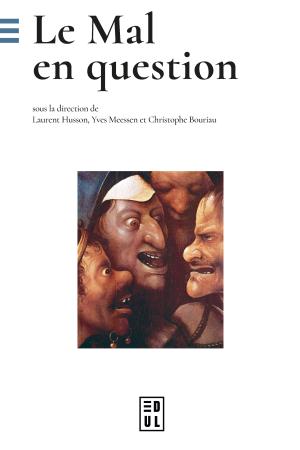
Malum enim non est effectus, sed defectus1 : cette affirmation eckhartienne va guider l’ensemble du propos qui va suivre. Elle ne sera pas admise d’emblée, comme un axiome régulateur, mais sa légitimité sera interrogée. Pouvons-nous décemment parler du mal comme d’une « défectuosité » lorsque l’on constate les ravages de la violence ? Sa tendance à se propager comme une onde malsaine, dont les remous sont dévastateurs, ne nous oblige-t-elle pas à envisager une « effectivité » du mal2 ?
Cette problématique, peu le contesteront, n’est pas spécifique à une époque. Elle appartient malheureusement à l’humanité, dans toute son histoire. De ce fait, écouter la manière dont un penseur médiéval parle du mal ne sera pas dénué d’intérêt. Dans toute enquête philosophique, il s’agit d’interroger la chose du texte, ce qui en fait sa contemporanéité malgré la distance historique. Encore faudra-t-il entendre qu’un médiéval n’en parle pas dans le même cadre que le nôtre. La scolastique était codifiée, tant dans son langage que dans son approche conceptuelle. Cela veut dire que des formules, répétées comme telles en les décontextualisant, risquent d’être mésinterprétées. Eckhart lui-même, avait averti ses lecteurs qu’il leur serait « de peu d’utilité » (parvae utilitatis) de lire son Opus expositionum, autrement dit ses commentaires scripturaires, sans passer par son Opus propositionum, relu lui-même à l’aune de son opus quaestionum3. Suivre cette méthode permettra d’entendre la manière de penser et de parler du maître thuringien, afin de pouvoir nous prononcer sur la réception de sa sentence. Dans un premier temps, nous prendrons connaissance d’« une double règle » qui régit le discours eckhartien. Ensuite, nous observerons comment, chez Eckhart, apparait « le mal dans le projet d’un traité sur le bien ». À partir de là, nous circulerons dans l’œuvre eckhartienne pour y déceler « un discours éthique sur le mal ». Enfin, nous tâcherons d’en tirer des conséquences pour « une approche contemporaine de la question du mal ».
À l’aube du 14e siècle (1302-1303), date du premier magistère parisien de Johannes Eckhart, de nouvelles théories sémantiques voient le jour. Certains penseurs voudraient évincer toute psychologie de la science théologique. Ils envisagent l’intention première, par laquelle l’âme est directement affectée par ce dont elle parle (pathèmata tès psychès)4, comme un signe, lui-même indiqué par un mot ou un vocable. Maître Eckhart sera réfractaire à cette innovation, car il y va de la possibilité de faire droit à une auto-affection de la créature par son Créateur. Voilà pourquoi l’Opus tripartitum, qu’il projette comme une Summa originale, commence par un prologue général dans lequel il pose une double règle qui va régir le rapport du signe et de la causalité :
Donc, pour l’évidence [ad evidentiam], on a principalement deux choses à remarquer :
L’une est qu’il faut parler et penser autrement [aliter loquendum et sentiendum] des termes généraux, c’est-à-dire de l’être, de l’unité, de la vérité, de la bonté et de ce qu’il peut y avoir de termes de ce genre qui se convertissent avec l’étant, et des autres [termes] qui sont en deçà d’eux et limités [contracta] à un genre, à une espèce ou à une nature de l’étant.
La seconde est que les inférieurs ne confèrent absolument rien aux supérieurs et ne les affectent pas non plus, mais que, inversement, les supérieurs donnent leur empreinte à leurs inférieurs et les affectent5.
La première règle est basée sur la distinction grammaticale entre les « termes généraux » : esse, unitas, veritas, bonitas, et les mêmes termes, mais en tant qu’ils se convertissent avec l’étant, à savoir, comme il le dira plus loin6 : ens, unum, verum, bonum. Autant la première série est « abstraite » et ne se présente jamais dans le visible comme telle, autant la seconde est « concrète » et apparait dans le visible. Du point de vue du signe, on ne peut désigner directement que ce qui est convertible à l’étant, à savoir ce qui est étant-ceci ou étant-cela. Les termes abstraits, eux, ne sont jamais visés directement mais seulement en tant qu’ils affectent ou causent les étants. Il y va donc d’une positivité de la théologie. Mais Eckhart ne s’arrête pas là. La seconde règle définit l’articulation entre la première et la seconde série. Cette règle régit la causalité : seuls les termes supérieurs ou généraux affectent les termes inférieurs ou singuliers, l’inverse non. Ce cadre régulateur entraine une conséquence importante : l’inséparabilité de la cause et de l’effet va de pair avec l’impossibilité d’un discours et d’une conception directe des « termes généraux » (termini generales). Ces derniers sont aussi identifiés à des « transcendantaux » (transcendentia)7, lesquels vont toujours par paire abstrait-concret8. Or, le lien entre les deux ne s’exprime pas dans une proposition prédicative, il est éprouvé. La manière dont le supérieur affecte l’inférieur s’éprouve concrètement au sein de l’action. Le paradigme en est le rapport du juste (concret) à la justice (abstrait). À savoir, seul le juste connaît la justice : « Le juste en tant que tel, c’est-à-dire ce que le juste est par tout lui-même et par tout ce qu’il est, est par la justice elle-même et en elle, qui est son principe »9.
Qui n’entre pas par ce portail manque complètement la pensée de Maître Eckhart. Sans cesse, ce dernier va dérouler un discours qui sera inaudible par un lecteur se contentant d’entendre les mots de l’extérieur (per studium ab extra) sans en vérifier la teneur par son action10. Par exemple, dire que « Dieu est le principe de toutes choses » sans se situer soi-même d’ores et déjà comme un produit de ce principe, est une aberration. Pour le dire autrement, Eckhart a un rapport à la vérité de type socratique11. Il ne suffit pas de parler d’une chose pour pouvoir émettre un jugement vrai ou faux, encore faut-il se situer « justement » par rapport à elle. C’est donc ce conseil que nous tâcherons d’appliquer pour évaluer la sentence eckhartienne énoncée plus haut : Malum enim non est effectus, sed defectus.
Pour Eckhart, tout étant doit son activité à une cause première dont il est le patient. Le couple aristotélicien action-passion se retrouve partout, et il est le lieu philosophique où se vit l’ouverture théologique. Qui dit patient dit « pâtir », c’est-à-dire « être affecté par ». Aussi, chaque humain n’est actif qu’en raison d’une passivité originaire. Chaque acte qu’il met en œuvre est dérivé d’une altérité interne qui le traverse. Son effectivité est seconde, et non première. L’opérativité humaine est rendue possible par une opérativité première : l’opérativité divine. Tout ce qui se rencontre comme étant dans le monde est immédiatement dépendant de la cause première qui lui confère l’être. Il en va de même pour l’un, le vrai et le bon, qui lui sont convertibles. Ces transcendantaux sont énumérés comme les quatre premiers traités de l’Opus propositionum :
Le premier traité concerne l’être [esse] et l’étant [ente], et leur opposé qui est le néant [nihil]. Le deuxième, l’unité [unitate] et l’un [uno], et leur opposé qui est le multiple [multum]. Le troisième, la vérité [veritate] et le vrai [vero], et leur opposé qui est le faux [falsum]. Le quatrième, la bonté [bonitate] et le bon [bono], et le mal [malum], leur opposé12.
Bien que nous ne disposions pas plus du quatrième traité que des trois autres13, cette énumération est fondamentale pour aborder la question du mal chez Eckhart. En effet, force est de constater que les quatre termes abstraits (esse, unitas, veritas, bonitas) sont uniques. Seuls sont dédoublés les termes concrets, de manière opposée (ens-nihil, unum-multum, verum-falsum, bonum-malum). Le lecteur peut déjà en déduire que le supérieur n’affecte pas ipso facto l’inférieur sur le mode de la perfection. La causalité laisse place à un écart qui se traduit par une opposition. Cela veut dire que Maître Eckhart a bien entériné le rejet augustinien du manichéisme. Le mal n’a pas de correspondant au niveau supérieur. Il surgit comme un double négatif de son effectivité. C’est seulement à ce titre que nous pourrons entendre la sentence eckhartienne suivante : « cela seul est mal qui n’a pas de cause » (hoc solum malum est quia causam non habet)14. Un contemporain pourrait être abasourdi par une telle affirmation. Elle ne signifie pas du tout que le mal ne puisse être commis par un sujet libre, en possession de ses facultés. Dans cette sentence, le terme « cause » désigne la cause supérieure et non pas tel humain capable de tel ou tel acte. Si le terme général qui affecte tous les étants est seulement la bonté, il ne peut avoir causé le mal. Le mal surgit donc comme ce qui se soustrait ou se détourne de sa cause. Un tel écart est possible, car la causalité n’affecte pas l’humain selon la nécessité mais en recourant à sa liberté : « la nature intellectuelle […] peut, du bien, verser dans le mal en tant que libre arbitre (vertibilis a bono in malum, in quantum est arbitrio libera) »15. Cependant, la possibilité de ce pouvoir de verser dans le mal précède l’homme. La dualité entre bonum et malum à partir de la bonitas, quoique non originaire, se trouve néanmoins disponible à la racine de tout acte humain. C’est sur ce point, cette dualité, qu’achoppent tous les discours rationnels et que surgissent les pires théodicées. On ne cachera pas que, reprenant l’enseignement de Thomas d’Aquin16, Eckhart ne prête le flanc également à cette critique incluant la présence du mal comme corrélative au bien : « En effet la perfection de l’univers requiert que le mal soit, et le mal lui-même est compris dans le bien et rapporté au bien de l’univers que vise d’abord par elle-même la création » (Malum enim esse perfectio requirit universi, et ipsum malum in bono est et ad bonum universi, quod primo et per se respicit creatio)17. Ce passage, si on l’isole de l’ensemble de la pensée eckhartienne, est plus que contestable. Dire que le mal appartient d’une manière ou d’une autre à la perfection du bien est intolérable. Interpréter la proposition en disant que la perfection du bien nécessite que l’homme ait un libre arbitre, et donc, qu’il soit versatile entre bien et mal, ne vient pas atténuer la brutalité de l’affirmation. Elle vient juste donner une interprétation qui pourrait être davantage corroborée dans d’autres passages eckhartiens. En voici un et il est fondamental :
Tous [les Pères et les théologiens] s’accordent à demander pourquoi ce qui a été créé au second jour n’est pas dit « bon » alors que cela a été dit du premier jour et que cela le sera aussi plus bas de qui a été créé les autres jours. Et, bien qu’à ce sujet, comme au sujet des eaux au-dessus des cieux, je les oublie ici et d’autres choses encore, par souci de brièveté, comme je l’ai promis dans le Prologue. Et je dis que deux est la racine et l’origine de toute division. Or, toute division est en tant que telle mauvaise : elle vient du mal et elle s’y tient [Divisio autem omnis, inquantum huiusmodi, mala est, ex malo et in malo]. En effet, la division de l’innombrable, le multiple, est la chute hors de l’un et par suite hors de l’être et du bien qui sont convertibles avec lui. Il serait donc inutile et faux d’appeler « bon » ce qui déchoit et sort du bien, puisque, au contraire, cela s’affaisse ou glisse dans le mal et devient mauvais18.
Cet extrait met en lien deux points indissociables concernant le mal : radicalité et glissement. Primo, le mal est la division elle-même, la racine double (binarius radix). On pourrait l’appeler « mal radical » si l'on ne versait pas aussitôt dans la critique kantienne. Chez Eckhart : « Deux ou la dualité, tout comme la division, est toujours une chute et une sortie de l’être même » [Binarius sive dualitas sicut divisio semper est casus et recessus ab ipso esse]19. Il y a donc une chute radicale, que l’on devrait appeler une « chutabilité » ou une faillibilité ontologique (une possibilité de faillir), qui précède la chute morale ou éthique. En effet, secundo, le mal possible ne survient effectivement qu’au gré d’une chute active de l’homme. Celle-ci arrive comme un détournement ou comme un glissement hors de l’usage de la volonté droite. D’où alors le fait que l’homme qui commet le mal ne puisse être appelé bon : « Mais celui qui glisse du bien et s’éloigne ou se divise du bien ne peut être dit “bon” ni comporter quoi que ce soit de bien »20.
On comprend que ce dédoublement (radical et glissement) oblige toute pensée sur le mal à se tenir elle-même dans ce que réalise le mal : se dédoubler. Et qu’il est par le fait même non circonscriptible en tant que tel, de manière explicite. Plus explicitement, toute tentative de rationalisation de cette question est elle-même entachée par la lésion primaire.
Que le mal soit une « défectuosité » entraine comme conséquence qu’on ne pourra parler de lui directement. Autant le bien, parce qu’il est convertible à l’étant (bonum et ens convertuntur), peut être visé comme un objet de notre pensée, autant le mal se présente d’emblée comme ce que l’on ne pourra pas viser. Et donc, il est aussi ce que l’on ne pourra ni concevoir, ni définir. Eckhart se situe dans le sillage d’Augustin qui abordait la question du mal par le biais de la privation (privatio boni)21. Cela veut dire que toute tentative de discours sur le mal nécessite une méthode d’investigation tangentielle. Sous les yeux, seuls des biens se donnent à voir, et à circonscrire. Pour tenter de situer le mal, il faudra regarder ce qui corrompt, déforme, abîme, ou soustrait un bien. Or, cela pose aussitôt la question : cette corruption ou déformation n’est-elle pas causée par un acte efficient ? D’où, aussi, la mise en examen de cette autre affirmation eckhartienne déjà citée : « cela seul est mal qui n’a pas de cause ». Que recouvre cette proposition ? Eckhart serait-il assez insensé pour supposer qu’un coup de poing qui vient s’abattre sur un visage n’a pas de cause ? La chose est trop évidente pour être niée. D’ailleurs, nous l’avons vu précédemment, qui commet le mal ne peut plus être appelé « bon ». Mais, précisément, il ne sera appelé mauvais qu’au regard de l’acte qu’il aura commis, et non intrinsèquement. Que l’être humain soit faillible, et même parfois horriblement, n’enlève pas sa dignité intrinsèque. Le mal advient comme un hiatus entre la cause première (absolument simple) et la cause seconde (capable de dualité). L’humain devrait pouvoir passer de la puissance à l’acte dans l’orientation du bien, lequel est le même pour lui et pour tous. Cependant, l’existence même, dans son exercice quotidien, montre qu’il n’en est pas ainsi.
Pour que le mal survienne, il faut que la volonté issue de la cause première se divise. Cette division de la volonté survient dans le cœur de l’homme lorsque, voulant quelque chose d’une manière désordonnée (par exemple convoitant le bien d’autrui), il veut en même temps, et on pourrait dire malgré lui, causer du tort à autrui. Autrement dit, si les biens sont répartis au détriment de la relation qui unit les êtres humains les uns aux autres, dans le respect mutuel du bien de chacun, il y a une défectuosité de l’être. D’où le fait que la cinquième et la sixième proposition concernent l’éthique (amour et charité-péché, honnête-honteux, vertu-vice et droit-oblique). Cette énumération est parlante. Eckhart considère que la vie pratique se situe dans le prolongement et même au cœur de la métaphysique. En vertu de la convertibilité des transcendantaux, la distinction entre bonum et malum se situe au même plan que la question de l’être.
Les points précédents sont-ils audibles par nos contemporains ? Selon une logique propre à Eckhart, la réponse ne sera pas oui ou non, mais oui et non22. Commençons par la négation. La réponse est non, si on présente l’opus propositionum comme un ensemble d’axiomes dogmatiques qui devraient être d’emblée validés sur le plan rationnel et conceptuel. Selon cette voie, Eckhart se serait lancé dans une démonstration de type mathématique, en construisant une structure axiomatique d’influence proclusienne, comme celle d’Alain de Lille23. Autrement dit, il aurait considéré la théologie comme une science théorique. Or, le fait même de parler de Dieu comme cause première et de l’homme comme cause seconde ne va pas du tout de soi pour un contemporain. Si l’on n’admet pas le principe dont toute la démonstration découle, la construction s’effondre. Cela étant, il est cependant possible de considérer cet axiomatique autrement. C’est pourquoi la réponse est oui, si l’ensemble des propositions (Opus propositionum) sont proposées à celui qui souhaite résoudre des questions (Opus quaestionum) en entrant dans une exposition scripturaire (Opus expositionum). Selon cette autre voie, les propositions sont des hypothèses de lecture qui sont là à titre protocolaire. Elles ne peuvent être validées qu’à travers un exercice éthique. À savoir, ce n’est qu’en situation de devoir choisir pour le bien ou le mal, dans sa mise en œuvre, que l’ensemble du discours eckhartien trouve sa cohérence. Cela ne veut pas dire que le Thuringien a considéré la théologie comme une science pratique uniquement. Il l’a envisagée comme une science à la fois théorique et pratique, c’est-à-dire comme une science dont seule la pratique pouvait valider la théorie. Voilà qui modifie entièrement la manière d’entrer dans le cercle herméneutique, en évitant qu’il ne tourne au cercle vicieux24. Cette option, Eckhart l’a explicitement affichée dès son premier magistère parisien. En effet, dans le Sermon latin pour la Saint-Augustin, il reprend le triptyque philosophique aristotélicien qui a servi de canevas à la théologie depuis Boèce jusqu’aux scolastiques : theorica/speculativa (comprenant physica, mathematica, theologica) – logica – ethica25. Pour Eckhart, contrairement à Thomas d’Aquin, ce n’est pas la métaphysique mais l’éthique qui est identifiée à la théologie sur le plan spéculatif : ethica sive theologia. Or, dans la structure tripartite, l’éthique est également ethica sive practica. Elle est dédoublée. La théologie a donc pour mission de relire spéculativement (cogitatio) ce qui se joue sur un plan pratique (operatio)26.
Dans la perspective eckhartienne, la question du mal ne peut en rester à une problématique intellectuelle. Il en va du rapport à une pratique existentielle dans laquelle le mal est expérimenté comme une défectuosité. Cependant, précisément, cette défectuosité n’est pas isolable de l’acte commis. L’acte mauvais se présente comme un glissement par rapport à la bonté dont il vit. Il est plutôt une façon par laquelle l’agent se soustrait à la cause interne qui le porte et le conduit. En termes plus contemporains, cela veut dire que le mal survient comme un manque de confiance en soi. Expliquons-nous. Agir dans le sens du bien suppose de pouvoir mobiliser en soi des forces de générosité. Or, c’est impossible sans une confiance avec cette générosité en tant qu’elle est disponible pour moi. Il nous semble que le problème fondamental du mal se situe là. À savoir que, la plupart d’entre nous sont assez clairvoyants concernant la direction à prendre mais, dans les faits, se sentent incapables de la mettre en œuvre. Empêtrés dans les circonstances, nous ne commettons pas tout le bien que nous souhaiterions faire. Nous nous orientons effectivement vers des demi-biens. De ce fait, malgré nous, nous ouvrons la porte à de légères déviations qui, à terme, peuvent s’avérer plus dramatiques à la fois pour nous et pour les autres. Cela peut commencer par un petit geste de paresse où on oublie de faire quelque chose. Mais ce manquement, anodin en lui-même, peut nous conduire à une situation embarrassante de laquelle nous essayons de nous tirer « tant bien que mal », selon l’expression consacrée. Pire encore, l’effet boule de neige peut nous conduire à des conflits ou même à des ruptures violentes. Enrayer cette défectuosité n’est pas habituellement en notre pouvoir. Elle ne devient possible qu’en ayant simultanément conscience de notre faiblesse (je ne peux y arriver) et de notre force (je peux le faire). Comme l’exprime l’apôtre Paul, ce paradoxe est celui que vit la personne croyante : « quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co, 12 :10). S’exprime ainsi celui qui perçoit sa propre identité (« je suis ») comme portée et traversée par une altérité généreuse. Le « je » ne détient plus sa vie en propre mais comme un don constamment reçu d’un autre, dont effectivement il ne se dissocie plus. Telle est la filiation divine, ou la naissance de Dieu dans l’âme, dont Eckhart fait le thème principal de sa prédication. Il s’agit de se découvrir fils d’un Père « en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être » (Ac, 17 : 28). C’est cela la foi. Croire n’est pas un acte intellectuel, mais une adhésion à un Dieu personnel qui transforme la vie. Comme le dit Eckhart dans les Entretiens spirituels, celui qui s’habitue à son intériorité est le témoin d’une transformation éprouvée :
Ainsi, toutes nos pensées, notre volonté, nos intentions, nos forces et nos membres sont transportés en lui, de sorte qu’on le ressente et le perçoive dans toutes les forces du corps et de l’âme [daz man sîn enpfinde und gewar werde in allen kreften lîbes und sêle]27.
Ne devient croyant, selon une tradition ancienne reprise par Eckhart, que celui qui se tient dans un « pâtir Dieu » (pati divina)28. Paul Ricœur relève que cette distinction était déjà attestée par Eschyle dans Agamemnon (160 et suiv.)29. Elle l’est aussi dans le Peri philosophias d’Aristote (fragment 15) : « ceux que l’on initie ne doivent pas apprendre quelque chose, mais éprouver des émotions et être mis dans certaines dispositions, évidemment après être devenus aptes à les recevoir »30. Paradoxalement, « pâtir Dieu » est également soumis à un apprentissage. Il s’agit non d’un apprentissage notionnel mais d’un apprentissage expérimental. Et s’agissant du mal, nul doute qu’il ne dure toute la vie.
La question du mal ne peut se résoudre théoriquement. Aucune théodicée ne tient vraiment la route. Le mal est à combattre et non à expliquer. Or, qui dit combattre le mal dit aussi faire acte socratique de réflexion sur soi-même. Ce faisant, combien d’entre nous refuseront-ils d’admettre leur incapacité à agir vertueusement en toutes circonstances ? Nous venons après Kant qui nous a placés devant la question du mal radical. Cette radicalité, pourtant, n’est pas originaire. C’est pourquoi il y a une autre voie que celle de faire le bien par devoir. Respecter la règle morale n’est pas à notre portée : toute la Bible se tient de A à Z dans ce constat. Aussi, la religion judéo-chrétienne se propose-t-elle comme une voie de salut. Dieu se présente comme Celui qui libère les humains, non pas de l’extérieur et comme par magie, mais en les affermissant dans leur perspective de bonheur. Lorsque l’on revient à la racine de l’acte religieux, qui est précisément de recevoir une force pour faire le bien, et donc de résister au glissement vers le mal, on ne peut qu’être outré par l’usage pervers de la religion. User d’une appartenance religieuse quelconque pour combattre, tuer et soumettre, est en pleine contradiction avec la reconnaissance que Dieu est source de tout bien, autrement dit, source du Bien pour tous. Bien sûr, les institutions religieuses, qu’elles soient passées ou actuelles, ne sont pas indemnes de cette critique.
Choisir un penseur médiéval pour présenter cette perspective pouvait d’abord passer comme contreproductif. Pourtant, même si le langage scolastique n’est plus de notre époque, nous pouvons tirer une leçon fondamentale de la pensée eckhartienne. Les dogmes ne s’imposent pas plus que la morale. Ils sont là comme des balises vers un avenir possible. Ils attirent notre attention sur une marche à suivre, en même temps qu’ils suscitent une vigilance à notre action. Les textes de la tradition chrétienne, à commencer par la Bible, ne sont pas des en-soi. Ils sont là à titre protocolaire pour relire notre vie. Et ce faisant, ils peuvent aussi nous conduire à vouloir nous retrouver en assemblée avec ceux qui partagent ce même élan de vie. Comme le rappelait Derrida, le terme religio a deux acceptions étymologiques aussi inséparables que les « foyers d’une même ellipse » : celle d’une attention scrupuleuse ou de relecture de sa vie (relegere), selon Cicéron (De la Nature des dieux, 2, 28), et celle d’une piété qui relie les hommes entre eux dans un même culte (religare), selon Lactance (Les Institutions divines, IV, 27, 3-16)31. Il se peut que la religion prenne pour nous une autre coloration que celle que nous lui avions assignée. Encore faut-il nous rendre compte que c’est précisément l’œuvre du mal que de dénigrer la religion en cachant ce qu’elle a de plus essentiel. Ce travail de sape, le mal ne peut le réaliser en attaquant la religion en tant que telle. Sa stratégie consiste à pointer du doigt la défectuosité des membres religieux mais qui sont eux-mêmes atteints du mal qui accable toute l’humanité. Ce faisant, le mal ne montre que le résultat visible de son action en la retirant dans l’ombre. La phénoménologie heideggérienne du retrait serait de mise à condition de lui faire opérer un déplacement. Ce n’est pas l’être, lequel se donne sans réserve par générosité diffusive, mais le mal qui se manifeste en se retirant.