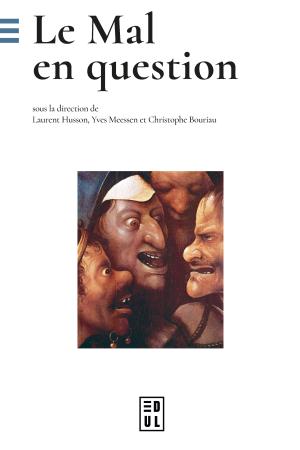
Le titre de ce volume, Le Mal en question, peut s’entendre en deux sens et les différentes contributions montrent que ces deux sens sont indissociables. Tout d’abord, le mal est une question, au sens d’un objet abordable par différentes disciplines (littérature, philosophie, théologie, sociologie, histoire). Cependant, il est également ce qui met en question notre conception du bien, du mal et de leurs effets (première partie des contributions), notre conception de Dieu, de son rapport au mal dont le péché originel est une figure insigne (deuxième partie), notre capacité à le figurer ou le représenter (troisième partie), ou bien encore à en comprendre les nouvelles figures dans la société et dans notre rapport à la nature (quatrième partie).
Dans la première partie, la question du mal est abordée dans sa définition, mettant notamment en avant chez deux auteurs le rapport du mal avec le négatif et le manque. En ouverture, Yves Meessen s’attache à montrer en quel sens le grand mystique allemand Maître Eckhart interprète le mal comme une « défectuosité » malgré son effectivité apparente. Contrairement au bien, vers lequel le regard peut se tourner comme ce qui est désirable, le mal ne se révèle qu’à travers un acte défectueux. Le fait même que l’homme ne puisse, à sa guise, éradiquer cette défectuosité pointe le doigt vers une zone d’ombre de l’humanité.
Lorenzo Vinciguerra apporte ensuite un contrepoint à cette approche négative du statut du mal, en partant des analyses de Spinoza. Il explique pourquoi le mal n’a pas de statut objectif selon ce philosophe (le bien et le mal ne recouvrant aucune réalité dans les choses), et pourquoi le Dieu de l’Éthique, en tant que Dieu impersonnel, ne saurait être accusé de vouloir et d’engendrer le mal.
Pour conclure cette première partie et ouvrir le débat sur les effets du mal, Yves Meessen passe de la question de la révélation du mal à celles de ses effets et au statut de leur négativité. Il se concentre sur un aspect précis du mal – les effets qu’il produit – et s’attache à décrire phénoménologiquement ce que ces différents effets ont en commun. Convient-il de distinguer le mal des effets qu’il engendre ? Comment qualifier ces effets relevant du mal physique ou moral ? Faut-il les décrire uniquement en des termes négatifs, ceux de destruction, de déformation, de privation ou comme conditions d’une élévation spirituelle positive ? En d’autres mots, le mal et le bien présentent-ils une opposition tranchée ou existe-t-il un passage possible de l’un à l’autre ?
Dans la deuxième partie, les contributions se confrontent à l’origine du mal, notamment sous deux aspects : le premier est la question de Dieu lui-même et le second celui du rapport à l’identité et à l’action humaine, notamment autour de la question du statut du péché originel.
Les trois premières contributions envisagent Dieu comme condition du mal, ce qui interroge la conception même que nous nous faisons de Dieu. Peter Welsen, dont l'article est traduit par Samson Takpé, expose clairement le fameux « problème du mal » tel qu’il fut formulé par Leibniz : comment concilier l’existence du mal physique et moral avec celle d’un Dieu infiniment bon et tout-puissant ? Il montre que la solution qu’en donne le grand penseur allemand dans ses Essais de Théodicée n’est pas sans soulever un important problème, puisqu’elle rend difficilement concevable l’idée de liberté humaine.
Roger Pouivet questionne le statut du divin et de sa bonté tel qu’il est présupposé dans la formulation du problème du mal. Il avance que la position classique de ce problème : « si Deus est, unde malum ? » repose sur une mauvaise conception de Dieu, celle d’une personne moralement bonne qui serait soumise à l’exigence morale de faire le bien tel que nous l’entendons. Il s’attache à montrer, en s’appuyant sur les travaux de Herbert McCabe et Brian Davies, que cette exigence morale attribuée à Dieu est absurde, de telle sorte qu’on ne saurait reprocher à Dieu l’existence du mal moral.
Consacrant son article à la fameuse phrase de Dostoïevski : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis », André Conrad s’attache à retracer le contexte et les situations dans lesquelles cette proposition prend son sens pour le grand auteur russe, tout en le confrontant aux auteurs qui se sont attachés à critiquer sa position, notamment Freud, qui voit dans cet énoncé la conséquence d’une aliénation névrotique, rattachant le sort de l’homme à celle d’un Dieu fixant des normes si exigeantes qu’elles ne peuvent conduire qu’à une vie de culpabilité.
La question du péché originel et de ses effets est traitée de deux manières différentes dans les contributions suivantes. « Le péché originel est-il plausible ? ». Telle elle l’interrogation développée par Anthony Feneuil, qui demande si l’on peut se sentir responsable d’un mal auquel on n’a pas individuellement participé, comme semble l’indiquer l’interprétation théologique dominante de ce premier « lapsus ». Pour répondre à cette question, il mobilise notamment les analyses de John Locke consacrées à l’identité personnelle et à la notion de culpabilité.
Ensuite, Laurent Husson pose la question du sens et des limites de l'usage de Jean-Paul Sartre par Eugen Drewermann. Au-delà de l’emploi problématique de la philosophie par la théologie, il souligne que l’ontologie de Sartre n’est pour Drewermann qu’une ontologie d’après la chute, ce qui est une perspective contestable qui soulève la question d’une ontologie d’avant la chute.
L’idée de Dieu évoque également celle du Diable. La question de cette figure du mal ne pouvait être laissée de côté, et deux contributions l’abordent de manière différente. Fabien Faul examine dans la tradition chrétienne les différentes approches et types de discours concernant la personne du Diable, examen nécessaire à l’élaboration d’une problématisation théologique de la question du mal, la figure de Satan étant au croisement de cette diversité et en attestant la nécessité.
C’est une tout autre figure de Satan que Tiphaine Morille présente dans san contribution. Elle montre que la position de Nietzsche face au problème du mal confine à la provocation, puisqu’avec l’auteur de Par-delà bien et mal il ne s’agit plus de plaider, comme Leibniz, la cause de Dieu, mais la cause de Satan lui-même, le Mal personnifié. Comment Nietzsche a-t-il pu en arriver là et juger pertinent de se faire l’avocat du Diable ? Quels arguments a-t-il bien pu avancer en ce sens ?
La troisième partie n’envisage plus le mal comme tel mais différents aspects de celui-ci en tant qu’action, figure ou événement, allant des formes les plus anodines jusqu’aux formes les plus tragiques, interrogeant aussi bien l’agir, le vécu que la représentation.
Christophe Bouriau interroge le statut du mal au sein même de la démarche philosophique. Pour traiter cette question, le fameux débat de Davos qui a opposé Martin Heidegger à Ernst Cassirer sur la question de la « finitude » du sujet kantien est examiné à nouveaux frais. Cassirer a commis un lapsus lors de ce débat, en utilisant le terme « impératif catégorique » au lieu de celui de « loi morale ». L’article entend notamment montrer qu’en exploitant ce lapsus à son avantage, Heidegger a peut-être commis une « faute » philosophique, au vu de ce qu’on peut attendre d’un débat constructif en philosophie.
Pierre Gillouard s’attache quant à lui à cette figure particulière du mal qu’est le malheur à partir de son analyse chez Simone Weil ; il éclaire comment la philosophe envisage la possibilité que le malheur vécu soit la condition d’un amour pur de Dieu.
Comme le montre la figure de Satan, le problème du mal est aussi un problème de représentation, dont les deux contributions suivantes présentent des aspects inverses, d’un côté ce qui excède la représentation et la met en question, de l’autre la figure du mal comme effet d’une production particulière.
Ninon Grangé aborde la question de la représentation du mal. Comment figurer ou mettre en forme ce qui peut – et pour certains doit – être de l’ordre de l’immontrable ? Ainsi en est-il du massacre, depuis les représentations picturales baroques jusqu’aux reprises photographiques contemporaines. L’amoncellement est ici à la fois ce qui excède la représentation et ce qui en est une modalité via un traitement métonymique ou par l’exemplarité.
Au rebours de cette interrogation, Guillaume Monod, psychiatre travaillant en milieu carcéral, pose la question : « La prison fabrique-t-elle le mal djihadiste ? ». Il envisage l’exceptionnalité de la figure du djihadiste, non comme un donné, une figure du mal qui se dénonce d’elle-même et justifie les mesures prises, mais comme une figure construite par les discours politiques et les procédures carcérales qui en procèdent, construction pour partie fantasmatique pouvant recouvrir une certaine forme de banalité.
La quatrième partie se focalise moins sur le mal, son origine, ses causes et ses formes, que sur le milieu dans lequel il s’inscrit. Ce milieu peut être un facteur possible du mal, mais aussi fournir une perspective de relativisation ou bien un cadre nouveau pour poser ce problème dans l’avenir.
Ce décalage est introduit par la contribution de Lukas Sosoe, qui montre la place marginale de la question du mal dans une interprétation sociologique du religieux, les divergences qu’une telle approche engendre avec l’interprétation philosophique kantienne, tout en mettant en évidence le maintien d’un certain nombre de points de convergence.
Françoise Willmann, quant à elle, étudie les œuvres de quelques écrivains contemporains de langue allemande dans lesquelles la complexité des événements et des interactions conduit à des drames qui comptent parmi les figures du mal physique et moral. Cependant, le mal ne s’y impose pas comme un sujet en tant que tel, comme si la question morale devait être éclipsée par les rapports sociaux et économiques. Mais c’est précisément une telle interprétation que l’approche littéraire permet d’interroger.
Enfin, Charles Braverman resitue le problème du mal dans le contexte de l’écologie, au rebours de la limitation kantienne du respect aux seuls êtres humains rationnels. Le mal désigne ici l’injustice consistant à perturber, voire à détruire, les qualités (intégrité, stabilité, beauté) de la communauté biotique. Aldo Leopold et John Baird Callicott étendent l’idée de valeur morale sans se limiter au critère kantien de la moralité. Il ne s’agit pas d’étendre la signification du mal par la prise en compte de la souffrance subie par des individus humains ou non-humains, mais bien par les dommages causés à la communauté biotique. Dès lors, comment donnent-ils un sens et justifient-ils cette possibilité d’une extension inédite de la distinction morale entre bien et mal ?
Christophe Bouriau
Yves Meessen
Laurent Husson